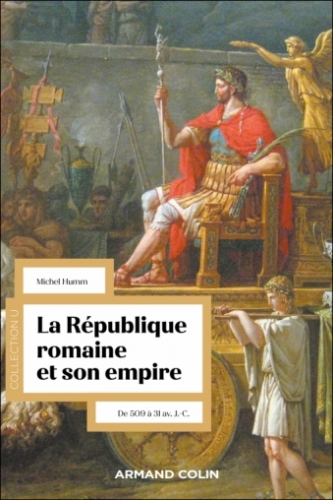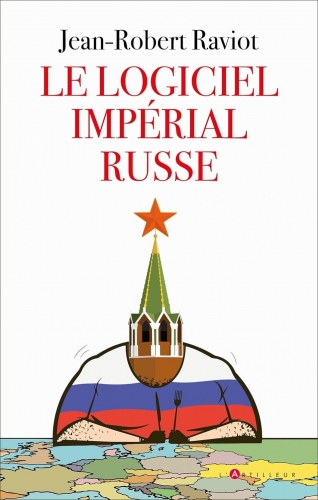Les éditions Perrin publient cette semaine, dans leur collection de poche Tempus, un essai historique de Guillaume Frantzwa intitulé 1520 - Au seuil d'un monde nouveau. Archiviste paléographe et docteur en histoire de l'art de l'université de Paris I, Guillaume Frantzwa est déjà l'auteur du Rêve brisé de Charles Quint – 1524-1545 : un empire universel ? (Perrin, 2022).
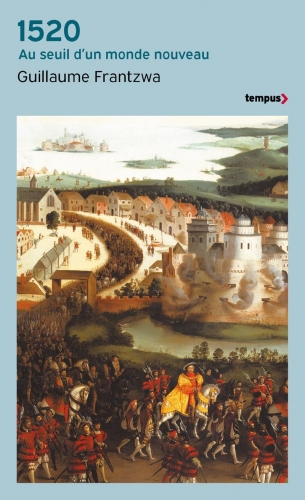
" La plupart des dates clés sont le témoin d’événements fondateurs : 476 marque la fin de l’Empire romain d’Occident, 1453 la chute de Constantinople. Dans ce paysage, 1520 est l’exception qui confirme la règle. Année en suspens, elle se caractérise non par un événement majeur, mais par une multiplication de faits qui font basculer le Moyen Âge dans la modernité.
En 1520, les rivalités européennes s’exacerbent. Deux jeunes souverains, Charles Quint et François Ier, rêvent d’empire universel. L’Europe se fragmente, dans la magnificence du camp du Drap d’Or, alors qu’un ennemi pressant se réveille à l’Est, avec l’avènement de Soliman le Magnifique. À ces tensions s’ajoute une dynamique d’expansion : suivant l’Espagne, la France et l’Angleterre se lancent dans la conquête de nouveaux territoires tandis que le Portugal étend sa domination du Brésil à la Chine.
1520 est aussi l’année des grandes découvertes, avec Magellan, et d’une profonde mutation de la connaissance du monde. Celle-ci encourage la critique d’une société en proie au doute et aux rêves d’âge d’or, au milieu de laquelle Luther apparaît comme une force de dissolution du monde chrétien.
Guillaume Frantzwa brosse avec talent les soubresauts de cette époque qui préfigure l’émergence d’un nouvel ordre mondial : celui de l’Europe moderne. "