Vous pouvez découvrir ci-dessous une chronique d'Éric Zemmour sur RTL, datée du 21 décembre 2017 et consacrée à la mise en place du gouvernement d'alliance entre la droite et l'extrême droite en Autriche...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Vous pouvez découvrir ci-dessous une chronique d'Éric Zemmour sur RTL, datée du 21 décembre 2017 et consacrée à la mise en place du gouvernement d'alliance entre la droite et l'extrême droite en Autriche...
Les éditions Le Retour aux sources viennent de publier un essai de Jean-Michel Vernochet intitulé La guerre civile froide - La théogonie républicaine de Robespierre à Macron. Journaliste, écrivain, ancien grand reporter au Figaro magazine, Jean-Michel Vernochet a notamment publié Iran - La destruction nécessaire (Xénia, 2012) et Les égarés - Le Wahhabisme est-il un contre islam (Sigest, 2013).
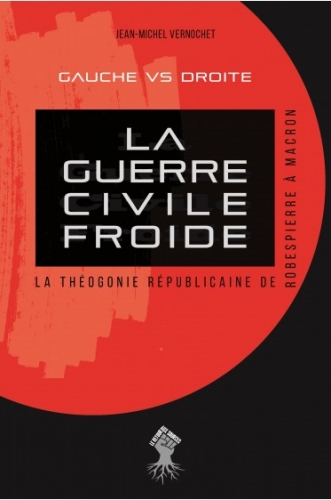
" Si les grands idéaux, Liberté, Égalité, Fraternité étaient restés ce qu’ils sont et ce qu’ils doivent être, des idéaux et non ce qu’ils sont devenus, des articles de foi et de loi, tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes républicains. Hélas des fanatiques, messianistes plus ou moins conscients, se sont mis en tête de faire tomber du ciel sur le plancher des hommes ces idéalités qui eussent dû y rester accrochées jusqu’à la fin des temps...
L’opposition entre les deux pôles droite/gauche incarne donc jusqu’à ce jour la guerre éternelle du Bien contre le Mal. D’un côté l’Homme nouveau, forcément jeune, surdiplômé, libéral-libertaire, urbain, habitant branché des métropoles, libre de préjugé, sachant jouir sans entrave ni temps mort, mobile, ouvert au monde et chantre du village planétaire. De l’autre, des beaufs ringards et repliés sur eux-mêmes avec leurs stéréotypes hérités d’un passé obsolète, peu éduqués, l’esprit encombré de vieilleries, statiques et sédentaires, en majorité ruraux ou provinciaux, à la mobilité intellectuelle réduite, hostiles et incapables de vivre le temps présent.
La guerre idéologique du XXIème siècle, après avoir opposé capitalisme et collectivisme, fait aujourd’hui se confronter le globalisme, soit la République universelle, aux Nations et aux traditions… "
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Antoine Savatier, cueilli sur Polémia et consacré à la nécessité pour la droite de mener un combat culturel... L'auteur est juriste et engagé dans la politique locale...

Pour un gramscisme de droite
La confusion règne dans l’offre politique actuelle. Les différents partis classés à droite de l’échiquier politique sont empêtrés dans des conflits internes qui recoupent, de manière évidente, des contradictions doctrinales. La droite politique est idéologiquement déboussolée, au point d’en oublier ce qui la distingue fondamentalement du camp adverse. « Quand on me demande si la coupure entre gauche et droite a encore un sens, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est que l’homme qui pose cette question n’est certainement pas un homme de gauche ! » remarquait Alain.
En effet, nul au sein de ce camp politique ne semble plus très bien comprendre à quelle vision de l’homme et à quelle philosophie sociale renvoient ces points cardinaux de « gauche » et de « droite ».
Les amalgames historiques ne facilitent pas les choses : Le libéralisme, né à gauche au XIXe, passé à droite au XXe siècle, revient aujourd’hui dans son camp d’origine. Le combat social, mené historiquement, aussi bien par la droite réactionnaire que par la gauche radicale, est supposé être l’apanage exclusif de la gauche. Par ailleurs, l’usurpation du qualificatif « de droite » par certains membres du personnel politique qui mènent des politiques authentiquement « de gauche », ou son rejet par d’autres qui défendent nonobstant certaines idées parfaitement « de droite », ne fait qu’aggraver cette confusion générale.
Pourquoi cette difficulté chez la droite à s’assumer ? A quelques exceptions notables, la médiocrité culturelle des représentants de la droite politique est affligeante, autant par leur méconnaissance des humanités que par la petitesse de leurs statures. Depuis un demi-siècle, aucun événement historique digne de ce nom n’a pu forger de caractère illustre. N’ayant guère connu pour leur pays, depuis leur naissance, que la paix et la prospérité, les cadres des partis de droite ont troqué la grandeur et le panache contre la gouvernance technocratique (croissance et Triple A semblent être devenus les moteurs de leur action) et le suivisme culturel (accueil des migrants, progressisme sociétal, etc.). Si, d’aventure, la droite parlementaire se pique de quelques propositions sécuritaires par-ci par-là, celles-ci sont davantage motivées par un esprit comptable et individualiste – garantir la propriété des biens pour jouir sans entraves – que par une vraie vision anthropologique, dont le bien commun serait la finalité.
En bref, la droite politique rechigne à endosser la doctrine et les symboles qui devraient être les outils de son combat. La gauche, quant à elle, assume fièrement son idéologie. Elle a eu l’intelligence stratégique de s’approprier, depuis Mai-68, tous les leviers du savoir et de la culture. L’hégémonie culturelle étant le préalable à toute victoire politique, elle n’a cessé dès lors de remporter ses combats les uns à la suite les autres. Son rayonnement a été si grand que la droite, faute de substrat idéologique, s’est elle-même laissé contaminer par l’idéologie de la bienpensance. Ainsi, il apparaît de plus en plus clair que c’est l’incurie culturelle de la droite qui est la cause de son insuccès politique.
Échecs politiques et droimmitude
Qu’on se le dise, depuis la Révolution française, le bilan politique global de la droite n’est guère éclatant. En 1815, après l’épopée napoléonienne, Louis XVIII s’assoit sur le trône. Embarrassé par les ultras qui se veulent « plus royalistes que le roi », le pragmatique souverain confie au duc de Richelieu la mission de renvoyer la très droitière chambre introuvable. La Restauration tourne au fiasco ; ce régime qui désirait « renouer la chaîne des temps » succombe en 1830, en conséquence de l’excès réactionnaire de Charles X. La Monarchie de juillet et le Second Empire décident de gouverner au centre, marginalisant de facto les représentants de la droite. Les débuts de la IIIe République rallument l’espoir monarchiste. Mais la médiocrité politique de Mac Mahon et l’idéalisme intransigeant du comte de Chambord ruinent de façon définitive le projet d’une ultime restauration. La sacralité des Bourbons est perdue. En 1889, la droite se trouve un nouveau cador avec le général Boulanger. Dans un style populiste, le militaire fait la synthèse du nationalisme et du socialisme. Mais, très vite, l’aventure boulangiste tourne au vinaigre, sur fond de scandales et de conflits internes. En 1924, les querelles intestines du bloc national (alliance entre libéraux, conservateurs et réactionnaires) entraînent dans les abîmes la chambre « bleu horizon ». Le cartel des gauches remporte la majorité, et plus jamais la France ne connaîtra d’assemblée aussi marquée à droite. L’appel au ralliement de Léon XIII (1892), la mise à l’Index des œuvres de Maurras (1926), enfin, l’excommunication des adhérents de l’Action française (1927), aggravent la déroute d’une famille de pensée dont la majorité des membres sont catholiques, et qui se trouvent privés, dès lors, de l’appui de Rome dans leur combat pour le trône et pour la nation. La dissolution des Ligues en 1936 libère un espace pour le Parti Social Français (PSF), premier parti de droite nationale « de masse » (quasiment 1 million d’adhérents), conservateur, antiparlementariste et d’inspiration catholique-sociale, porté par la figure du colonel de La Rocque. Le PSF voit son envolée électorale brisée par la défaite de juin 1940. Sous l’Occupation, la plupart des premiers résistants sont issus de la droite nationaliste, mais le régime de Vichy s’approprie hypocritement (1) les thématiques traditionnelles de cette famille d’idées (culte du chef, natalisme, retour à la terre, etc.), et des thèmes transversaux tirés de l’œuvre des anticonformistes des années 1930 ; entraînant ainsi la droite dans son discrédit.
En 1945, la Libération consacre le mythe d’une « gauche Résistante ». L’idéologie progressiste, incarnée par le PCF, la SFIO et le MRP, assimile toute conviction de droite au pétainisme. C’est l’avènement de la pensée unique. La gauche intellectuelle entreprend son œuvre idéologique : elle professe que « tous les anticommunistes sont des chiens », écrit des poèmes à la gloire de Staline, soutient la décolonisation et les massacres du FLN. Les soldats de l’armée française, puis les membres de l’OAS qui se sacrifient dans un combat désespéré pour la « mission civilisatrice de la France » et l’intégrité du territoire, sont voués aux gémonies par l’intelligentsia parisienne. Bientôt, les faiseurs d’opinion saluent les combats de Fidel Castro et la révolution culturelle maoïste. En mai 1968, ils proclament qu’il est interdit d’interdire. En 1981, dans l’emblématique L’Idéologie française, BHL fulmine la « France moisie », et ce peuple français de souche « collabo » à « l’esprit étriqué ». La génération Mitterrand réalise cette hégémonie culturelle de la gauche, portée sur les fonts baptismaux de la French theorie (Foucault, Deleuze) et de l’idéologie de marché (Hayek, Friedman) : dérégulation de l’économie, construction européenne, immigrationnisme, antiracisme, et bougisme sociétal. Pendant ce temps-là, la droite politique est à la ramasse.
En clair, il faut admettre que l’histoire politique de la droite est une inexorable litanie d’échecs (2) et de vexations. D’où cette névrose chez une famille de pensée qui a fini par intérioriser sa propre illégitimité, quitte à se laisser coloniser par les idées de gauche. En effet, depuis un demi-siècle la droite a pris l’habitude d’adopter les modes idéologiques – économisme, droit-de-l’hommisme, idéologie du progrès – qui ont historiquement affaibli toutes ses défenses immunitaires. C’est le fameux sinistrisme analysé par Thibaudet. Depuis quarante ans, les représentants de la « droiche », reconduits aux affaires par le biais du vote utile, s’évertuent à produire la loi Veil, le regroupement familial, les lois liberticides Pleven et Lelouch, la loi Rothschild-Pompidou, ou le Traité de Lisbonne, sans jamais remettre en cause les pseudo-acquis déconstructeurs du parti « du progrès », qu’ils intègrent si bien qu’ils finissent par les trouver désirables. C’est l’effet cliquet, qui permet de passer d’un cran à l’autre, dans un processus non-rétrogradable (3). Quel ténor de la droite parlementaire, qui a battu le pavé pour « sauver l’institution familiale » en 1999, oserait aujourd’hui remettre le PACS en question ? Laurent Wauquiez, le cador de la droite étiquetée « dure », qui n’a pas loupé une Manif pour tous, a déjà retourné sa parka rouge sur le mariage gay, et prépare, de façon sûre, d’autres prévisibles revirements.
La droite a renoncé à produire sa propre vision du monde
Depuis Mai-68, la droite s’est focalisée sur l’économie, et la gauche sur la culture. Jacques Julliard définit ainsi le Yalta culturel de la politique française : « A gauche le libéralisme moral et la réglementation économique, à droite la réglementation morale et le libéralisme économique ». Pour la droite, ce choix constitue un double écueil :
– d’une part, elle s’est laissée subjuguée par l’idéologie du marché, pourtant contraire à sa vision anthropologique (4). Dans son schéma l’homo œconomicus a pris la relève historique de l’homo politicus, disqualifié pour manque d’appétit consumériste. La droite des valeurs s’est fait avaler par la droite des affaires. Mauvais business, car le marché finit toujours par imposer sa logique individualisante, donc à terme libertaire, à la société ;
– d’autre part, elle a laissé à la gauche l’entière maîtrise du champ culturel. La littérature, la presse, l’université, le milieu artistique, etc., le gauchisme a pénétré tous les vecteurs de l’idéologie et de la culture. La droite authentique, ou ce qu’il en reste, y est ultra-marginalisée. Le camp du Bien s’est institué en pouvoir total, gardien de la parole autorisée, et fascisant tout ce qui ne correspond pas à sa vision du monde. A quelques exceptions notables, même la vraie droite semble terrorisée rien qu’à l’idée d’être traitée de « réac », de « facho » ou de « faire le jeu du FN ».
Elle a fini par croire que, pour faire passer son message, elle a l’obligation de se soumettre aux critères de respectabilité idéologique de la gauche. Or, qu’elle se proclame humaniste, partisane du progrès, qu’elle multiplie sans relâche les génuflexions face au dogme libéral-progressiste, elle ne sera pour autant, jamais, au grand jamais, admise au sein du cercle de la raison (5), tant la gauche est persuadée de la supériorité morale de sa cause ; et du caractère délictueux de toute idée qui ne vient pas d’elle-même. Ainsi raisonne-t-on à gauche, où l’extrême droite commence à partir de François Bayrou. Il serait temps de l’admettre et d’en tirer les conséquences.
L’épuisement culturel de la gauche
Si la domination culturelle de la gauche est toujours palpable, elle est en passe de changer de camp. La marche des idées s’est inversée. Depuis la chute du Mur de Berlin, divers facteurs : mondialisation incontrôlée, paupérisation de la classe moyenne, relativisme des mœurs, réveil brutal de l’islam, etc., ont largement contribué à discréditer la mythologie du progrès et de l’émancipation individuelle. La production des idées à gauche a cessé dans ses deux versions historiques : sociale et libérale.
Pour ce qui est de la gauche sociale, ses diverses tendances – anarchisme, trotskisme, communisme – datent, au mieux, du milieu du XXe siècle, souvent de la fin du XIXe. Le PC, encore à 15% dans les années 1980, réalise aujourd’hui moins de 3% des suffrages. Son électorat a en partie migré au FN. On continue, bon an mal an, de chanter l’International et de hisser le drapeau rouge à la Fête de l’Huma, mais tout ce charmant folklore dégage un parfum de naphtaline. Le PS, auquel Benoît Hamon a redonné une orientation sociale durant la campagne de 2017, n’est plus qu’un astre mort et doit vendre son siège de la rue de Solférino. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, réalise encore quelques succès électoraux, mais qui sont dus davantage à son charisme personnel qu’à ses idées – Etat dirigiste, collectivisme, lutte antifasciste – tout droit sorties des grandes heures de la IVe République. Les syndicats éprouvent un certain mal à mobiliser les travailleurs pour les manifestations anti-loi travail. C’est pire encore en ce qui concerne les mouvements d’ultragauche et altermondialistes qui, par leur attitude, laissent deviner combien ils sont aux abois : la violence aveugle des groupuscules antifas le dispute à la vacuité des fumeurs de pétards de chez Nuits Debout.
Dans sa version libérale, la gauche s’est en partie recyclée par le biais de Macron, dont le succès électoral est relatif : seuls 43% de l’ensemble des électeurs ont voté pour l’ex-banquier de Rothschild. A part quelques postures gaulliennes, qui durent le temps d’un selfie, on ne croit guère le macronisme capable de produire une nouvelle donne culturelle qui soit différente de celle du capitalisme, de l’intégration européenne, de l’immigrationnisme, dans la droite lignée de toutes les présidences françaises depuis Giscard ; le charme goldenboy, et la dimension high tech en plus. En bref, rien de philosophiquement révolutionnaire.
S’agissant des luttes sociétales « émancipatrices » qui sont assumées de façon plus ou moins cohérente par les deux gauches, tels la libération sexuelle, la théorie du genre ou le pédagogisme, elles proviennent toutes de la contreculture des sixties et des seventies. S’il est vrai qu’elles sont toujours défendues aujourd’hui, bec et ongles, par certains membres de la classe politique, on sent bien qu’elles ont épuisé le cycle de leur virtuosité. Il y a comme une redondance, une fatigue chez cette gauche militante, à faire admettre les fumisteries du gender et de l’éducation positive à des populations, notamment immigrées arabo-musulmanes, qui n’ont pas l’air excessivement enthousiastes.
Cette gauche culturelle, habituée depuis l’ère mitterrandienne à fréquenter les lieux du pouvoir, est définitivement sortie du jeu durant les pitoyables années du hollandisme. Elle s’est découverte sans doctrines, ni chefs, ni militants. Elle qui se célébrait comme gardienne de l’intelligence, patronne des vertus citoyennes, porteuse d’un avenir radieux, elle qui se glorifiait d’attirer des Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Yves Montand, doit reconnaître qu’elle ne rayonne plus comme avant. Seuls des Jacques Attali, Jamel Debouze et Benjamin Biolay peuvent encore prétendre au titre de compagnons de route du déclinant « parti de l’intelligence ». Pour la gauche, le bon vieux temps du confort intellectuel et moral n’est plus.
Gagner la bataille des idées
Le déclin de la domination culturelle de la gauche offre à la droite l’occasion de réinventer son substrat idéologique à partir d’une philosophie de l’enracinement. Beaucoup d’intellectuels, parfois issus de la gauche, ont développé certaines idées volontiers endossées par la droite : Alain Finkielkraut sur la crise identitaire, Régis Debray sur la problématique des frontières, Michel Onfray et sa critique de la modernité, etc. Pour autant, les appareils politiques se sont révélés inaptes à décliner ce travail intellectuel sur le plan électoral. Durant la campagne de 2017, « la droite et l’extrême droite n’ont pas réussi à produire d’idées nouvelles, se contentant de se reposer sur des acquis idéologiques engrangés dans le passé », analyse Gaël Brustier (6). Or, une majorité de Français (56% selon un sondage IFOP) s’affirment aujourd’hui de droite et s’accordent visiblement sur les thèmes essentiels : immigration, sécurité, TPE-PME, liberté éducative, etc. Ce peuple de droite, bien que sociologiquement divisé, a donc une réelle consistance. Comment lui donner une forme politique ?
Pour former une véritable alternative de droite, il faut d’abord gagner la plus élémentaire des batailles : celle des idées. Tant qu’elles ne seront pas dominantes et bien articulées dans les têtes, elles ne seront pas gagnantes dans les urnes. La droite doit penser une stratégie culturelle, un « gramscisme de droite », du nom de ce marxiste italien qui a théorisé la notion d’ « hégémonie culturelle », l’objectif étant de réunir la société politique et la société civile autour d’un projet cohérent. Dans Le Marxisme de Marx, Raymond Aron explique que la puissance politique de l’œuvre de l’auteur de Das Kapital est de pouvoir être expliquée en « cinq minutes, en cinq heures, en cinq ans ou en un demi-siècle ». La doctrine sophistiquée du marxisme a imprégné les mentalités de façon quasi religieuse, aussi bien dans sa version originelle socialiste (la lutte de la bourgeoisie contre le prolétariat) que dans son prolongement culturel contemporain, à savoir la lutte identitaire de tous les autoproclamant « dominé-e-s », quels qu’ils soient (femmes, homosexuels, migrants, etc.) contre tous les pseudo- « dominants » (patriarcat, hétérosexuels, peuple du pays d’accueil). A la façon du marxisme, il faut se donner les moyens d’édifier un corpus idéologique de droite, clair, efficace, fondé sur une vision du monde solidement charpentée. Il faut mener la guerre des mots, des symboles, des grands mythes mobilisateurs.
La présidentielle de 2007 fut une étape décisive. Sous l’influence de Patrick Buisson, le candidat Sarkozy assuma un positionnement droitier. Pour n’avoir pas lu Gramsci, Nicolas Sarkozy n’en saisit pas moins quelques rudimentaires ressorts lui permettant, dans un contexte d’appauvrissement du débat public, de réorganiser à son profit tout un univers symbolique. « Renverser l’héritage de Mai-68, rétablir l’autorité du prof, défendre l’identité nationale, etc. » furent les promesses inattendues du candidat UMP, au grand désespoir de nombreux cadres de ce mouvement qui désiraient mener campagne au centre. Démarche purement électoraliste, on le sait, car jamais ces paroles ne furent traduites en actions. Cela étant, la gauche fut horrifiée de se voir imposer ces nauséabondes thématiques. Comme le remarque Patrick Buisson, ce viol salutaire de l’idéologie bienpensante fut l’étincelle originelle, qui aboutit plus tard, en 2013, à la Manif pour Tous. La loi Taubira fut, en effet, le détonateur d’un grand mouvement social conservateur, qui draina plus d’un million de personnes dans la rue, et suscita tout un ensemble d’actions militantes (Les Veilleurs, Les Antigone, les Hommens, etc.) portées par des jeunes maîtrisant les codes de la communication. Le texte est passé. Jean-Christophe Cambadélis reconnut toutefois que, dans une perspective gramscienne, on peut parler d’une « défaite culturelle pour la gauche », qui semble avoir perdu le monopole des mouvements contestataires.
C’est bien à droite que se déroule l’agitation des idées. Les essais politiques majeurs de ces dernières années, signés Patrick Buisson, Eric Zemmour ou Philippe de Villiers, démontrent en quoi la submersion migratoire et le fondamentalisme de la modernité déstabilisent nos cadres de vie traditionnels, au point de menacer l’existence même de la France comme nation historique. Les progressistes n’ont plus le monopole de la pensée critique. Par ailleurs, la génération qui a moins de 40 ans est plus désinhibée ; elle ne souffre plus du complexe d’illégitimité de la droite. Le foisonnement des jeunes intellectuels militants – François-Xavier Bellamy, Eugénie Bastié, Alexandre Devecchio, Julien Rochedy ou Charlotte d’Ornellas –, l’émergence de médias alternatifs – la nouvelle revue l’Incorrect à la fois intello et rock’ roll qui assume son ambition d’unir les sensibilités de droite, la revue Limites reprenant pied sur le terrain de l’écologie, la revue d’idées Eléments, TV Libertés, Fréquence Orage d’Acier – ou encore des initiatives dédiées à l’activisme, comme Génération Identitaire, et à la formation, telles Academia Christiana, Renaissance catholique, la Fondation Polémia, Acteurs d’Avenir, etc., donnent de nombreuses raisons d’espérer.
Pour l’heure, il s’agit d’un foisonnement encore très parisien, assez intello, plus ou moins distant de la réalité d’une majorité de Français. Pour s’imposer, cette doctrine devra s’adapter aux enjeux contemporains, notamment écologiques et géopolitiques, et ne pas s’arc-bouter exclusivement sur des thématiques morales ou identitaires. Surtout, elle devra prendre la question sociale par les cornes, pour soumettre aux Français défavorisés une alternative crédible, tant au libéralisme qu’au socialisme, à travers une réflexion de fond sur la subsidiarité.
Cette jeunesse de droite doit enfin se soucier de mettre en adéquation son mode de vie avec ses idées. Il est toujours affligeant d’observer cette bourgeoisie dévote, racontée de façon ironique par la jeune romancière Solange Bied-Charreton (7), qui sort dans la rue pour défendre l’école libre et protester contre la loi Taubira, mais qui, par derrière, vote Macron et pousse ses enfants à s’inscrire dans les grandes écoles de commerce pour s’assurer qu’ils reproduiront bien leur réussite socio-économique. Dans cette démarche visant à fabriquer des winners, certains rejetons de bonnes familles admettent trop facilement la dilution de leurs valeurs. Il faut tuer le droitard qui est en soi. D’autres jeunes qui font le choix de devenir enseignant, artiste, journaliste, pour défendre et transmettre une noble vision du monde, au risque de casser l’ascension sociale de leurs parents, méritent à ce titre d’être salués.
Cap à tribord donc ! Il s’agit pour la droite de se prendre enfin au sérieux, et de concevoir une stratégie culturelle, un Kulturkampf, dont la finalité serait la conquête effective du pouvoir. Pour ce faire, elle dispose d’abondantes ressources intellectuelles. Il ne tient qu’à elle de transformer l’essai.
Ambroise Savatier (Polémia,30 octobre 2017)
Notes :
1/ Patrick Buisson, 1940-1945, Années érotiques. L’occupation intime, Albin Michel, 2011, 319
2/ Il serait malhonnête de ne pas citer les quelques victoires de la droite. C’est aux catholiques sociaux, qui s’opposent à la mise en coupe réglée de l’ouvrier par le capitalisme industriel, que l’on doit les premières lois sociales du XXe siècle. Et par ailleurs, sur le plan strictement régalien, le gaullisme redonna sa place à la grandeur nationale, à la continuité et au primat du politique sur l’économie, grâce à l’Etat stratège.
3/ Yves-Marie Adeline, La Droite impossible : essai sur le clivage droite-gauche en France, Ed. de Chité, 2012, 108 p.
4/ Il n’y a qu’à voir l’impasse des options économistes durant la campagne de 2017, qui furent celle de François Fillon, avec campagne Triple A, et celle de Marine Le Pen, qui subordonnait la réalisation de tout son projet à la question monétaire. Aucune de ces stratégies économistes n’a convaincu l’électorat.
5/ En finir avec le complexe médiatique de la droite face à la gauche
6/ Gaël Brustier : « Macron est l’intellectuel organique du nouveau capitalisme »
7/ Solange Bied-Charreton, Les visages pâles, Stock, 2016, 392 p.
Vous pouvez découvrir ci-dessous La semaine politique de TV Libertés, présentée par Elise Blaise, qui recevait François Bousquet, rédacteur en chef d’Éléments et auteur de La droite buissonnière (Rocher, 2017), pour parler de l'avenir de la droite...
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue intéressant de , cueilli sur Figaro Vox et consacré à la survie idéologique de la droite. est auditeur au Conseil d'Etat et maître de conférence à Sciences-Po.

La gauche a assumé l'abandon du peuple, la droite doit assumer celui des élites
«Car il m'est apparu que l'homme était tout semblable à la citadelle. Il renverse les murs pour s'assurer la liberté, mais il n'est plus que forteresse démantelée et ouverte aux étoiles. Alors commence son angoisse qui est de n'être point» (Saint-Exupéry, Citadelle)
Ainsi en est-il de la scène politique française, structurée autour d'une seule et même idéologie, celle de la déconstruction permanente.
Cette idéologie promeut le progrès conçu non comme surgissement d'une volonté dans l'histoire, mais, s'appuyant sur le confort matériel, comme un projet d'émancipation de l'homme contre toutes les formes de limites, quels que soient le sens de ces limites et la finalité poursuivie par celui qui vise à s'en débarrasser.
Elle emprunte la méthode spécifique de la table rase, où l'histoire n'est plus faite de tâtonnements mais de certitudes aveugles en vue de soumettre la réalité réticente de la matière, tant dans le domaine scientifique (transhumanisme) que politique («arracher l'enfant des déterminismes de sa famille» de V. Peillon).
Après son stade moderne, qui fut celui des mouvements collectifs (nationalismes, communismes), cette idéologie sera, au XXIe siècle, celle de l'agitation individuelle.
L'individu devient unique source et finalité de la société ; la conscience même d'un bien commun disparaît derrière le relativisme de groupes multiples organisés par leurs intérêts particuliers, réduisant la communauté de destin en un vaste marché mondial visant à l'épanouissement narcissique (Christopher Lasch) dont le politique ne serait qu'un secteur d'industrie.
La scène politique française, entre consensus idéologique et fractures sociologiques, menace de dislocation la droite dite «de gouvernement».
Dans la plupart des pays occidentaux, l'hégémonie culturelle de cette idéologie a creusé un fossé aujourd'hui presque sociologiquement figé, entre ceux qui en bénéficient et ceux qui en sont frustrés.
Si le cœur de l'élite «de masse» (20-30% de la population selon C. Guilluy) a retiré les fruits de la mondialisation et de sa vision individualiste et libertaire (pour faire court, le droit de jouir sans entrave), la généralisation de la «société de marché» a percé les frontières des États et celles de tous les corps sociaux protecteurs - familles, écoles, entreprises - pour les atomiser en gagnants et en perdants.
Ces derniers, ceux qui ne «sont rien» (la France périphérique, soit les 2/3 de la population, toujours selon C. Guilluy), cherchent aujourd'hui à prendre leur revanche en se tournant, soit vers Marine Le Pen pour se décharger sur d'opportuns boucs émissaires (la finance, l'Europe, l'immigration), soit vers Jean-Luc Mélenchon promettant davantage d'utopies libératrices en surfant sur la colère du peuple (revenu universel, etc.).
Cette déconstruction des nations entre centres et périphéries se retrouve partout ailleurs: en Angleterre avec la cartographie du «Brexit» opposant la Greater London aux autres régions du pays, ou aux États-Unis, entre les central states et les coastal states.
Chez nous, la carte des électeurs du premier tour des présidentielles est éloquente (métropoles vs. France des villes moyennes).
La droite s'est historiquement contentée d'être le bon gestionnaire de cette idéologie depuis 1968, soit par
désintérêt (elle s'est jetée à corps perdu dans le mondialisme et l'économie), soit par dégoût (c'est la bourgeoisie plus conservatrice qui se tourne vers la politique de proximité et se replie sur son entourage proche).
Elle s'est contentée de se fondre dans le paysage dessiné par l'idéologie de la déconstruction en tentant d'y apporter un semblant d'ordre et de bonne gestion financière: le débat politique de la droite lors des législatives s'est ainsi résumé, après la grande désillusion des présidentielles, à une querelle comptable de chiffres et de mesures paramétriques (baisse de l'IR, etc.) sans vision aucune.
Le consensus idéologique ambiant n'a donc jamais été remis en question ; bien au contraire, le libéralisme traditionnel de la droite s'est laissé glisser vers la quête de la jouissance servile aux mains d'un État devenu simple gestionnaire.
Or, les laissés-pour-compte de la mondialisation montrent qu'ils ne se satisferont plus des promesses de la gauche et du vide intellectuel laissé à droite.
À l'heure du Brexit, de Trump, de Podemos, du mouvement des 5 étoiles et du FPÖ, la ligne de partage politique n'est plus entre une pensée de droite et une pensée de gauche, indépendantes l'une de l'autre.
Le clivage n'est plus idéologique: il menace de ne devenir que sociologique, entre les gagnants et les frustrés du libéralisme libertaire. Le risque est de voir une telle opposition, qui ne se situe plus sur le plan des idées, se traduire par la violence la plus brutale - déchaînement des frustrations et de l'accumulation des rancœurs, entretenues par le système médiatique.
Entre En Marche, qui rassemble, dans un discours de gestionnaire rassurant, jeunes diplômés, immigrés et cadres des métropoles mondialisées, et Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui rivalisent d'irresponsabilités pour incarner la revanche des antisystèmes et des classes populaires, le «marché» électoral de la droite dite de gouvernement s'est, faute de discours cohérent, réduit comme peau de chagrin.
Pour survivre, la droite devra bâtir un discours autonome qui réinvestisse le champ du politique plutôt que celui du gestionnaire.
La recomposition actuelle du paysage politique français autour des deux extrêmes et l'apparition d'En Marche signeraient à terme l'avènement d'un grand parti centriste, majoritaire, mais traversé de courants profondément divergents et incohérents, constitué d'alliances de circonstances instables et ponctuelles rappelant les gouvernements de la IVe République.
Ce schéma risque de «satelliser» la droite en caution économique d'un programme qu'elle ne maîtriserait plus. Cependant, la faiblesse du score de MLP au premier tour des présidentielles, et les divisions internes du FN auquel les départs de Marion Maréchal-Le Pen et de Florian Philippot portent un coup, constituent une opportunité immense pour que la droite de gouvernement effectue, à l'occasion de ces prochaines années, le travail sur elle-même analogue à celui des conservateurs britanniques au milieu des années 2000 devant une gauche économiquement et sociétalement libérale, et des extrêmes qui prêchaient la révolution.
La gauche avait, en son temps, assumé l'abandon du peuple qui a tout perdu: la droite pourrait assumer celui des élites postmodernes qui ont tout gagné. L'urgence de la droite, face à son risque de dissolution, est de récupérer trois pôles: l'électorat populaire (attaché à des valeurs de responsabilité, d'autorité et percevant les ravages du libéralisme libertaire), l'électorat bourgeois des provinces et assimilé, souvent de culture catholique et sociale, et celui de la gauche dite «réac», chevènementiste.
Comme l'avait fait le think-tank Terra Nova dès 2011 en orientant cyniquement le PS vers l'électorat de la coalition des bobos et des minorités, il s'agirait ici pour la droite d'abandonner l'élite déracinée et déterritorialisée, qui aurait tout à perdre d'un changement de son discours, pour rassembler la bourgeoisie de province et les classes populaires dans une sorte de «Terra Nova inversé».
Ce Terra Nova inversé n'aurait pas pour objet de promettre une quelconque revanche, mais de proposer aux «perdants» économiques et culturels de porter un changement de paradigme.
Face à l'idéologie de la déconstruction qui rassemble pour mieux les déchirer les deux «camps» des gagnants et des perdants de la mondialisation libérale-libertaire, la droite doit bâtir un discours autonome et crédible.
Pour ce faire, elle refuserait de ne concevoir la nation que comme un agglomérat d'individus dont le politique n'aurait qu'à organiser l'interaction pour en maximiser l'épanouissement matériel ; et elle refuserait dans le même temps de promettre la «revanche» des classes populaires par des promesses intenables ou de verser dans le décroissantisme, marqueurs des deux extrêmes.
Refuser l'idéologie de la déconstruction, c'est à la fois refuser son matérialisme individualiste post-politique qui continue à atomiser la société en produisant des «gagnants» et des «perdants», et refuser sa méthode de la table rase surfant sur les fausses promesses et les colères stériles ; c'est assumer la nécessité pour toute société qui souhaite perdurer et vivre librement de protéger les trésors chèrement accumulés au fil des siècles.
C'est donc affirmer le besoin de transmission de notre culture, qui suppose un espace clos, un territoire, afin de générer la confiance et la fraternité nécessaires à l'existence d'une vie démocratique enracinée - d'une vraie démocratie, tout simplement.
Ce projet aurait à son cœur le rejet de l'émerveillement béat et des frustrations violentes, lui préférant l'enracinement dans le passé pour une projection vers l'avenir. Son maître-mot ne serait pas «construire», mais «grandir», y compris à partir du local, plus propice à l'élaboration apaisée de solutions concrètes aux véritables problèmes de fond.
La protection qu'il offrirait n'est pas refus du changement, d'où le rejet du mot-caricature de «conservatisme»: elle réhabiliterait l'idée que l'innovation n'est ni bonne, ni mauvaise, mais qu'il revient à notre volonté politique de la saisir comme une opportunité et de la maîtriser comme un danger.
C'est ainsi réhabiliter la place du politique, sa vocation à orienter plutôt qu'à accompagner les changements qui sont loin d'être inéluctables.
Ce serait donner envie aux Français de redécouvrir qu'ils peuvent encore, en tant que peuple, maîtriser les décisions qui ont trait à des sujets structurants pour notre avenir (écologie, transmission des savoirs et des valeurs, rapports à la mondialisation et au libre-échange, rapports à la technologie notamment quant à ses impacts éthiques et sociaux, etc.).
Ce serait donc leur permettre de reprendre goût à leur propre liberté politique.
«Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir», disait Simone Weil.
Cette refondation idéologique est à même de séduire l'électorat cible, mais aussi d'aller au-delà.
Pour les classes populaires ou moyennes, et la bourgeoisie dite de province, il s'agit de reconnaître la valeur d'une patrie en partage, ainsi que le capital immatériel que représente la «décence commune» dont parle George Orwell sans laquelle «l'unité politique n'est qu'une coquille vide» (M. De Jaeghere).
Mais c'est aussi un discours capable de rassembler d'abord les libéraux, au sens premier du terme - ceux qui aspirent à la protection des personnes contre l'arbitraire du pouvoir, ceux qui estiment qu'il appartient à chaque institution, Etat compris, de se cantonner à son rôle pertinent (notamment en matière économique),.
Mais aussi ceux qui reconnaissent que l'économie de marché ne fonctionne durablement - et n'est même historiquement apparue - que dans le cadre de communautés culturelles enracinées, assumant une certaine éthique, et structurées par des Etats-nations démocratiques.
Enfin, c'est un discours susceptible de séduire une partie de l'électorat préoccupé par la question sociale, en développant des politiques fondées sur la notion de responsabilité plutôt que sur l'humiliation d'un assistanat organisé: les Français veulent travailler et non vivre d'allocations ; ils veulent se sentir intégrés dans la société et pas sans cesse renvoyés à leurs origines par un discours victimaire et moralisateur.
Cette velléité de bâtir un nouveau parti de masse à droite, ni gestionnaire, ni démago, trouve de nombreux échos intellectuels et médiatiques, des anciennes gauche et droite: Finkielkraut, Brague, Debray, Gauchet, Onfray, Delsol, Polony.
A l'heure où ce combat culturel est mené avec brio, la droite, si elle ne veut pas disparaître, devra prendre le chemin de crête périlleux qui consiste à rejeter en bloc le confort d'une politique gestionnaire en s'affranchissant d'une idéologie qui lui aliène le nouveau cœur de son électorat putatif: les classes moyennes et populaires, et la bourgeoisie dite de province.
(Figaro Vox, 6 octobre 2017)
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Julien Rochedy, cueilli sur son blog et consacré au complexe dont souffre dans les débats les journalistes de droite face à leurs adversaires du camp du Bien...

En finir avec le complexe médiatique de la droite face à la gauche
Hier, la journaliste conservatrice Eugénie Bastié se fendait de quelques tweets expliquant qu’il lui était impossible de triompher dans un débat entre partisans et adversaires de la PMA, au prétexte que les « progressistes » se contentaient d’empiler les grands principes moraux (égalité, liberté, etc.) et les anathèmes en guise de rhétorique. Je me permettais de lui répondre que ce qui déterminait constamment leur victoire était simplement que la droite persistait de trembler face à ces mêmes anathèmes (toujours les mêmes : « réacs », « fachos », « extrémistes », « jeu du FN », « replié sur soi-même » etc.).
Pour préciser ma pensée, je parlerai de quelque chose que j’ai souvent remarquée dans ce genre de débats. La vérité est que les débatteurs comme Bastié ou Polony (pour ne citer qu’elles, mais il y en a beaucoup d’autres) arrivent aux différents débats une main attachée dans le dos quand, en face, les gants de boxes sont déjà enfilés. Le débatteur de droite (ou conservateur) veut se faire adopter par l’environnement hostile dans lequel il est plongé, et il pense pouvoir y parvenir en avançant des arguments rationnels, posés, et, croit-il, humanistes. Il aimerait par dessus tout que l’on reconnaisse son humanisme, que l’on écoute ses arguments, qu’on les soupèse, et qu’on le prenne ainsi pour un débatteur tout à fait respectable. Les dissonances cognitives aidant, il estime même « que c’est là tout l’objet d’un débat : s’opposer des arguments entre personnes respectables », tout en espérant secrètement être encore invité la prochaine fois. Conséquence de cette approche tendre, honnête et naïve : les progressistes triomphent à chaque fois. Pourquoi ?
Parce qu’en face, ils ne vont pas à un « débat », ils vont à la guerre. Leur religion est déjà faite et il n’y a que des infâmes ou des hérétiques qui peuvent s’opposer à eux. L’adversaire n’est, de nature, qu’un monstre d’extrême-droite, ou flirtant avec l’extrême-droite, dont les idées sont intrinsèquement nauséabondes. Dès lors, ils peuvent avancer tels des chars d’assaut, ils peuvent caricaturer, « jeter leurs anathèmes » pour parler comme Bastié, jouant à leur faveur de la morale gaucho-humanitariste, ou libéral-progressiste, qui préside dans l’essentiel des salles de rédactions parisiennes.
Les « progressistes » peuvent se montrer zélés : ils ne seront jamais traités d’extrémistes pour cela. Mais la droite, elle, se doit de servir ses arguments dans un service en porcelaine, car si, elle, s’amusait à railler, à caricaturer, à jeter également des anathèmes et à affirmer avec force des grands principes sans se soucier du bon ton et de la convenance, alors elle deviendrait immanquablement « extrémiste » dans la minute.
Quel est donc le secret pour finir par gagner (car il faudrait peut-être y songer, un jour…) ? En avoir plus rien à faire de leurs anathèmes. Mettre aussi les gants de boxe et taper violemment, comme eux. Alors oui, au départ, il y aura une avalanche de points godwin et d’indignations larmoyantes. Mais, en y regardant bien, les accusations d’ « extrémistes » ou de « fachos » ne reposent tellement plus sur rien de rationnel et de réaliste que le public, lui, ne tombe plus dans le piège. Une insulte n’a de puissance que dans le crédit qu’on lui attribue. Le jour où tous les débatteurs de droite n’auront plus peur des anathèmes et riront lorsqu’on leur les sert, la partie sera gagnée, et il y a fort à parier qu’ils finiront même par disparaître du paysage médiatique, ceux-ci ayant été démonétisés.
Des Eugénie Bastié, des Natacha Polony, et tant d’autres, sont brillantes et courageuses. Mais elles laissent toujours l’impression qu’elles s’excusent d’abord avant d’argumenter. A leur décharge (et j’en sais quelque chose, connaissant moi aussi comment le système médiatique fonctionne), adopter cette attitude est plus facile à théoriser qu’à pratiquer, car poser ses fesses sur un plateau de télévision est réellement intimidant. On ressent la lourdeur et le conformisme idéologique qui y règne. Toutefois, comme j’ai pu m’y essayer une fois ou deux, ou tel Eric Zemmour qui le fait régulièrement, avancer fièrement, ne s’excusant de rien, se moquer des adversaires et de leurs insultes, et assumer parfaitement qui nous sommes, vous procure des résultats sans commune mesure.
J’ajoute, pour finir, que quelles que soient les bonnes dispositions de ces journalistes et débatteurs, ils seront toujours détestés par leurs contradicteurs. Une Eugénie Bastié pourra toujours essayer de donner des « gages » de son objectivité et de sa respectabilité, elle sera toujours à leurs yeux une petite conne réactionnaire confinant avec « l’extrême-droite ». Dans ces conditions, pourquoi ne pas, enfin, lâcher les vannes, et en finir définitivement avec ce complexe médiatique qui nous laisse toujours pantois et éternellement perdant ?
Julien Rochedy (Blog de Julien Rochedy, 15 septembre 2017)