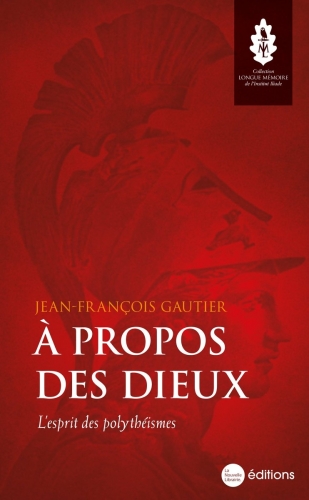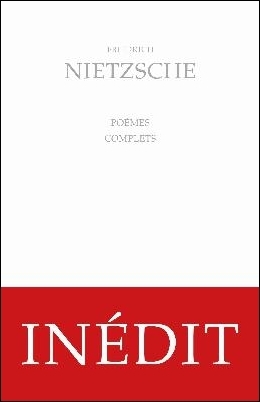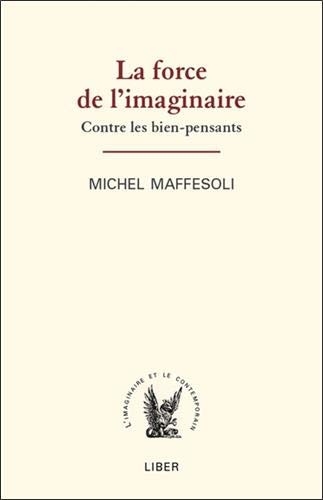Nous reproduisons ci-dessous un texte de Luc-Olivier d'Algange, cueilli sur le site d'Euro-synergies et consacré aux "dieux antérieurs"...
Écrivain, poète et essayiste, Luc-Olivier d'Algange a collaboré à de nombreuses revues, dont Nouvelle École, et a également participé à plusieurs Dossiers H, dont ceux sur Ernst Jünger, René Daumal et Dominique de Roux. Il est notamment l'auteur de Le déchiffrement du monde - La gnose poétique d'Ernst Jünger (L'Harmattan, 2017).

L'Ivresse et les dieux
Qu'en est-il des dieux antérieurs ? Peut-on, sans avoir à se dire «païen», recevoir d'eux quelque lumière ? Peut-on s'interroger, par leurs ambassades ouraniennes, maritimes ou forestières sur le monde tel qu'il s'offre à nos sens et à notre intelligence? Pouvons nous les entendre, ces dieux, dans l'acception ancienne du verbe, c'est-à-dire les comprendre, les ressaisir dans la trame de notre entendement où vogue la navette du tisserand, dieu lui-même, comme des réalités allant de soi, mues par elles-mêmes, pourvues de cet impondérable que l'on nomme l'âme ? Les dieux existent: c'est leur faiblesse car ce qui existe peut disparaître; ce qui existe n'est point l'être; et l'être lui-même n'est qu'à l'infinitif (or l'impératif seul est créateur !). Mais ce qui existe vaut tout de même que l'on s'y attarde... L'existence des dieux demeure difficile à situer car elle est ubique: à la fois intérieure et extérieure. Précisons encore. Les dieux sont ce qui se laisse dire comme une réalité qui est à la fois en dedans et au-dehors, subjective non moins qu'objective. Hélios éclaire à la fois la terre et notre intellect. Dionysos fait danser en même temps la terre et nos âmes. Apollon ordonne ensemble le Cosmos et nos pensées. Ces quelques notes, prises sur le vif, il y a déjà longtemps, s'interrogent sur cette « zone frontalière », avec les inconséquences désirables qui sont le propre du promeneur.
Longtemps, et il n'est pas vraiment certain que l'on se soit dépris de cette habitude, on associa l'intérêt pour le monde antique à un engagement « républicain » dont nos sociétés modernes (où la res publica, hélas, s'est évanouie dans le culte de l'économie) seraient les héritières. Le fidèle aux anciens dieux se retrouvait ainsi fort paradoxalement du côté de la modernité, des « réformes », voire d'une forme de « progressisme » opposée aux « ténèbres » du Moyen-Age et des souverainetés royales Or, on ne saurait imaginer forme de pensée plus étrangère aux Anciens que l'idéologie du Progrès. Toute leur pensée était au contraire orientée par le constat d'une dégradation, d'une déchéance, d'un éloignement graduel de l'Age d'Or. Comment cette pensée « pessimiste » fut à l'origine des créations les plus audacieuses en philosophie, de la plus grande plénitude artistique, c'est là une question décisive à laquelle il nous importe d'autant plus d'apporter une réponse que nous constatons que la croyance inverse, « optimiste », nous fait sombrer dans la veulerie et l'informe. Le Progrès, disait Baudelaire, est la doctrine des paresseux. N'est-ce point se dispenser d'avance de tout effort et briser tout élan créateur que d'assigner au seul écoulement du temps le pouvoir de nous améliorer ou de nous parfaire ? Au contraire, si, comme Hésiode, nous croyons au déclin, à l'assombrissement des âges, ne disposons nous point alors nos intelligences et nos âmes, notre ingéniosité et notre courage à faire contrepoids à ce déclin?
Pour une intelligence qui s'accorde aux présocratiques, le monde de la symbolique romane demeurera certes infiniment plus proche, plus amical, que la « société du spectacle » du monde des esclaves sans maîtres. Fidèles à la logique du tiers inclus, nous n'entrerons pas dans ces polémiques qui font du paganisme une sorte d'anti-christianisme à peine moins sommaire que l'anti-paganisme des premiers chrétiens, tel que le décrivent Celse et l'Empereur Julien. Si le combat du Poète contre le Clerc revêt à nos yeux quelque importance, comment n'engagerions-nous pas la puissante vision poétique et métaphysique de Maître Eckhart et de Jean Tauler contre les lugubres cléricatures de la «pensée unique»? De plus en plus vulgaire, utilitaire, éprise de médiocrité, l'idéologie dominante n'a jamais cessé de détruire la splendeur divine chère aux Archaiothrèskoi, les fidèles aux anciens dieux, alors même qu'elle paraît de temps à autres s'en revendiquer. Mais cet éloignement, n'est qu'un éloignement quantitatif. La qualité de l'être, sa vision, demeure, elle, subtilement présente.
Le monde des dieux anciens n'est pas mort car il n'est jamais né. Que cette pérennité lumineuse soit devenue provisoirement hors d'atteinte pour le plus grand nombre d'entre nous, n'en altère nullement le sens ni la possibilité sans cesse offerte. Pérennes, les forces et les vertus divines s'entrecroisent dans le tissu du monde et nous laissent le choix d'être de simples spectateurs enchaînés dans une représentation schématique du monde ou bien d'entrer dans la présence réelle des êtres et des choses par la reconnaissance de l'Ame du monde. Séparés de tout, enfermés dans une « psyché » qu'il croit être l' « autre » du monde, le Moderne s'asservit à la représentation narcissique qu'il se fait de lui-même.
Pour le Moderne, les dieux, les Idées, les Formes prennent source dans son esprit, mais il ne voit pas assez loin pour comprendre que cet esprit lui-même prend source ailleurs qu'en lui-même. Cette impuissance à imaginer au-delà du cercle étroit de sa propre contingence, n'est-ce point ce que les platoniciens nommaient « être prisonniers des ombres de la Caverne » ? Le Moderne idolâtre sa propre contingence, il en fait la mesure de toute chose, inversant le principe grec qui enseigne que l'homme doit retrouver la mesure de toute chose. Croire que les dieux sont purement « intérieurs », aboutit à une idolâtrie de l'intériorité. Les utopies meurtrières du vingtième siècle, le fanatisme uniformisateur et planificateur des fondamentalismes divers qui se donnèrent cours n'ont-ils pas pour origine ce subjectivisme effréné qui veut faire de l’intériorité de l'homme et de son incommensurable prétention d'être moral, la mesure du monde ? Pour l'homme ancien, les dieux sont en nous car ils miroitent en nous. Notre entendement capte les forces extérieures auxquelles il lui appartiendra, en vertu d'un principe de création poétique, de donner des Formes; et ces Formes, à leur tour, seront hommages aux dieux qu'elles nomment et enclosent pour d'autres temps.
Cette vue du monde est humble et généreuse, attentive et donatrice. Loin de penser l'homme comme l'Autre, ou face à l'Autre, elle reconnaît en soi le Même sous les atours de l'apparition divine. Le dieu est celui qui apparaît. Or l'homme, qui va à la rencontre du monde divin et ne connaît ni naissance, ni mort, apparaît à l'éternité et le dieu qui lui apparaît est selon l'admirable formule d'Angélus Silésius, « un éclair dans un éclair ». C'est dans l'éclat le plus bref et le plus intense que l'éternité nous est donnée. La fulguration d'Apollon demeure à jamais dans l'instant de l'apparition qui nous révèle à nous-mêmes, dans la pure présence de l'être.
Etres de lumière, les dieux; et non point êtres d'ombre, êtres de présence et non point êtres de représentation. L'apparition est l'acte du saisissement souverain où la vision se délivre de la représentation pour reconquérir la présence. Telle est la promesse, la seule, que nous font les dieux antérieurs. Ils ne nous promettent que d'être présents au monde, car aussitôt sommes-nous présents au monde que nous entendons leurs voix. Etre présent au monde, n'est-ce point déjà, dans une large mesure, être déjà désencombré de soi-même ? N'est-ce point devenir l'infini à soi-même ? Que suis-je qui ne soit à l'image des vastes configurations des forces du monde que nomment les dieux ?
Croire aux dieux, c'est croire que le monde intérieur et le monde extérieur sont un. La force lumineuse apollinienne se manifeste à la fois dans le soleil physique, qui épanouit la nature et le soleil métaphysique, le Logos, qui épanouit l'Intelligence. Le génie de l'ancienne sagesse est d'avoir donné un même nom à ces forces intérieures et extérieures, visibles et invisibles. Comment vaincre l'usure des temps, la transformation progressive de la vie en objet, la réification propre à la société marchande, sans le recours aux exigences et aux beautés plus anciennes? La diversité, la liberté, la complexité des anciennes sagesses, la précellence accordée aux Poètes, Bardes, Chantres ou Aèdes (qui sont les créateurs de la vérité qu'ils énoncent, à la différence du clerc qui administre une vérité déjà définitivement formulée) nous demeurent une injonction permanente à ne point nous soumettre. Le monde moderne paraît triompher dans ses vastes planifications, mais il est bien connu qu'il existe des triomphes dont on périt.
Le « déterminisme » dont les Modernes se rengorgent n'est probablement qu'une vue de l'esprit, particulièrement inepte, qu'un peu de pragmatisme suffirait à corriger. Là où le Moderne voit un enchaînement nécessaire, ce qu'il nomme un « progrès » ou une « évolution », un esprit libre ne verra qu'une interprétation à posteriori. La suite d'événements qui conduisent à un désastre ou à une circonstance heureuse, selon l'interprétation qu'on lui donne, n'apparaît précisément comme « une suite » qu'après coup. Cette suite, que la science du dix neuvième siècle nomme déterminisme, apparaît à l'intelligence dégagée et pourvue de quelque imagination, comme un leurre. Dans la vaste polyphonie humaine et divine, les choses eussent pu se passer autrement, et de fait, elles ne cessent de se passer autrement. Les configurations auxquelles elles obéissent engagent non seulement la ligne et le plan, mais aussi les hauteurs et les profondeurs.
Apollon et Dionysos, par exemple, se manifestent par une logique différente de celle de la planification ou de la linéarité. Apollon fulgure des Hauteurs et s'épanouit dans l'ensoleillement intérieur des Formes parvenues à l'équilibre parfait. Dionysos, lui, selon la formule d'Euripide, fait danser la terre. « Quand Dionysos guidera, la terre dansera » chante le chœur des Bacchantes. La formule mérite que l'on s'y recueille. Ce recueillement est recueillement dans la légèreté. La terre dionysiaque n'est plus la terre lourde, immobile, des gens « terre à terre », c'est la terre vibrante, la terre mystérieuse, la terre gagnée par le Symbole aérien de l'excellence: la danse, victoire sur la pesanteur.
Dans le temps et le monde profane, la pesanteur est ce qui nous attache à la terre, nous ferme le royaume du ciel, le séjour des dieux. Dans l'espace et le temps sacré, sous le signe de Dionysos, les forces telluriques elles-mêmes nous délivrent de la pesanteur: la terre danse. Notre danse sur cette terre gagnée par les puissances phoriques du sacré, est la danse de la terre elle-même. L'ivresse nous accorde au monde.
Cet accord, certes, ne préjuge point d'ultérieurs désaccords. L'accord au monde que suscite l'ivresse n'est pas une béatitude définitive, il n'est pas davantage une approbation sans limite. La face sombre du mythe dionysien, comme du mythe orphique, témoigne que l'accord est la conquête d'un dépassement de la condition humaine ordinaire, avec toutes les audaces, les périls, mais aussi les enchantements qu'implique un tel dépassement. La part dangereuse de l'ivresse n'est pas seulement dangereuse pour l'individualisme, elle est aussi dangereuse pour l'ordre social lorsque celui-ci ne parvient pas à lui donner la place qui lui revient.
Le génie grec fut d'avoir donné au mystérieux et inquiétant Dionysos une place centrale dans la mythologie. Alors que les fondamentalismes modernes paraissent être avant tout des expressions humaines de la crainte devant les dionysies de l'âme et du corps, les mythologies anciennes surent réserver au sens de la dépense pure et à l'exubérance festive, la part royale. Dans la mythologie grecque, Dionysos est souvent nommé, à l'égal de Zeus, « le maître des dieux ». C'est que l'infinie prodigalité de l'ivresse est à l'image de l'inépuisable richesse du monde des dieux.
Aux valeurs d'utilité, de thésaurisation, l'ivresse oppose le Don rendu à son ingénuité native. Lorsque Dionysos guide, les identités sont bouleversées. Ce qui, dans la temporalité profane, nous circonscrit dans l'espace-temps dont nous tenons nos identités, est ici remis en jeu sous l'influx des forces du devenir. Dans les époques bourgeoises, les êtres humains qui ne savent conquérir de nouvelles vertus sont de plus en plus attachés à leur identité, mais cet attachement est mortel, car l'identité n'est qu'une écorce morte et seule importe la tradition qui irrigue, traverse et bouleverse les apparences comme une rivière violente. Lors des dionysies, les identités profanes sont mises à mal et une force de renouvellement saisit l'être, le désencombre de ses écorces mortes, l'expose à nouveau aux aventures. Pour les hommes épris de leur statut, pour les hommes imbus de leurs certitudes, les dionysies sont la pire des menaces. En revanche, pour le poète, voire pour l'homme qui désire faire de sa vie un hommage au Beau et Vrai, les dionysies sont une promesse. Les certitudes qu'elles détruisent dans leur emportement, les identités dont elles révèlent le mal fondé ne sont que des leurres qui font obstacle à l'expérience de la vérité de l'être.
Le resplendissement de l'être, dont les dieux sont en ce monde les messagers, ne cesse, dans les conditions profanes de l'existence, d'être voilé, recouvert de scories qui sont autant d'habitudes mentales. C'est en nous délivrant de ces habitudes mentales par l'apport de la vigueur donatrice de l'ivresse que nous recouvrons une vision de la réalité qui n'est plus une vision instrumentale mais ontologique. L'ivresse nous révèle le monde non plus tel que nous l'utilisons ou le planifions, mais tel qu'il est dans l'ouragan de l'être se révélant à lui-même. Quittant les évidences illusoires de l'identité, nous nous retrouvons au centre d'un jeu de forces dansantes qui nous portent témoignage de l'être que nous méconnaissions.
L'ivresse, lorsque Dionysos en personne guide la danse est connaissance. Le monde devant lequel nous passons habituellement, comme devant un spectacle qui ne nous concerne pas, s'impose à nous, retentit en nous, nous exalte et nous effraie tour à tour. L'homme en proie à l'ivresse, ou mieux vaudrait dire, à une ivresse (car il existe autant d'ivresses que de couleurs et même de nuances à l'arc-en-ciel) est enclin à voir dans les choses des Mystères. Les arbres deviennent des arcanes. Les ciels et les mers s'offrent à lui comme de lancinantes interrogations. Les forêts sont bruissantes de présences, et les villes elles-mêmes deviennent des Brocéliande. Mais par dessus tout, les mots acquièrent une puissance et une résonance nouvelles.
Le dithyrambe dionysiaque fête les retrouvailles de l'homme avec les sources de la parole. Car la source de la parole n'est pas dans l'utilisation du réel mais dans sa célébration. Ces mots qui, dans le langage profane sont des écorces mortes, de vaines identités, la puissance dionysiaque va leur rendre la magie invocatoire. Là où le monde est rendu à la présence de l'être, le mot résonne infiniment dans l'âme humaine. Le mot n'est pas étranger à la réalité qu'il nomme, il est le site magique de la rencontre de l'homme et du monde. L'ivresse dionysiaque désempierre la source de la parole. De tout temps, le génie verbal eut partie liée avec l'ivresse. La pauvreté de la parole, la ladrerie de l'expression (que certains critiques modernes vantent sous l'appellation « d'économie des moyens ») qu'est-elle d'autre sinon une crispation sur les évidences, un refus de se laisser gagner par les vastes exactitudes de l'ivresse. Les belles éloquences sont les œuvres du consentement à l'ivresse, de l'accord souverain de l'âme et du corps. La parole, lorsqu'elle se fait rythme et musique et entraîne avec elle la pensée en de nouvelles aventures, naît de l'accord de l'âme et du corps. Lorsque l'âme et le corps sont désaccordés, la parole se fige et s'étiole.
La culture du ressentiment, anti-dionysienne par excellence, répugne à ces preuves magnifiques de la concordance de la hauteur et de la profondeur. La parole, elle la veut « écriture » et « minimaliste », c'est-à-dire aussi peu enivrée que possible, comme si l'ivresse, qui bouleverse les identités, était le Mal par excellence. Les œuvres d'André Suarès, de Saint-John Perse ou de John Cowper Powys sont de magnifiques défis à cette culture du ressentiment dont les seules « valeurs » irréfutables sont la mesquinerie et le calcul. Le « rire des dieux » dont parle Nietzsche est fait précisément pour effaroucher le « bien-pensant », pour montrer le comique foncier des « valeurs », et leur inanité face aux Principes et la puissance dont se compose la polyphonie du monde.
Le Moderne, soumis au principe d'identité, est foncièrement attaché aux « valeurs » alors que l'Archaiothrèskos est fidèle aux Principes qui seront dans la geste éperdue des extases, principes de métamorphoses. Protéenne, l'ivresse invente des formes là où l'identité se contente de reproduire des formes. L'ivresse change, l'ivresse transfigure, là où le principe d'identité profane se limite à la duplication quantitative. L'ivresse crée des qualités. Elle inaugure l'ère, sans cesse reportée mais sans cesse sur le point d'advenir, du qualitatif. Toute perception d'une qualité est prélude d'ivresse. La qualité appartient à l'ordre de l'indiscutable. Celui qui ne la perçoit point ne saurait en parler. Perçue, la qualité suscite une interprétation infinie. L'herméneutique de la qualité est sans limite, alors que la quantité, aussi considérable soit-elle, se définit d'emblée par sa limite. La quantité est limitée, la qualité est infinie. L'ivresse dionysiaque est principe de poésie car elle invite au registre des harmoniques qualitatives du monde. Le souffle s'accorde à l'idée et le poème naît de ce « rien » qui est la chose elle-même rendue à la souveraineté de l'être. Les Mystères orphiques ou dionysiaques n'ont d'autre sens. Le moment du mystère est celui où l'être apparaît sous les atours de la réalité. Mystère car le site d'où se déploie le chant est celui de l'être irréductible dont aucune explication logique, ou grammaticale, ne peut s'emparer. Ce Mystère n'est point le mystère des « arrière-mondes », il ne relève pas davantage de cette sorte d'occultisme qu'affectionnent les Modernes. C'est le Mystère de la chose rendue, enfin, après la traversée odysséenne du Chant, à son propre silence.
Or, nous ne pouvons dire les choses que si nous recevons en nous, comme une promesse, le silence dont elles émanent. Longtemps, les sciences humaines feignirent de croire que les dieux n'étaient que de maladroites explications, dont on pouvait désormais se passer, des phénomènes naturels. Le dieu, en réalité, est ailleurs. Il n'explique pas, il nomme, et il nomme avec une pertinence telle que nous n'avons pas jusqu'à présent trouvé mieux que les noms des dieux, et les récits de leurs aventures, pour décrire les aléas de l'âme et du monde. Dire que la croyance aux dieux est morte avec le christianisme, c'est se faire de cette croyance, et de la croyance en général, une bien pauvre idée. L'exubérance, la prodigalité, l'ivresse ne meurent pas sur un décret, fût-il « théologique ». Leconte de l'Isle, par son goût pour la plénitude prosodique, les espaces grands et profonds, les symboles augustes, retrouve naturellement une part du génie ancien. La fidélité aux dieux antérieurs loin d'être une construction artificielle renoue avec une tradition qui ne fut jamais vraiment interrompue. L'éloignement des sagesses anciennes, leur supposée incompréhensibilité pour nous « Modernes », apparaît de plus en plus comme un vœu pieux que la plupart des œuvres d'art, de littérature ou de poésie modernes démentent avec ardeur.
Les dieux virgiliens frémissent dans la Provence de Giono avec une évidence que la morale chrétienne, pour louable qu'elle soit à certains égards, ne saurait leur ôter. Celui qui veut connaître l'être comme une présence, et non comme un concept, voit paraître les dieux qui nomment et racontent les aspects et les forces du monde réel qui échappent à toute utilisation possible. Nous pouvons ainsi reconnaître la pertinence herméneutique du récit mythique, son aptitude à dire ce qui advient en ce monde dans l'obéissance à des lois que nous ne comprenons pas entièrement. Les dieux décrivent une connaissance et disent en même temps les limites de la connaissance. Les dieux, certes, régissent, mais l'homme consent à la limite de sa science en disant qu'il ne sait pas exactement de quelle façon les dieux régissent. On ne saurait attendre une plus heureuse pondération de la part d'un physicien actuel. Le dieu ne dit pas la cause d'un mécanisme, il nomme le mécanisme et tout ce qui dans son antériorité ou sa postérité ne révèle rien d'évaluable.
Si nous acceptons de reconsidérer cette terminologie divine dans la perspective de nos propres préoccupations herméneutiques, nous allons au-devant d'heureuses surprises. Qui n'a constaté que la faiblesse de maints systèmes d'interprétation tenait d'abord à la scission entre l'intérieur et l'extérieur, l'objet et le sujet ? Dans l'épistémologie moderne, la science du monde intérieur et la science du monde extérieur paraissent séparées par des barrières infranchissables. Or, chacun sait que le monde intérieur conditionne la connaissance du monde extérieur, et inversement. Il n'en demeure pas moins que les sciences de l'Ame et les sciences de la « physis » se développent de façon séparées et marquent l'une à l'égard de l'autre une indifférence immense.
Le génie du paganisme et des récits mythologiques fut de formuler la connaissance du monde dans une terminologie qui concernait simultanément le monde physique et le monde l'Ame. Loin d'être au-delà de la science, cette recherche d'une coïncidence de l'intérieur et de l'extérieur semble désormais au diapason des recherches contemporaines. Pourquoi faudrait-il tenir en des catégories radicalement séparées ce qui ordonne le monde et ce qui ordonne l'esprit ? Cette obstination dualiste n'est-elle pas la cause du désemparement où nous sommes ? Le triomphe de la technique extérieure et l'absence totale de maîtrise de soi, de discipline intérieure, où nous voyons nos contemporains n'est-il point la preuve de l'inefficience de cette pensée dualiste ? Le dieu antique nous parle car il parle d'un site qui ignore la séparation de l'en-dehors et de l'en-dedans.
Dans les mythologies hindoues, grecques, celtiques, les principes intérieurs et les principes extérieurs ne sont pas jugés de nature différente. Ils sont des degrés différents, non des natures différentes. Nous avons traité ailleurs de l'erreur d'interprétation fort commune, qui voit dans l'œuvre de Platon une « séparation radicale » entre l'Idée et le monde sensible, là où Platon parle d'une « gradation infinie ». De même, les dieux ne sont pas radicalement séparés du monde. Ils sont eux-mêmes gradation infinie, messagers, principes de variations infinies, reliés à d'autres principes selon la loi de l'analogie qui gouverne le monde et nous enseigne que, dans la présence de l'être, rien ne se crée et rien n'est perdu. Les dieux témoignent de l'éternité de nos âmes, de nos pensées comme ils témoignent de l'éternité du monde.
Maître des ivresses, Dionysos nous invite à une expérience du temps dégagé de toute servitude linéaire. L'ivresse dionysiaque est la première, et la plus immédiate, des approches du temps modifié. Par l'ivresse, la temporalité devient chatoyante, complexe, variable selon des données métaphoriques et poétiques dont l'imagination est alors la maîtresse souveraine. L'accélération et l'exacerbation des idées, la fougue des sentiments et de l'imaginaire, les puissances démultiplicatrices de l'ivresse subvertissent l'illusion du temps mécanique et du temps quantifiable. Lorsque Dionysos mène la danse, l'âme bondit de qualités en qualités, d'intensités en intensités, si bien que le temps devient semblable à un espace résonnant d'échos et miroitant d'apparitions, toutes moins prévisibles les unes que les autres. L'univers entier devient alors le théâtre de cette fête dithyrambique. Pleine d'intersignes, de manifestations brusques, d'illuminations, au sens rimbaldien, la temporalité dionysiaque est une temporalité illuminée.
La lumineuse construction apollinienne n'est pas moins dégagée du temps linéaire que la fougue dionysiaque. Dionysos lutte encore avec le temps linéaire comme avec un ennemi, alors qu'Apollon domine toutes les temporalités de son évidence sculpturale. L'erreur d'interprétation la plus commune croit tirer avantage de l'intemporalité des dieux pour conclure à leur inexistence, car, selon l'historiographie profane, seules existent les choses et les créatures soumises au temps. Certes, tout ce qui tombe sous nos yeux semble soumis au temps. N'est-ce point parce que nous sommes soumis au temps que nous croyons voir dans les choses la marque de cette soumission ? N'anticipons-nous point arbitrairement de la nature des dieux par la connaissance de nos propres infirmités ? Nous passons à travers les apparences vers une extinction plus ou moins certaine et nous en concluons à la fugacité de toute chose. N'est-ce point sauter directement de la prémisse à la conclusion et faillir aux exigences élémentaires de l'exactitude philosophique ? L'ivresse, en nous délivrant de nos affaires trop humaines, de nos préoccupations mesquines, et des conditions qui nous enchaînent, nous laisse enfin face au monde réel que nous ne nous croyons plus obligés, alors, d'assujettir aux circonstances qui voient nos limites et nos défaites. Les théurgies anciennes, néoplatoniciennes et orphiques, prescrivaient de sortir de soi-même par l'extase afin d'accéder à la vision. Ce n'est que délivré des conditions de la nature humaine que nous pouvons voir. L'extase visionnaire fut ainsi longtemps considérée comme un instrument de connaissance.
Connaître par l'extase, voir par l'extase, loin de ramener l'homme vers la subjectivité ou l'intériorité, était alors un moyen de voir le monde hors des limites ordinaires de l'entendement humain. La mesure de l'homme ne devient la mesure du monde, du Cosmos, que si nous acceptons de nous abandonner à l'Odyssée de la pensée et de l'Ame. L'exigence épique n'est pas radicalement différente de l'exigence philosophique. Empédocle rejoint Homère dans la célébration de l'areté, cette vertu fondamentale qui dégage l'homme de la soumission banale aux phénomènes. L'éthique héroïque est une éthique du dégagement qui peut aller jusqu'à paraître désinvolture. La vision sera d'autant plus juste, et d'autant plus riche d'enseignements, qu'elle sera plus inhabituelle, mieux dégagée des conditions ordinaires de l'existence. De même, par ses instruments, explorateurs de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, par ses audacieuses hypothèses mathématiques, le chimiste et le physicien usent de méthodes qui invitent le regard à voir la réalité sous un jour radicalement différent de celui auquel elle se propose dans la vie quotidienne. Ce que le physicien nous apprend de la nature du Temps, depuis Newton, contredit l'expérience que nous en faisons dans la succession de nos travaux et de nos jours. Le Théurge des Mystères dionysiens ou orphiques n'agissait pas autrement en faisant de l'expérience visionnaire, qui rompt les logiques de la perception profane, une source de connaissance. Seul le point de vue inhabituel peut nous renseigner sur la nature de l'habituel. La « sur-temporalité » du monde divin qui se révèle dans la vision du Théurge délivre de la prison de la subjectivité, qui ne voit en toute chose que sa propre image insignifiante et périssable.
Dans les civilisations de masse, soumises à la loi du plus grand nombre et au règne de la Quantité, il est de coutume d'expliquer le supérieur par l'inférieur. Ainsi le désintéressement et les comportements humains, qui participent de la vertu donatrice, sont-ils soumis à la suspicion de l'inférieur qui cherchera les motifs intéressés là où s'exerce librement un génie dispendieux. De même, l'inspiration divine, l'extase visionnaire, les hautes opérations de l'entendement auxquelles nous convie la Théurgie orphique seront-elles soumises, par la critique profane, à la « subjectivité » ou justiciables d'une psychologie plus ou moins naturaliste. Dans un ordre plus récent et plus restreint, l'œuvre littéraire et son auteur, lorsqu'ils ne bénéficient point, en espèces sonores et trébuchantes, des fruits de leur labeur sont invariablement taxés de vanité. L'inaptitude du Moderne à voir au-delà du cercle étroit de ses intérêts les plus immédiats lui ôte d'emblée toute compétence à juger de la poésie et de la métaphysique. Il s'agit là moins d’une question de culture que d'orientation intérieure. Le monde auquel l'ivresse porte atteinte laisse place à de plus subtiles constructions où la multiplicité des états de conscience dévoile la multiplicité des états de l'être.
Les cultes grecs tardifs, les philosophies hermétiques, loin d'être seulement les éléments décadents d'une civilisation destinée à laisser place au christianisme, paraissent ainsi à celui qui s'y attache avec une certaine déférence, d'une richesse exceptionnelle. Les Hymnes Orphiques, dont une traduction nouvelle et musicale a été donnée par Jacques Lacarrière, témoignent d'une ferveur ancienne et portent en eux le témoignage des plus lointaines méditations grecques. De même le Discours sur Hélios-Roi de l'Empereur Julien, Les Mystères égyptiens de Jamblique, les fragments pythagoriciens, loin de témoigner d'une corruption des sagesses anciennes en révèlent certains aspects probablement maintenus cachés jusqu'alors, la discipline de l'arcane se levant, par exception, en ces périodes pressenties comme ultimes.
Si ces témoignages ne sont que lubies ou médiocres compilations, alors, en effet, le christianisme le plus exclusif et le plus administratif prouve sa nécessité. En revanche, si les ultimes formes libres du paganisme sont diaprées de sens et de beauté, si nous pouvons entendre et laisser miroiter en nous ce sens et cette beauté, alors, rien n'est joué. La perspective traditionnelle, à laquelle certains des plus éminents auteurs catholiques se sont ralliés, incline à croire que la Sagesse n'est point datable, « qu'elle naît avec les jours » selon la formule de Joseph de Maistre, et que les formes religieuses les plus anciennes sont aussi les plus lumineuses ambassadrices de la lumière d'or des origines. Ces conceptions, ennemies de toute exclusive religieuse, étaient partagées par les fidèles aux dieux antérieurs. Si le centre du temps est l'origine du monde, alors toutes nos formulations sont des points sur la périphérie, horizon d'éternité que rien n'altère, qu'aucune obsolescence ne menace fondamentalement.
Le génie du paganisme tardif fut d'avoir transposé dans l'ordre du secret, en vue d'une transmission de maître à disciple, les vastes certitudes des dieux afin de garantir leur survie en « ces temps de détresse » qu'évoquait Hölderlin. L'orphisme, le pythagorisme, les poétiques dionysiennes, alexandrines, hermétiques, ne sont pas du paganisme « pré-chrétien », mais du paganisme rendu subtil, en vue d'une traversée historique pleine d'incertitudes. Si les polémiques contre le christianisme, surtout sous la forme vulgaire qu'affectionnent les Modernes, nous semblent vaines (un cloître roman demeurant plus proche, par la forme et le fond, du temple d'Epidaure que de n'importe quelle construction moderne, fût-elle « néo-classique », issue de l'hybris moderniste) nous garderons à cœur, en revanche, de ne rien céder des ferveurs anciennes à l'illusion d'un quelconque « progrès ». Si le génie grec persiste dans l'architecture romane, il persiste aussi ailleurs, avant et après. La similitude entre la fin de l'Empire et l'actuel déclin de l'Occident est trop évidente pour n'être pas de quelque façon fallacieuse.
Certes, l'Occident sombre, et l'arrogance occidentale est mise à mal, mais voici bien longtemps que cet Occident-là, voué au dogme bicéphale de la marchandise et de la technique n'est plus que la subversion des principes fondateurs des Cités et des Empires dont nos arts et nos philosophies furent les héritiers. Voici bien longtemps que le génie de l'Europe et les destinées historiques de l'Occident ne coïncident plus en aucune façon, et souvent paraissent, aux observateurs les plus avisés, antagonistes. Le génie de l'Europe n'a pas disparu avec le triomphe historique de l'Occident mais il est devenu secret, apanage des individus audacieux qui surent résister à la planification et à l'uniformisation.
Le vingtième siècle restera dans l'Histoire comme le siècle de la destruction programmée de toutes les cultures traditionnelles. L'Occident fut destructeur de la magnifique culture chevaleresque et visionnaire des Indiens d'Amérique parce qu'il avait déjà renié en lui-même le génie européen. Pourquoi serions-nous solidaires de ce qui nous tue ? Poètes, artistes, ou amoureux des grandes heures, des ivresses dionysiennes et des songes apolliniens, pourquoi notre destin se confondrait-il avec le titanisme d'un pouvoir qui se fonde, selon l'excellente formule de Heidegger, sur « l'oubli de l'être » ? Le génie de l'Europe est fidélité aux dieux, le destin de l'Occident est la soumission aux Titans. Lorsque, selon la formule de Drieu « les Titans à genoux raidissent leur buste », ce ne sont point les dieux qui rêvent leur défaite mais le règne d'une force mécanique, aussi insolite que destructrice et passagère. Certes, des milliers de destinées humaines peuvent encore s'y briser, mais le simple regard d'Athéna qui se pose sur nos tumultes, si nous en prenons conscience, éloigne déjà tout ce dont nous souffrons dans les limbes des erreurs passées. Quoiqu'il advienne, les dieux nous précèdent. Les dieux ne sont pas dans notre passé, c'est nous qui sommes dans le passé des dieux et qui nous efforçons de les rejoindre.
Luc-Olivier d'Algange (Euro-Synergies, 27 avril 2024)