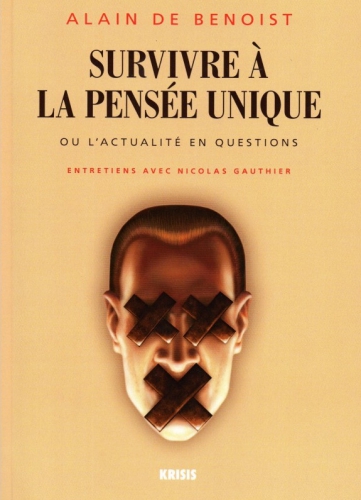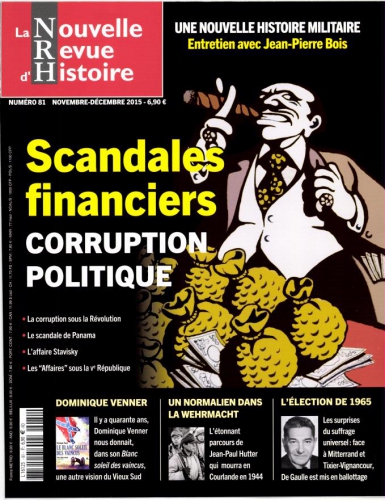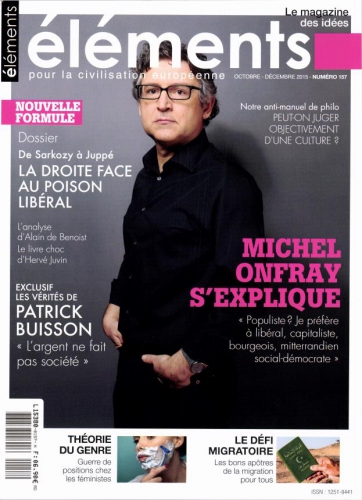Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à l'intervention russe en Syrie...

« Quand la France comprendra-t-elle que la Russie est notre allié le plus naturel ? »
Depuis quelques semaines, on assiste au grand retour de la Russie sur la scène internationale. Ce qui ne fait apparemment pas plaisir à tout le monde. Est-ce un pas vers le monde multipolaire à venir ?
La déclaration de guerre de la Russie à Daech est un fait de première grandeur. En s’imposant comme un acteur incontournable dans la question syrienne, elle prend de court les États-Unis et leurs alliés. Par son réalisme, son sens géopolitique, son intelligence stratégique, Vladimir Poutine confirme ainsi le statut de puissance internationale de la Russie. Mieux encore : il est en train de constituer, avec l’Iran, la Chine et d’autres pays émergents, un bloc eurasiatique qui bouleverse toute la donne géostratégique. L’OTAN doit désormais compter avec l’Organisation de coopération de Shanghai. C’est en effet un pas vers l’émergence d’un monde multipolaire, c’est-à-dire un rééquilibrage des rapports de force dans le monde.
On verra dans les prochaines semaines comment évolue la situation sur le terrain. Mais on voit bien dès maintenant que, contrairement à la France, qui ne fait que des frappes homéopathiques, et aux États-Unis, qui font la guerre sans intention de la gagner, le Kremlin a engagé tous les moyens nécessaires. Poutine, dont la presse occidentale disait sans rire il y a encore trois mois qu’il s’apprêtait à « lâcher le régime syrien », a obtenu le feu vert de son Parlement et s’est assuré du soutien des vingt millions de musulmans que compte son pays. Contrairement aux Américains et à leurs alliés, il intervient conformément au droit international, avec l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU et à la demande des Syriens. Et il le fait pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il est impensable pour lui de laisser les islamistes de Daech s’emparer de la Syrie, qui abrite à Tartous la seule base russe de la région. Ensuite parce que c’est une belle occasion pour lui d’éliminer sur place quelques milliers de djihadistes russes originaires du Caucase. Enfin, et surtout, parce qu’avec cette intervention, il s’impose d’emblée à la face du monde comme la grande puissance montante avec laquelle il faut désormais compter.
Dans l’affaire syrienne, il y a ceux qui veulent en finir avec Daech et ceux pour qui l’éviction de Bachar el-Assad est la priorité. Est-ce vraiment ainsi que se pose le problème ?
Se demander dans l’abstrait qu’est-ce qui est le pire, une dictature ou un réseau terroriste comme Daech, est une très mauvaise façon de poser le problème. Le « pire » est toujours relatif à une situation donnée. La seule véritable question qui se pose est celle-ci : qu’est-ce qui est le plus contraire à nos intérêts ? Si c’est la dictature, alors il faut se battre contre la dictature ; si c’est le réseau terroriste, alors c’est lui qu’il faut affronter. Dans le cas de la Syrie, la réponse est simple. La barbarie islamiste de Daech nous menace, alors que le régime de Bachar el-Assad ne nous a jamais menacés. Contre la première, il faut donc soutenir le second. Mais le fond du problème, c’est la russophobie. Pour les États-Unis comme pour la France, l’objectif numéro un, c’est avant tout de réduire l’influence russe. Damas étant l’allié de Moscou, l’élimination de Bachar el-Assad devient dès lors la priorité.
On reproche ainsi aux frappes russes de viser, non seulement Daech, mais les rebelles syriens qui combattent le régime légal de Damas. Mais pourquoi ne le feraient-elles pas ? Vladimir Poutine sait très bien que, dans l’affaire syrienne, il n’y a pas d’« islamistes modérés », mais seulement des rebelles armés, alliés objectifs des terroristes, que les forces armées syriennes sont les seules à combattre réellement l’État islamique et que l’élimination du régime alaouite ouvrirait les portes de Damas à Daech. Vous noterez, au passage, le caractère grotesque des réactions scandalisées fulminées par les États européens membres de l’OTAN au motif que des avions russes auraient effleuré la frontière aérienne turque, au moment même où ces mêmes États acceptent que leurs propres frontières, terrestres celles-là, soient violées tous les jours par des milliers d’immigrés illégaux venus pour la plupart de Turquie !
Du coup, grande est l’impression que la France joue toujours avec un coup de retard…
La France, en effet, n’est pas seulement alignée sur l’Amérique, elle a aussi toujours un temps de retard. En 2013, François Hollande annonce qu’il va bombarder Damas, puis se ravise parce que Washington a décidé de faire marche arrière. L’année suivante, il prend des sanctions contre la Russie, puis décide de recevoir Poutine parce qu’Obama l’a reçu avant lui. Aujourd’hui, sous l’influence du plus exécrable ministre des Affaires étrangères de la Ve République, Laurent Fabius, il persiste à exiger le départ de Bachar el-Assad, que ne demandent plus ni les Américains ni les Allemands, ce qui est à peu près aussi réaliste que si les démocraties occidentales avaient fait du départ de Staline un préalable à leur alliance avec l’URSS contre Hitler !
Après avoir achevé l’œuvre d’atlantisation de la diplomatie nationale entamée sous Nicolas Sarkozy, la France adopte, face à Moscou, une position de guerre froide que rien ne justifie, sinon son alignement total sur la politique de l’OTAN, et continue à prétendre décider à la place des Syriens de qui doit diriger la Syrie. N’ayant plus aucune politique étrangère indépendante, elle est, en fait, condamnée à jouer petit bras. Après quatre ans de soutien aux pétromonarchies du Golfe et aux bandes islamistes anti-Assad, elle voit s’effondrer toutes ses hypothèses et n’est plus en position de se poser en médiateur nulle part. Plus personne ne l’écoute, elle ne compte pour rien, elle est hors jeu. Quand comprendra-t-elle que la Russie est notre plus naturel allié ?
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 19 octobre 2015)