Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Juan Asensio, essayiste et critique littéraire officiant sur le blog Stalker, cueilli sur le site de la revue Éléments. Juan Asensio, qui a collaboré aux revues Nouvelle École et Krisis, a notamment publié Le temps des livres est passé (Ovadia, 2019) et Maudit soit Andreas Werckmeister ! (Ovadia, 2024).
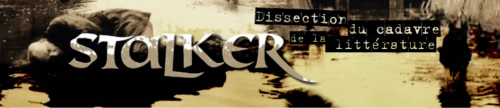
Autopsie de la littérature: entrez dans la « zone » de Juan Asensio !
Spécialiste de l’œuvre de Georges Bernanos (il a mené une thèse de doctorat sur la figuration du diable dans ses romans ainsi que ceux de Julien Green et de François Mauriac, abandonnée en cours de route), Juan Asensio a publié en 2007 son premier recueil de chroniques avec La Critique meurt jeune, consacrées à des auteurs tels que Dantec, Nabe, Dostoïevski ou ce même Bernanos. En 2019 a paru Le temps des livres est passé qui regroupe le meilleur de ses analyses littéraires parues sur son blog, dans lesquelles il célèbre les œuvres de Malcolm Lowry, Ernesto Sabato, Joseph Conrad, William Faulkner ou encore László Krasznahorkai. Son travail a fait découvrir des auteurs méconnus, Édouard Estaunié, Loys Masson, Guillaume Gaulène, d’autres encore, à travers des analyses profondes et minutieuses de leurs œuvres. Juan Asensio est également connu pour ses diatribes contre la littérature actuelle, les pseudo-écrivains et pseudo-critiques.
∴
ÉLÉMENTS : De Joris-Karl Huysmans à Paul Gadenne, vous avez disséqué l’œuvre d’une multitude d’immenses écrivains. Quelle est la mise en valeur dont vous êtes le plus fier ?
JUAN ASENSIO. Je ne saurais vous dire, tant mes notes ont pu s’accumuler de façon plus ou moins erratique au cours de ces désormais plus de 20 années d’exploration patiente et surtout méthodique de la Zone. Ce n’est bien sûr pas à moi de pointer telle ou telle étude pour ses qualités réelles ou supposées, mais j’éprouve toutefois une certaine fierté d’être parvenu à créer des rapprochements inédits, en parvenant par exemple à montrer que Le Transport de A. H. de George Steiner s’inspirait assez directement de Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, comme Steiner en personne ne manqua pas de le reconnaître, ou bien lorsque j’ai souligné des parentés entre les images surprenantes employées par le génial et tonitruant Léon Daudet et Georges Bernanos, que j’ai rapproché encore le premier roman de ce dernier, Sous le soleil de Satan, de Moravagine de Blaise Cendrars ou que j’ai établi une filiation directe et, à ce jour, inédite, entre Le Grand Dieu Pan d’Arthur Machen et l’histoire de Mouchette telle qu’elle figure dans ce même premier roman qui marqua l’entrée fracassante du Grand d’Espagne sur la scène littéraire française, en 1926. J’ajoute, malicieusement, que c’est ce même rapprochement entre Machen et Bernanos qui me permet d’expliquer la mystérieuse mention de Paul-Jean Toulet qui traduisit en français l’œuvre la plus connue de Machen, dès la première ligne du roman Sous le soleil de Satan, mention sur laquelle plusieurs générations de bernanosiens se sont contentés de répéter de vagues truismes, affirmant que l’auteur du très inquiétant Monsieur du Paur, sorte de précurseur de Monsieur Ouine, était l’auteur de vers charmants, cette affligeante banalité figurant même, comme il se doit, dans l’apparat critique de la dernière édition, en deux volumes excusez-nous du peu, des romans de Bernanos dans La Pléiade, cette collection qu’allez savoir pourquoi, tous les ânes qualifient de « prestigieuse ». « Imbéciles ! », eût probablement dit Bernanos, pour caractériser la paresse intellectuelle de ces scribes méticuleux, capables d’ergoter sur la place d’une virgule dans un texte de plusieurs milliers de mots mais absolument pas fichus de voir ce qui pourtant s’étalait sous leurs yeux, et qu’ils n’auraient pu que très vite remarquer s’ils avaient lu plus loin que le bout de leurs lunettes ! Machen, Toulet, Bernanos, c’était pourtant une évidence, bon sang, non ?
J’aime aussi faire revenir à la surface de bons vieux romans à peu près engloutis sous quelques millions de mètres cubes d’eau trouble, comme ceux de Loys Masson ou de Guillaume Gaulène, ne pas cesser de rappeler que Carlo Michelstaedter, Zissimos Lorentzatos ou encore Cristina Campo, Paul Gadenne, W. G. Sebald et Vincent La Soudière sont de grands penseurs, écrivains, épistoliers ; bien évidemment, je ne suis moi-même pas seul dans ce long travail d’excavation, d’exhumation de trésors littéraires, et je ne manque jamais de remercier publiquement ceux qui, au détour d’une simple phrase ou d’un propos plus ample, m’ont permis de découvrir tel ou tel nom. Je précise cela en ne manquant pas de faire un clin d’œil vers ceux qui, tout à coup, abandonnant soudainement leurs piètres lectures qui leur auront appris à ne pas savoir lire, se sont mis à ne plus citer que ces auteurs, en oubliant qu’ils n’en savaient strictement rien avant qu’ils ne croisent leurs noms dans la Zone ! Ainsi va la vie, me direz-vous…
ÉLÉMENTS : Récemment vous avez mis en lumière – aidé en cela par un compagnon de route d’Éléments, le regretté Jean-François Michaud –, Les Français de la décadence d’un auteur totalement méconnu, André Lavacourt. Que pouvez-vous nous dire de cet auteur, de ce roman – malheureusement introuvable –, et pensez-vous qu’un jour Gallimard publiera des trésors qui dorment dans ses archives ?
JUAN ASENSIO. Je regrette infiniment la disparition tragique de Jeff comme nous étions quelques-uns à l’appeler, qui m’a fait découvrir, en effet, Les Français de la décadence d’André Lavacourt, pseudonyme d’un certain Pierre Couturier, dentiste de son état, dont nous ne savons pas grand-chose, malgré quelques recherches d’un précédent lecteur qui fut, comme je l’ai été, frappé par la puissance phénoménale de ce roman monstrueux, et auquel je signale ma dette dans les deux articles que j’ai consacrés au texte de Lavacourt. Celui-ci est devenu introuvable depuis maintenant un grand nombre d’années, j’allais dire : depuis 1960 ou peu s’en faut, date de sa parution puisque lorsque Michel Déon le redécouvre quelques années plus tard, il se plaint déjà… de sa disparition ! J’ai remercié l’ami Jeff dans la préface que j’ai donnée (en fait, la réunion de mes deux notes parues dans la Zone) pour l’édition samizdat de ce roman qu’il a financée, et que nous sommes quelques-uns à posséder, à communiquer à de bons lecteurs (espérons-le du moins !), cet hétéroclite cercle de happy few réunissant une poignée de fanatiques qui se reconnaîtront.
Ce texte me hante, c’est peu de le dire, cet auteur englouti me taraude, le terme n’est lui aussi pas trop fort, comme Benno von Archimboldi hantait et taraudait la poignée d’universitaires de différents pays que met en scène Roberto Bolaño dans 2666. J’ai poussé mes recherches tous azimuts, en essayant de retrouver la trace de la dernière personne ayant connu Lavacourt, mais son âge et la maladie neurodégénérative dont elle souffre l’éloignent hélas d’une demande d’entretien. Je me suis adressé à Gallimard, plusieurs fois, en commençant par tel sous-fifre qui ne m’a rien appris (moi, au moins, je lui ai appris l’existence d’un grand livre…) puis en envoyant une belle lettre de château à son grand manitou, Antoine Gallimard, qui m’a répondu brièvement par une série de monocordes évidences mais ne m’a jamais accordé la permission de fouiller dans ses archives, ne serait-ce que pour y découvrir un ou deux éléments qui ne sont quand même pas des secrets d’État et qui m’auraient permis de poursuivre mes recherches sur ce mystérieux météore qu’est presque toujours l’auteur d’un seul livre. J’ai tenté d’obtenir, par un ami lecteur, des informations en Algérie, où André Lavacourt a exercé plusieurs années ses talents de praticien dentaire, là encore sans grand succès et j’ai même contacté son Ordre, qui doit semble-t-il se réunir en mirifique conclave pour me livrer de rutilantes informations sur l’un des siens ! Autant vous dire que je n’avance pas du tout ! Mais il y aura du nouveau je l’espère, sous la forme d’un petit film qui est en cours de montage, suivant mes pérégrinations atrabilaires autour de ce livre et, il faut le souhaiter bien sûr, une réédition, car c’est véritablement un scandale que pareil roman ait tout bonnement disparu.
J’espère quoi qu’il en soit ne pas quitter ce monde sans être parvenu, d’une façon ou d’une autre, à redonner vie à ce roman qui soutient la comparaison avec Les Décombres de Lucien Rebatet (qui salua le livre de Lavacourt de très belle façon, y reconnaissant sans doute un des siens !) et même – j’ose cette énormité en rappelant bien sûr que le seul et unique roman connu d’André Lavacourt comporte des défauts – avec le Voyage au bout de la nuit de Céline, ne serait-ce que par la puissance toute rabelaisienne de sa langue.
ÉLÉMENTS : Dans vos articles et écrits publics, vous faites le constat d’un pays en état de quasi-mort cérébrale et de dégénérescence intellectuelle et littéraire. La décadence d’un pays est liée à la décadence de sa langue. Vous ne trouvez aucune qualité à Annie Ernaux, Le Clézio, ou Cécile Coulon ?
JUAN ASENSIO. Non, en effet, je ne trouve aucune qualité à ces trois infâmes écrivassiers, si ce n’est la capacité à faire croire à tout un tas d’imbéciles, d’abord journalistiques, qu’ils ont l’ombre d’un quark de talent autre que celui de faire à la chaîne, comme on fait des boudins ou d’autres choses moins appétissantes, des rinçures.
ÉLÉMENTS : Je n’ose vous demander ce que vous avez pensé de la rentrée littéraire…
JUAN ASENSIO. Absolument rien, voilà ce que je pense de ces rentrées dites littéraires, et d’ailleurs je n’en lis pratiquement plus les produits, boudins et autres saucissons à l’aspect peu ragoûtant. Il me semble que je ne perds rien du tout d’ailleurs, si j’en juge par l’exemple très récent d’une bouse parfaitement sèche, sans même plus aucune mouche venant y pondre ses œufs, que l’équipe de Tocsin m’a mise sous le nez, me demandant de la renifler et même d’y effectuer quelques prélèvements, Le club des enfants perdus de Rebecca Lighieri faisant partie de la sélection du Goncourt des lycéens. C’est affreusement plat, y compris même lorsque surviennent des descriptions pornographiques donc cliniques, c’est incroyablement bête lorsque sont lâchés de consternantes conneries sur le monde tel qu’il ne va pas, c’est ignoblement accordé à l’air putride du temps par l’usage d’un peu d’écriture inclusive et autres bubons remplis de pus transgenre, mais surtout c’est très franchement tendancieux lorsque le message final clignote sous les yeux du lecteur, y compris, donc, ceux d’adolescents : « mes pauvres enfants si sensibles, suicidez-vous, comme Miranda, c’est encore ce qu’il vous reste de mieux à faire face à ces méchants adultes qui jamais ne vous comprendront ! ». On se désespère qu’une scène de rut ressemble à l’épopée gaillarde et invinciblement drôle telle qu’un José Lezama Lima a pu la figurer dans Paradiso (voir la première partie du chapitre 8, décrivant les prodigieux exploits sexuels de Farraluque) mais non, que nenni, c’est sujet-verbe-complément avec Rebecca Lighieri et encore, on sent que cette écrivassière a dû passablement se concentrer pour faire (comme on fait d’autres choses) une ligne maigre comme un filet d’eau déminéralisée. Tout cela, à de rarissimes exceptions qui finissent par se creuser un discret sillon, c’est de la merde lyophilisée, et j’essaie, en contenant une ou deux larmes de colère et de rage, de ne pas redonner vie artificielle à ces déjections.
ÉLÉMENTS : À toutes les époques des critiques ont prétendu que la littérature était morte et que les romanciers de leur temps n’avaient aucun intérêt. Olivier Maulin, Thomas Clavel, Jean-Pierre Montal, Patrice Jean – parmi d’autres – n’atténuent-ils pas votre diagnostic ? Le temps des livres est-il vraiment passé ?
JUAN ASENSIO. Bien sûr qu’il est passé, et les honnêtes exemples que vous citez, quoi que je pense par ailleurs de leurs qualités et défauts respectifs, ne diraient pas, m’est avis, le contraire, puisqu’ils ne font après tout que survivre, alors que prospèrent les petits profiteurs, les sales malins, les lamentables écrivants pullulant sur la charogne, comme celle de Baudelaire, les quatre pattes en l’air et fumant sous le soleil, de la littérature française ! Est-ce donc le nombre réellement extraordinaire de livres qu’un pays en fin de partie comme la France parvient, par fallacieuse prodigalité, à produire qui vous fait croire qu’il a encore quelque chose à dire ? En fait, ce n’est pas tant que l’époque des livres est passée, puisqu’elle l’était déjà lorsque Ernest Hello et Léon Bloy le constataient, que l’évidence selon laquelle notre pays, qui n’a plus d’horizon géopolitique – et que dire d’une perspective plus haute ! –, n’a strictement plus rien à dire, je le répète. N’ayant plus rien à dire du tout, les écrivains français, ou plutôt ce qu’il en reste, continuent d’écrire pour se lamenter, dans le meilleur des cas, de n’avoir rien à dire ce qui est, au mieux vous me l’accorderez, un très ironique quoique douloureux paradoxe, les plus honnêtes d’entre eux allant même jusqu’à évoquer et invoquer des morts plus vivants que bon nombre des indigents crétins qui se reproduisent comme des mouches de cul de vache sur les plateaux trapenardiens.
ÉLÉMENTS : Très souvent, les critiques – quand ils lisent le livre – se cachent derrière un résumé du roman, qu’ils agrémentent d’adjectifs, sans dire réellement ce qu’ils ont pensé du livre, comme s’ils craignaient de se tromper. Vous faites partie des quelques derniers critiques littéraires « véritables », « à cran d’arrêt » et qualifiez la critique journalistique trapenardisée de « communauté de nains » et leurs pratiques de « léchage de fion germanopratin » ; vous avez la dent dure contre vos collègues !
JUAN ASENSIO. Pardon ? Mes « collègues » ? J’ai dû mal lire car, s’il y a bien un raout auquel je m’honore de n’avoir participé que de très loin – quelques piges rendues à Valeurs actuelles, à l’époque où y officiait l’excellent Bruno de Cessole, et non l’affligeant Laurent Dandrieu –, c’est bien celui du journalisme, une année passée au CELSA m’ayant, en la matière, ôté toute trace d’illusion sur cette corporation plus corrompue que les lupanars de l’antique Babylone ! Que voulez-vous que je vous réponde de moins anecdotique, si ce n’est que, fidèles miroirs d’une société qui ne sait plus lire, les journalistes, qui en d’autres temps savaient séparer la piquette des grands crus, se bourrent la gueule de vinaigre tout en parvenant encore à nous faire croire que quelque élixir coule dans leur gueule ! Il est après tout logique que l’effondrement du niveau minimal de maîtrise de la langue française, que l’on constate chez les lecteurs comme les auteurs ou les éditeurs, à tous les étages de la société française à vrai dire, ait aussi été largement anticipé par les journalistes, qui mourraient plutôt que de subir l’accusation de passéisme : les voilà donc à la pointe du progrès, car ils évoquent dans un français de graffitis de pissotière des livres pas même dignes d’y être proposés en guise de rince-doigts.
ÉLÉMENTS : Récemment, Ovadia a réédité votre court ouvrage Maudit soit Andreas Werckmeister ! qui mélange le pamphlet et la création littéraire, où vous imaginez le dernier homme confronté à la mort de la littérature. Vous tissez la métaphore d’une littérature devenue mer morte, considérée comme un trou noir, aspirant tout ce qui se trouve à sa proximité. Pouvez-vous nous en dire plus ?
JUAN ASENSIO. Ce sont les grands romans qui ressemblent à des trous noirs, bien davantage que la « littérature devenue mer morte » qui, elle, n’est que le résidu, fantomatique, d’une évidence, j’allais parler, sur les brisées de George Steiner, d’une « réelle présence » ou d’une « pesanteur, avec Carlo Michelstaedter, l’une et l’autre à peu près acceptée par tous, sur lesquelles ne s’exerçaient pas encore les si patientes termites de la déconstruction derridienne. Les trous noirs, que les astronomes du XIXe siècle appelaient encore du beau nom d’astres occlus, un terme tout de même beaucoup plus poétique que l’appellation anglo-saxonne devenue hélas définitive, nous apprennent je crois bien des choses, ne serait-ce que d’un point de vue métaphorique, sur le fonctionnement de certains romans qui paraissent s’effondrer sous leur propre masse, et trouent alors le tissu de l’espace-temps. Ces astres pour le moins exotiques, tels que les astrophysiciens actuels en comprennent le fonctionnement, engloutissent de la matière comme de véritables ogres stellaires, la lumière elle-même ne parvenant pas à leur échapper. Tout ce qui tombe dans leur disque d’accrétion est ainsi inexorablement digéré au-delà de l’horizon des événements ou event horizon, qui a donné son titre à un film d’horreur spatiale ma foi assez réussi et surtout à un récent réseau de télescopes disséminés dans le monde entier, qui a naguère réussi la réelle prouesse technique de parvenir à en photographier deux d’entre eux. Mais, voyez, le mystère est que, de cette monstrueuse déglutition – nous ne savons rien de leur digestion, et encore moins de ce que devient la matière avalée après cette dernière ; réapparaît-elle dans quelque très conjecturel trou blanc ? – naissent des quantités prodigieuses d’énergie : de même les grands romans tels que je les entends, au centre desquels se tapit un Minotaure comme le pensait José Bergamín, et qui absorbent tout ce qui les entoure, comme une noria dont les colossales forces effriteraient, disloqueraient leur proche banlieue, mais qui n’en délivreraient pas moins quelque mystérieuse bouteille sauvée, ainsi que le narre le conte de Poe, du maëlstrom. Dans cette bouteille figure… le texte que l’on est en train de lire ! De quelles œuvres suis-je en train de parler ? J’en ai cité au moins une, Monsieur Ouine de Georges Bernanos, dernier roman du grand écrivain et roman terminal de l’Occident devenant de plus en plus bavard à mesure qu’il tombe dans l’aphasie, comme j’ai tenté de le montrer dans de nombreux textes, au sens où ce livre aussi déroutant que génial tente une plongée incomparable dans le puits sans fond du nihilisme annoncé par Jacobi, Dostoïevski ou encore Nietzsche. D’autres monstres romanesques figurent dans la partie que je leur ai consacrée dans Le temps des livres est passé.
Juan Asensio, propos recueillis par Anthony Marinier (Site de la revue Éléments, 30 octobre 2024)

