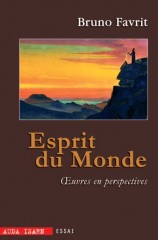Le nouvel ordre moral
La condamnation d’Éric Zemmour le démontre une fois de plus : au nom du principe de “non-discrimination”, certaines associations s’érigent en arbitres du débat public.
Constater un fait, est-ce propager la haine ? Depuis le 18 février, date de la condamnation d’Éric Zemmour pour “provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine”, la question est posée. Zemmour, on le sait, était poursuivi par cinq associations (SOS Racisme, la Licra, le Mrap, l’UEJF et J’accuse) pour deux phrases distinctes et sans rapport entre elles. L’une de dix-huit mots, prononcée en direct le 6 mars 2010 sur le plateau de Salut les terriens (Canal plus) : « Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c’est comme ça, c’est un fait. » L’autre de cinq : « Mais ils ont le droit », lâchée au cours d’un débat, également le 6 mars 2010, organisé par la chaîne France Ô, puis mise en ligne sur le site Dailymotion… Cette dernière phrase répondait à la question suivante, posée par un interlocuteur : « Quand, par exemple, certains employeurs s’adressent à des directeurs d’agence d’intérim et leur disent : “S’il vous plaît, je ne veux pas d’Arabes et de Noirs”, c’est injuste, quand même, non ? Reconnaissez-le. »
Le délit de “diffamation raciale” n’a pas été retenu au sujet des trafiquants, comme le réclamait la Licra, mais Zemmour a néanmoins été condamné pour “provocation à la discrimination” par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Même sanction, même motif pour les mots : « Mais ils ont le droit », s’appliquant aux employeurs qui préfèrent recruter des candidats selon des critères qui leur sont propres... Pour résumer, il n’est donc pas diffamatoire de dire que “la plupart des trafiquants sont noirs et arabes”, mais rendre ce constat public est constitutif d’une provocation !
Certes, Éric Zemmour n’est condamné qu’avec sursis à deux amendes délictuelles de 1 000 euros. Mais cette mansuétude vaut avertissement : qu’il se permette d’aborder les mêmes sujets dans les mêmes termes, et la peine sera exécutoire, assortie des majorations liées à sa qualité de “récidiviste” – celles-là mêmes que beaucoup de juges renoncent à réclamer à des délinquants condamnés plusieurs fois pour le même délit…
Surtout, il va devoir verser près de 11 000 euros aux associations plaignantes sans compter l’obligation humiliante de payer les frais de diffusion d’un communiqué relatant sa condamnation sur les ondes de la chaîne France Ô.
Le jugement n’est pas avare de détails quant à l’exécution de la peine : « Ce texte sera lu à l’antenne au début d’une émission […] tandis qu’il sera également visible à l’écran où il devra apparaître ou se dérouler de manière à être clairement visible, pendant la lecture qui en sera faite. »
Peut-on mieux signifier que, désormais, tout débat devra être soigneusement cadré et chaque intervenant chapitré afin de ne pas donner lieu à l’irréparable : l’irruption d’un sujet hors la loi ?
L’analyse du passage dans lequel Zemmour prononce, en une courte incise, les mots « mais ils ont le droit » est un morceau d’anthologie. Le jugement de la 17e chambre ne consacre pas moins de deux pages au contexte dans lequel ils ont été prononcés. Le prévenu regrettait- il cette discrimination (comme le suggère le “mais”) ou approuvait-il ce que la loi punit ? Que voulait-il dire quand, quel ques minutes plus tôt, il constatait que la vie était « injuste » et les discriminations partout ? Cela devait-il être mis à son crédit ou, au contraire, à sa charge ? Autant de circonlocutions rappelant involontairement les procès en sorcellerie d’antan : le prévenu est-il ou n’est-il pas inspiré par le Malin ?
Tout démontre en tout cas l’importance déterminante prise, dans nos institutions, par certaines associations s’autoproclamant “représentatives” – la dernière-née étant le Cran, pour Conseil représentatif des associations noires de France – et le poids, symétriquement décroissant, de la puissance publique, censée garantir le droit des gens et l’intérêt général.
Jusqu’à la loi Pleven de 1972, en effet, seules deux instances étaient habilitées à saisir la justice pour “diffamation ou injure raciste” : la personne s’estimant diffamée ou discriminée et le parquet, en sa qualité de représentant de la société, s’il s’agissait d’actes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public (par exemple, un texte publié dans la presse contraire à l’honneur d’une communauté voire susceptible d’entraîner des violences contre celle-ci). Toutes choses régies par la loi de 1881.
Mais, depuis trente ans, tout a changé : ce n’est plus seulement la personne qui s’estime diffamée ou le ministère public, s’agissant d’un groupe, qui sont habilités à saisir la justice. Mais toute association s’autoproclamant représentative de tel ou tel intérêt, ou de telle ou telle communauté. Y compris en l’absence de plainte individuelle préalable ! C’est ainsi que le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a pu être mis en cause par le Mrap à propos d’une plaisanterie adressée à un militant UMP d’origine maghrébine – militant qu’on voit rire de bon coeur sur la vidéo incriminée et qui, pour avoir pris la défense d’Hortefeux, sera à son tour menacé.
Conçue, à l’origine, pour punir les actes authentiquement racistes – au début des années 1970, point de départ de l’immigration de masse, les ratonnades n’étaient pas rares –, cette loi a rapidement dépassé ce cadre, en soi louable, pour devenir un instrument d’influence aux mains de toutes les minorités, se saisissant du moindre mot de travers comme d’une arme retournée contre l’adversaire.
D’où l’inflation régulière des contentieux qui tend, non seulement à faire du juge l’arbitre des causes les plus variées, mais aussi et surtout à privatiser l’action publique en autorisant les associations à la déclencher. Tout, dès lors, devient possible. Et les textes, se nourrissant des jurisprudences ainsi créées, ne cessent de renforcer cette évolution.
La judiciarisation des opinions menace-t-elle la démocratie ?
En 1990, ce fut la loi Gayssot, instituant des peines de prison pour punir certains délits (notamment le négationnisme) – au risque, selon la plupart des historiens, d’instituer une vérité officielle renforçant paradoxalement les fantasmes que la loi était censée combattre. Puis, sont venues la loi du 9 mars 2004, portant de trois mois à un an la prescription relative aux délits de presse “racistes” ou présumés tels, et surtout celle du 30 décembre 2004, qui a donné naissance à la Halde.
Or, on l’oublie trop souvent, cette dernière fut votée contre l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui en avait rejeté la philosophie en se référant à la tradition juridique française, hostile au communautarisme, « parce que c’est l’être humain en tant que tel, et non en raison de certains traits de sa personne, qui doit être respecté et protégé. […] Cette segmentation de la protection des droits de l’homme remet en question leur universalité ».
Argument prémonitoire : comme le disait le regretté Philippe Muray, c’est moins désormais la justice qui y trouve son compte, que la « fièvre cafteuse » de tous contre tous, prenant prétexte d’un mot, d’une phrase, d’un sous-entendu même, pour régler ses comptes avec la communauté d’en face… Le contraire, en somme, du droit, dont la vocation est de désamorcer les conflits plutôt que de les relayer !
Éric Branca (Valeurs actuelles, du 24 février au 2 mars 2011)