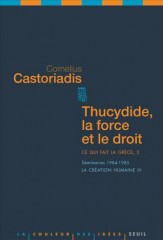LES MENACES SUR L’IDENTITE MEDITERRANEENNE
Avant de parler des menaces qui me paraissent peser sur l’identité méditerranéenne, je voudrais dire quelques mots sur l’identité en général, afin de lever toute équivoque sur la façon dont j’emploie ce terme.
Je partirai de ce constat évident que nul ne réalise seul sa destinée. On ne peut donc absolutiser l’individu comme un objet en soi. L’être de l’humain ne se borne pas au topos de l’individu, mais s’étend au milieu commun qui contribue à le constituer. L’existence humaine est d’abord extension vers l’extérieur (cf. la notion de « Ausser-sich-sein » chez Heidegger). Pour savoir qui je suis, je dois déjà savoir où je me tiens. La corporéité elle-même, comme l’avait bien vu Merleau-Ponty, est synthèse d’un corps et d’un environnement social. De même la citoyenneté implique-t-elle d’emblée la concitoyenneté : la citoyenneté n’est pas un attribut de l’individu, c’est l’attribut du concitoyen. La pleine définition de l’identité d’un individu exige donc de faire référence à son contexte de vie, à l’espace qu’il partage avec d’autres que lui, car c’est en fonction de la perception qu’il en aura qu’il se définira lui-même. Le groupe assigne toujours à l’individu une part de son identité, ne serait-ce que par le biais de la langue ou des institutions. On ne peut jamais définir un moi ou un nous sans se référer à d’autres que ce moi ou que ce nous.
Pour le dire en d’autres termes : à partir de soi, il y a une existence, mais il n’y a pas d’identité seulement à partir de soi. L’identité est certes ce qui donne un sens à l’existence, mais comme l’existence n’est jamais purement individuelle, la question de l’identité revêt obligatoirement une dimension sociale. Même l’identité juridique d’un individu ne se limite pas à son état-civil, mais se trouve liée, au cours de son existence, à plusieurs types de contrats (de mariage, de travail, etc.) partiellement définis par le droit, mais aussi soumis à l’évolution de la loi et des rapports sociaux. C’est pourquoi l’identité ne peut se penser indépendamment de toute socialité. L’identité ne se constitue pas à l’écart, à partir du sujet lui-même, mais à partir d’une relation à l’identité des autres. Le rapport à l’autre est donc toujours fondateur de l’identité dont se soutient le sujet dans l’expérience symbolique de la sociabilité.
Le rapport à l’autre, bien entendu, peut être empathique ou hostile. Giovanni Sartori n’a pas tort à cet égard de souligner que « l’altérité est le complément nécessaire de l’identité : nous sommes ce que nous sommes, à la façon dont nous le sommes, en fonction de ce que nous ne sommes pas et de la façon dont nous ne le sommes pas ». Cependant, même un rapport hostile est d’abord un rapport. Marcel Mauss a bien montré, à l’inverse, que le don lui-même met en jeu l’identité, car il « ne se réduit pas à donner quelque chose à quelqu’un », mais « consiste à se donner à quelqu’un par la médiation de quelque chose ». C’est pour cela que le don se construit au moyen d’une réciprocité. Le don fait à quelqu’un qui n’est pas posé en même temps comme susceptible de le rendre est un don qui ne reconnaît pas l’identité de celui qui le reçoit. On est là au centre de la problématique de la reconnaissance.
Mais on est également au centre de la question de l’identité, puisque toute identité, toute conscience identitaire, suppose l’existence d’un autre. Les identités se construisent par l’interaction sociale, si bien qu’il n’existe pas d’identité en dehors de l’usage qu’on en fait dans un rapport avec autrui. Toute identité est dialogique. Cela signifie que ce n’est qu’en partant de son identité dialogique que le moi peut devenir autonome. Mais cela signifie aussi qu’autrui fait partie de mon identité, puisqu’il me permet de l’accomplir. L’individualisme ne conçoit le rapport à autrui que sous un angle instrumental et intéressé : la seule justification du rapport social est qu’il accroisse mon intérêt ou mon épanouissement immédiat. Dans une optique communautarienne, le rapport social est au contraire constitutif de soi.
L’action collective est indissociable d’un rapport au bien (à ce qui vaut par opposition à ce qui ne vaut pas) qui nous enracine dans une culture. La culture est une médiation symbolique de l’appartenance sociale (elle inscrit l’identité dans le champ des pratiques symboliques qui font l’objet d’une diffusion dans l’espace public), en même temps qu’elle est le lieu dans lequel s’inscrivent les identités qui structurent nos appartenances, ainsi que l’ensemble des pratiques sociales par lesquelles nous donnons notre identité à voir, à entendre et à échanger. On peut alors la définir comme l’ensemble des formes et des pratiques qui inscrivent l’appartenance sociale dans l’expérience réelle de ceux qui en sont porteurs et qui expriment ou revendiquent le lien social qui les fonde dans les pratiques symboliques qui donnent du sens à leur existence. Il est donc tout à fait naturel que ce soit par les formes de la médiation culturelle que l’identité puisse faire l’objet d’une reconnaissance dans l’espace public.
Ajoutons ici qu’une erreur très commune consiste à définir l’identité comme une essence fondée sur des attributs intangibles. En fait, l’identité n’est pas une essence ou une réalité statique. Elle est une substance, une réalité dynamique et à ce titre elle constitue un répertoire. N’étant pas une donnée homogène, continue, univoque, elle ne peut être pensée que dans une dynamique, une dialectique, une logique de la différence toujours confrontée au changement.
L’identité ne dit pas seulement la singularité ni la permanence de cette singularité. Envisager l’identité à partir de la notion de continuité conduit en effet à en percevoir rapidement les limites : la continuité inclut aussi le changement, tout comme la définition de soi implique le rapport à l’autre. « Ce que nous sommes ne peut jamais épuiser le problème de notre condition, parce que nous sommes toujours changeants et en devenir », souligne Charles Taylor. Il n’y a donc pas d’identité sans transformation, l’important étant de ne pas poser ces deux termes comme contradictoires. La permanence ne réside pas tant dans l’identité que dans l’instance qui définit et attribue cette identité. L’identité n’est pas ce qui ne change jamais, mais au contraire ce qui nous permet de toujours changer sans jamais cesser d’être nousmêmes.
Cette distinction permet de relativiser l’opposition faite couramment entre identités héritées et identités choisies. Il est indéniable qu’il existe de nombreuses associations qui ne peuvent faire l’objet d’un choix au sens que la doctrine libérale donne à ce terme. Ce sont les « associations involontaires » évoquées par Michael Walzer, lorsqu’il écrit que la vie associative, « dans bien des domaines, n’est pas le fait d’un héros libéral, d’un individu qui serait en mesure de choisir ses propres allégeances. Au contraire, un grand nombre d’entre nous se situent d’ores et déjà dans des groupes qui pourraient bien s’avérer déterminants ». La famille et le sexe viennent évidemment au premier rang de ces « associations involontaires », mais celles-ci peuvent aussi comprendre la nation ou le pays, la classe sociale, la langue, la culture, les valeurs morales ou la religion. « Tant par leur nature que par la valeur que nous leur attribuons, ajoute Walzer, les associations involontaires jouent un rôle significatif dans notre décision d’adhérer volontairement à d’autres associations. Les premières précèdent historiquement et biographiquement les secondes, et constituent l’inéluctable arrière-plan de toute vie sociale, qu’elle se vive ou non dans la liberté et l’égalité ». Cette observation est tout à fait juste, mais ces associations involontaires, héritées, ne sont pas des déterminations absolues. Elles limitent seulement, sans la supprimer, notre capacité de s’en affranchir. Même l’identité liée au sexe et à la filiation ne devient pleinement une composante de notre identité que si nous décidons de la considérer comme telle.
On connaît la belle phrase de René Char : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Un testament répartit l’héritage. Mais chez les humains, c’est à chacun de ceux qui héritent de déterminer la nature de sa part. Hériter, ce n’est pas seulement s’identifier à ce dont on hérite, mais déterminer les meilleurs moyens de se l’approprier. Je ne cherche pas seulement à poursuivre ce dont j’ai hérité, je le façonne aussi par le regard que je porte sur lui.
Ce façonnement équivaut à une démarche narrative. Pour l’individu comme pour le groupe, le rapport à soi-même n’est jamais immédiat. Il passe par le truchement d’une série de représentations et de narrations que l’on se fait à soi-même. Alasdair MacIntyre montre très bien que l’unité de la vie humaine est assimilable à l’unité d’une quête narrative : « Je ne peux répondre à la question “que dois-je faire ?” que si je peux répondre à la question précédente : de quelle histoire(s) fais-je partie ? ».
Objective ou subjective, l’identité contient donc toujours une part postulée. Elle n’est pas seulement un objet à découvrir, mais un objet à interpréter. La vie humaine, comme l’ont bien vu Dilthey, Gadamer ou Ricoeur, est fondamentalement interprétative, c’est-à-dire qu’elle ne se borne pas à décrire des objets, mais s’emploie aussi à leur donner un sens. L’homme est « un animal qui s’interprète lui-même », rappelle Charles Taylor. Il s’inscrit dans un cercle herméneutique qui se définit comme un espace de significations communes. Il appartient à la fois au monde qui le constitue et au monde qu’il constitue. L’identité n’échappe pas à cette règle. Elle est une définition de soi-même, en partie implicite, qu’un sujet élabore et redéfinit tout au long de sa vie, dans un processus proprement vital. L’identité est fondamentalement de nature narrative et autonarrative. Et son véritable sujet est l’énonciateur de cette narration. Notre identité, enfin, est inséparable d’une définition de ce qui importe ou non pour nous. Elle exprime la part de nous-mêmes que nous privilégions et sur laquelle nous nous appuyons pour nous construire, non pas du tout par émancipation vis-à-vis des déterminations dont nous sommes le lieu, mais par un choix qui nous fait tenir certaines de ces déterminations comme plus déterminantes que d’autres.
Pour désigner « ce qui (nous) importe », Taylor parle d’« évaluations fortes » et de « biens constitutifs » ou « hyperbiens ». Les « biens constitutifs » se distinguent des biens matériels ou des biens qui répondent à un simple besoin en ce qu’ils ne sont nullement assimilables à de simples préférences, mais sont fondateurs d’identité : « Formuler un bien constitutif, c’est rendre clair ce qu’implique la vie bonne qu’on adopte ». Les « évaluations fortes » se caractérisent par le fait qu’elle ne sont pas négociables et ne peuvent se réduire à une simple préférence ou à un simple désir. Elles ne sont pas relatives au bien-être, mais à l’être même des individus. Elles concernent ce qui donne une raison de vivre et de mourir, c’est-à-dire qu’elles portent sur des valeurs posées comme intrinsèquement bonnes. Les évaluations fortes représentent des buts moraux dotés d’une valeur intrinsèque. L’identité apparaît ainsi liée d’emblée à toute une herméneutique de soi, à tout un travail de narratologie destiné à faire apparaître un « lieu », un espace-temps qui configure un sens et forme la condition même de l’appropriation de soi. Dans une perspective phénoménologique, où rien n'est donné immédiatement, mais au contraire toujours de façon médiate, l'objet ne peut procéder que d'une élaboration constituante, d'un récit herméneutique caractérisé par l'affirmation d'un point de vue organisant rétrospectivement les événements pour leur donner un sens. « Le récit construit l'identité narrative en construisant celle de l'histoire racontée, dit Paul Ricoeur. C'est l'identité de l'histoire qui fait l'identité du personnage ». Défendre son identité, ce n'est donc pas se contenter d'énumérer rituellement des points de repère historiques ou des événements supposés fondateurs, c'est comprendre l'identité comme ce qui se maintient dans le jeu des différenciations, non comme le même, mais comme la façon singulière de toujours se transformer.
*
La première menace concernant l’identité méditerranéenne tient dans le risque de perdre conscience de ce qu’il y a de commun aux pays des deux rives de la Méditerranée. Certes, l’ensemble méditerranéen n’est pas totalement unitaire. Il ne l’a jamais été dans l’histoire. L’espace stratégique méditerranéen a toujours été traversé de lignes de clivages, de conflits, de rapports de force historiques ou symboliques. La généalogie plurielle de la région a donné naissance à des rapports qui n’ont pas toujours été des rapports de dialogue, loin de là. La colonisation a laissé des traces, et la décolonisation s’est effectuée souvent dans les pires conditions. De grandes disparités économiques et sociales demeurent encore aujourd’hui. Pourtant, au-delà des distorsions, des ambiguïtés et des affrontements politiques et culturels, au-delà aussi des réinventions nostalgiques qui ont affecté les monde berbéro-carthaginois, gréco-latin, judéo-arabe ou arabo-musulman, il n’en reste pas moins que le monde méditerranéen a son unité.
Cette unité ne saurait se ramener à une déclinaison de stéréotypes, eux-mêmes souvent empreints de nostalgie passéiste, sur la « culture de la vigne et de l’olivier », le « berceau des civilisations », la « passerelle entre l’Orient et l’Occident » ou l’exaltation de l’Antiquité. De tels stéréotypes sont toujours à mi-chemin du folklore pour touristes et de l’idéal muséologique. C’est Isidore de Séville, au VIIe siècle, qui a parlé le premier de la « mediterraneum mare », de cette mer qui, à la différence de l’Océan, n’est pas immensité liquide, mais bel et bien « mer au milieu des terres ». Plus récemment, la Méditerranée a pu être qualifiée, très justement, de « continent maritime »(1). L’unité de ce « continent maritime » repose sur des conditions climatiques relativement homogènes, sur des paysages semblables, sur un identique rapport à la mer, sur une commune adaptation à un espace suscitant des approches conceptuelles très proches les uns des autres. L’attractivité du littoral et des grandes villes a aussi été un facteur unifiant de l’espace méditerranéen, ce qui explique encore de nos jours la forte densité des façades maritimes, contrastant avec des arrière-pays ruraux souvent délaissés ou désertés.
Redevenue, depuis l’ouverture du canal de Suez, en 1869, la première route maritime mondiale, la Méditerranée a donné naissance, au fil des siècles, sinon des millénaires, à des formes sociales particulières, où la notion de communauté joue un rôle fondamental. Il y a en outre tout un système relationnel qui est à la base de la société méditerranéenne. C’est aussi autour du bassin méditerranéen que sont nés la philosophie, la tragédie, la science politique, le droit et quelques unes de nos interrogations socio-anthropologiques les plus essentielles. Mais l’identité méditerranéenne se décèle encore dans les domaines les plus différents, qu’il s’agisse du domaine musical, avec les accents byzantins du chant grégorien ou les ornements similaires de la musique arabo-andalouse et de la musique napolitaine des XVe et XVIe siècles, ou même du domaine juridique, où de fructueuses comparaisons ont pu être faites entre le droit romain – traditionnellement défini par la formule : « ius est ars boni et æqui » – et le système juridico-religieux islamique, notamment pour ce qui est du droit des gens et du droit de propriété(2).
Des Méditerranéens venus des deux rives opposées du « continent maritime » auront de ce fait toujours entre eux plus d’affinités, voire de souvenirs, qu’un Espagnol ou un Italien n’en aura avec un Finlandais ou un Américain. Question de paysages, d’odeurs, de souvenirs personnels et historiques peut aussi. A l’heure où, pour la première fois depuis le Moyen Age, l’islam est devenu une réalité dans l’Europe occidentale, il serait dommage de l’oublier. La deuxième menace que je voudrais évoquer consiste dans le risque inverse, celui de perdre de vue, non pas cette fois l’unité du monde méditerranée, mais au contraire sa diversité.
Fernand Braudel, dans son célèbre livre sur La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, a bien souligné cette diversité. A la question « Qu’est-ce que la Méditerranée ? », il répondait : « Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d’innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c’est trouver le monde romain au Liban ou en Provence, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l’islam turc en Yougoslavie… » Les trois grandes parties de la Méditerranée sont, chacun le sait, la Méditerranée européenne, qui va de l’Espagne à la Roumanie, la méditerranée orientale, qui s’étend de la Turquie à l’Egypte, et enfin la rive musulmane arabo-berbère. Ces trois Méditerranées correspondent grossièrement aux trois civilisations qui ont façonné historiquement la configuration géopolitique de cette zone, la civilisation romaine et catholique-latine, la civilisation orthodoxe et byzantine et la civilisation arabo-musulmane.
La Méditerranée occidentale constitue à elle seule une zone de contact et d’échanges entre plusieurs familles culturelles : le monde arabo-islamique, le monde de la francophonie, le monde hispanique et le microcosme italien. Or, comme l’a bien remarqué Zaraket Raïd, « il n’y a aucune symétrie entre ces familles : l’ensemble francophone est fortement centralisé ; l’ensemble hispanique paraît plus intéressé par son intégration à l’Europe que par ses membres ; la famille culturelle arabe, durant les quatre ou cinq dernières décennies, s’est caractérisée par la création d’un espace culturel unifié »(3). Il est certain qu’à toutes les époques, la Méditerranée a été un vecteur majeur et précoce de mouvement des populations. Mais ces mouvements migratoires, souvent portés par le commerce ou la conquête, de l’expansion romaine aux conquêtes arabes, des croisades à la colonisation, n’ont pas abouti à l’homogénéisation du monde méditerranéen, mais bien plutôt à la redistribution des composantes de son identité – quand ils n’ont pas, purement et simplement, révélé ou accentué des disparités économiques et des fractures socio-spatiales. Les migrations, dont les îles, les détroits, les ports et les zones-frontières ont constitué les pôles, ont incontestablement contribué à créer une culture de la mobilité, mais celle-ci n’a pas été antagoniste des enracinements, qu’il s’agisse de la culture arabo-andalouse ou de l’influence européenne au Maghreb ou au Proche-Orient. Les mouvements humains, pourrait-on dire, ont dans le passé accentué les contrastes plus qu’ils ne les ont effacés. La diversité n’est pas seulement une affaire de langue ou de religion. Ce n’est pas ici que j’aurai besoin de rappeler qu’une langue n’est pas seulement un moyen « technique » de communication, qu’il suffirait de pratiquer couramment pour que tous les problèmes entre locuteurs de différentes cultures se trouvent aplanis. La langue est aussi porteuse d’une vue du- monde. Elle véhicule tout un univers de représentations, de modes de pensée, de valeurs et de symboles qui prennent place dans un système de significations partagées. Elle a une dimension culturelle, mais aussi politique et sociale. Elle transmet des façons spécifiques de mettre en jeu le corps, l’espace et le temps dans l’interaction sociale. Les disparités infranationales entre les pays méditerranéens existent toujours, pour le meilleur comme pour le pire. Il faut en tenir compte.
Le « métissage » est aujourd’hui à la mode, et cette mode est chargée d’équivoques sur lesquelles il faudrait sans doute s’interroger. A l’origine, le terme était d’emploi purement bio-anthropologique. Aujourd’hui, utilisé de façon laudative (le plus souvent) ou péjorative (plus rarement), il sert indistinctement à qualifier n’importe quelle forme de rencontre, de dialogue, de confrontation, de mixité, de confrontation, de fusion, etc. C’est beaucoup trop. Comme l’écrit encore Zaraket Raïd, « reconnaître le métissage et l’accepter ne suffit pas, si cette tolérance que fait que masquer un cannibalisme culturel ». L’idée d’un nécessaire « métissage », présenté comme à la fois la condition nécessaire et l’aboutissement logique du dialogue interculturel, rend en réalité ce dialogue plus difficile, d’abord parce qu’il reste soumis à des rapports de force inégaux (d’où le risque de « cannibalisme culturel »), mais aussi parce qu’en le posant de cette façon on fait du rapprochement des cultures une menace pour l’identité des sociétés des deux rives de la Méditerranée. Le dialogue risque ainsi à tout moment de déboucher sur l’équivalence ou l’insignifiance, qui sont la négation même de sa raison d’être. Le maître-mot de tout véritable dialogue est la réciprocité. Or, il ne peut y avoir de réciprocité sans altérité des partenaires, sans reconnaissance, et par conséquent sans maintien, de cette altérité. Un dialogue qui fait passer la « compréhension » par la négation de l’altérité travaille en fait pour la Mêmeté, c’est-à-dire pour l’éradication de toutes les identités, rejoignant ainsi le rouleau compresseur de la logique du profit, qui aspire à transformer la planète entière en un vaste marché homogène. Or, la fusion de toutes les identités culturelles au seul profit de la culture de la marchandise est sans conteste l’une des principales menaces de notre époque.
Si le « métissage » aboutit à réduire la mosaïque des identités culturelles caractérisant chaque peuplement méditerranéen, pour les fusionner toutes dans un magma uniforme, alors il ne sera qu’un outil de l’idéologie du Même, qui progresse aujourd’hui dans le monde par d’autres moyens. Le chant méditerranéen doit au contraire rester un chant polyphonique. La dernière menace dont je parlerai réside dans ce que j’appellerai le risque d’une « inversion des pôles ». J’entends par là le risque pour le Sud de se mettre à l’école exclusive du Nord, de n’envisager son avenir que comme le prolongement méridional d’un Nord qui, malheureusement, semble s’être mis aujourd’hui tout entier au service de la Forme-Capital et de la logique du profit. De fait, il n’est pas de jour où le Sud ne se voit pas enjoindre de se « moderniser » en adoptant comme valeurs suprêmes des valeurs de rentabilité, d’efficacité, d’utilité, de calcul et de profit, toutes valeurs historiquement associées à l’individualisme bourgeois. Le Sud se voit reprocher ses structures sociales « d’un autre âge », sa mentalité « archaïque », si contraire à l’idéologie du progrès comme aux exigences du marché. On prétend que son « développement » passe par sa conversion à l’idéologie dominante mondiale, c’est-à-dire par le renoncement à ce qui, dans l’histoire, a fait sa spécificité. Mais l’idéologie dominante est toujours l’idéologie des dominants. Et la domination des valeurs marchandes, au détriment de tout ce qui ne relève pas de l’approche comptable, entraîne une véritable transformation anthropologique par le biais de la colonisation de l’imaginaire symbolique.
Le Nord a ses qualités propres, mais ce n’est pas en cessant d’être le Sud que le monde méditerranéen résoudra les problèmes qu’il connaît aujourd’hui. C’est au contraire en prenant appui sur son expérience et sur sa personnalité propre qu’il pourra trouver par lui-même et en lui-même les conditions de ses métamorphoses futures. De ce point de vue, ce serait sans doute une erreur, pour les pays méditerranéens, de donner trop de priorité à une construction européenne qui, après avoir représenté un grand espoir, apparaît aujourd’hui surtout porteuse de craintes et de désillusions. L’Europe actuelle est une Europe sans volonté, qui n’a plus pour ambition que de devenir la partenaire de l’Amérique au sein d’un ensemble « transatlantique » dominé par la principale puissance mondiale. La Méditerranée, parce qu’elle est une « mer à l’intérieur des terres », n’a pas à obéir à la logique océanique. Cela ne signifie pas qu’elle doit rester statique, qu’elle ne doit pas évoluer, mais qu’elle doit rester fidèle à sa manière propre de se transformer, qui n’est comparable à nulle autre. Cela signifie qu’elle constitue un monde à elle seule, et non pas l’appendice d’un autre monde. Cela signifie qu’elle doit continuer d’incarner une histoire, et non devenir l’objet de l’histoire des autres.
Je vous remercie.
Alain de Benoist
1. Jean-Paul Gourévitch, Le rêve méditerranéen. D’Ulysse à Nicolas Sarkozy, L’OEuvre, Paris 2009, p. 19.
2. Cf. Pierangelo Catalano, « Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques », in Aspects, 1, 2008, pp. 27-41.
3. Zaraket Raïd, « Identité méditerranéenne et francophone : l’histoire d’une altérité et d’un partage », in Ethiopiques, 74, 1er semestre 2005.