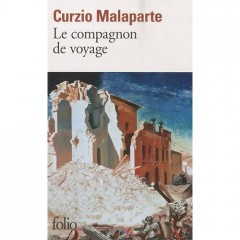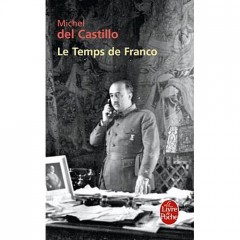Hervé Juvin : Je ne suis pas sûr qu’il n’y ait pas, au lieu d’un Occident, plutôt des Occidents, au pluriel, et de plus en plus. L’intervention américaine dans l’ex-Yougoslavie, pour ne citer qu’elle, est un moment où l’Occident s’est sans aucun doute battu contre lui-même. On peut en dire autant de la crise financière, qui a vu l’opposition anglo-américaine contre l’Europe s’exacerber. En fait, il faut revenir à ce moment particulier, non pas tant de la chute du mur de Berlin que de la dissolution de l’Empire soviétique, dont on oublie toujours de rappeler à quel point elle fut éminemment et très curieusement pacifique. De là va résulter un mouvement d’euphorie qui traversera quasiment tout l’ensemble occidental et dont l’expression emblématique restera le livre de Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme. Trois raisons à cela : d’abord, l’on assistait à la fin du colonialisme ; ensuite, l’on voyait l’explosion du bloc qui incarnait non seulement le Mal, mais encore plus sûrement l’Autre absolu ; enfin, l’on pouvait estimer que la démocratie était en train de s’universaliser. Autant de raisons qui nous ont poussés à croire qu’il était possible de s’abstraire de la condition politique. Or, la condition politique, c’est essentiellement deux choses : le fait qu’il y a des hommes, et non pas l’Homme avec un grand H, comme le remarque si bien Hannah Arendt ; et le fait qu’il y a des frontières, à l’intérieur desquelles les hommes exercent la liberté de s’autodéterminer, dans le cadre d’une nation, à travers un État souverain et un territoire national clos.
Autrement dit, les Mêmes décident de ce qui concerne les Mêmes : les décisions que prend le peuple français n’engagent que les seuls Français, du présent et des générations à venir, pas les Américains, les Russes, les Marocains, etc. Or, on assiste pendant plus d’une décennie à la mise en apesanteur de cette condition politique. Comme les frontières vont disparaître et la démocratie planétaire s’étendre partout, il n’y aura plus que des individus, tous voués à la poursuite du bonheur, tous habités par un désir illimité. Dès lors, le seul principe de régulation des individus sera l’économie ou le marché, bref ce phénomène extrêmement important que l’on va désigner sous le nom de globalisation.
Vous expliquez également que cette globalisation repose sur une alliance objective entre l’ État et le marché. Quelle forme a-t-elle prise ?
Dans les années 1990, nous sommes entrés, sur le plan politique, en territoire inconnu, par suite de la diffusion des Droits de l’Homme, perçus comme un droit illimité de l’individu à se départir de tout collectif, à briser tout lien, à nier toute appartenance, à se désengager de tout rapport durable et pérenne avec les siens. De défensifs, le sans-frontiérisme et le mondialisme sont ainsi devenus agressifs. Parler de nationalités, de frontières et de souveraineté vous faisait passer pour démodé et vieux jeu, sinon carrément indécent. Le Droit et le Marché prétendaient alors se substituer au Politique dans une conjuration tout à fait étonnante qui devait déboucher sur une libération de l’individu et même du collectif, toutes deux éminemment bénéfiques. Le phénomène a été abondamment commenté, notamment par les penseurs socialistes issus de l’extrême gauche dans les termes les plus enthousiastes. Ce sont les grands mots de «société citoyenne» ou «société civile», lesquelles viendraient reprendre leurs droits.
Il n’en fut rien. Ce à quoi on va assister, c’est au contraire à l’apparition d’une configuration tout à fait inédite, mise en évidence par la crise, dans laquelle, comme Marx et Nietzsche l’avaient bien vu dès la fin du xixe siècle, l’ État ne va plus se définir que contre le peuple, et même contre les peuples, parce qu’il devient l’infrastructure de déploiement du marché, du libre-échange, de la circulation indéfinie des capitaux, des biens et des personnes. La grande entreprise entreprend de changer les peuples, organisant l’invasion et le démantèlement des Nations, avec le concours d’ États tenus par des engagements arrachés par Bruxelles sous l’influence anglo-américaine. C’en est fini du principe majoritaire, du suffrage universel et de la démocratie représentative. Le paradoxe, c’est que tout cela va se faire sous l’égide du Droit, alors qu’on assiste au retour des principes constitutifs de la Colonisation. Car si l’on veut bien poser un regard un peu décapant et inhabituel sur la situation actuelle, il faut revenir à la conférence de Bandung, en 1955, réunion d’ États asiatiques et africains qui annonce la fin de la période coloniale et l’avènement d’un nouvel ordre du monde. A cinquante ans de distance, il ne fait aucun doute que l’appel de Bandung a été entendu, puisque la décolonisation politique a été effective. Mais il est tout aussi évident que l’on a assisté parallèlement à une colonisation interne des sociétés humaines par la finance de marché et l’économie. De façon inattendue, violente, avec une rapidité ravageuse, l’économie a pris le pouvoir. Cela uniquement parce que les États ont mis à la disposition du marché leurs infrastructures, dont celles relevant de la sécurité, de la censure et du contrôle des populations. Telle est la configuration que la crise a révélée. J’en veux pour preuve la promptitude avec laquelle les États ont volé au secours d’établissements financiers et de sociétés d’assurance en situation de faillite (et qui auraient mérité d’être faillis), en mobilisant avec une rapidité impressionnante toutes leurs ressources, qui sont en dernier ressort celles du contribuable.
La globalisation occidentale serait donc la fille des colonialismes européens ?
Le colonialisme du xixe siècle, c’était déjà le rêve d’un monde sans limites, d’une nature inépuisable, et plus encore l’idée que le monde s’offrait aux colons blancs pour en user à leur guise parce qu’ils étaient les détenteurs de la civilisation, de la morale et du Bien. On oublie d’ailleurs toujours de rappeler que quelques-uns des plus éminents dirigeants socialistes de la IIIe République furent les plus ardents colonisateurs. Mais les colonialismes européens étaient nationaux, plus que religieux ou financiers. C’était la France, l’Allemagne, l’Angleterre, qui plantaient leurs drapeaux. Aujourd’hui, le régime des colons se déploie sous l’influence américaine, et, dorénavant, chinoise. Si le modèle américain, c’est certes celui de la première libération d’un peuple du colon britannique, c’est aussi celui d’un développement par l’éradication des indigènes. Le génocide indien libère la terre pour l’exploitation infinie du colon.
Nous assistons aujourd’hui à l’extension mondiale de ce système. Le droit du colon, c’est-à-dire celui du développeur et de l’investisseur capable de rentabiliser n’importe quel actif, est jugé supérieur à celui de peuples autochtones et indigènes à demeurer sur leur sol, selon leurs mœurs, lois et règles.
Le droit au développement masque l’obligation de se développer… ou de partir. Contre l’économie, nul ne saurait se dresser légitimement. C’est exactement ce principe qui préside à la colonisation interne de nos sociétés, par exemple à l’obligation d’accepter l’immigration de peuplement.
Pour le dire très clairement, le principe de la colonisation étendue à la totalité du monde est en train de recréer un vaste marché de l’esclavage, en contraignant toutes les ressources terrestres à fonctionner dans le système économique à un prix de marché jugé universel. Ce qui constitue la négation absolue du droit des autochtones à disposer d’eux-mêmes. L’événement nouveau et renversant, c’est que nous, Européens, sommes en train de subir le même phénomène d’humiliation, d’expulsion et d’invasion, qu’enduraient jadis les colonisés. Interdits d’identité, bafoués dans nos mœurs et lois, privés de nos mots et expressions, au nom d’une conformité sur laquelle veillent les chiens de garde de la nouvelle Internationale, nous nous rapprochons insensiblement, mais rapidement, de la condition des indigènes si bien décrite par Claude Lévi-Strauss. A quand des réserves pour les Français de souche ? La lutte pour la décolonisation interne de nos sociétés sera le sujet politique de la génération à venir. Ce sera l’occasion d’affirmer une nouvelle radicalité républicaine, l’occasion aussi de réaliser l’union de tous les peuples contre l’entreprise mondialisée et la finance satellisée.
Pensez-vous que la survie même des nations occidentales soit engagée dans ce processus néo-colonial ?
Après 1990, se sont développés un discours et une idéologie abrités sous le double biais du libre-échange, garant de la croissance et de la stabilité des prix, et de la liberté de mouvement des hommes, garante de la paix dans le monde comme du droit de chacun à poursuivre son bonheur privé. Il s’agissait clairement d’une idéologie de la disparition des nations. On voit aujourd’hui avec quelle naïveté l’Union européenne l’a endossée, estimant que la poursuite de la construction européenne ne pouvait se faire qu’en défaisant le national. Une telle politique comportait un risque considérable : en détricotant les nations, on réveillait le démon des origines, celui des religions, mais aussi des régionalismes qui sont en train de gagner toute l’Europe. Aveugles aux conséquences de la mondialisation – déracinement, désaffiliation, désappartenance –, nous n’avons pas voulu voir la violence qu’elle ne manquerait pas de semer dans le monde. Or, l’on sait – ou l’on devrait savoir – que rien n’est plus capable de violence, et d’une violence illimitée, qu’un homme seul, réduit aux émotions et aux passions, privé de liens, d’attachements et, souvent, de convictions. Ce modèle de « l’homme sans qualités », de l’homme-bulle, de l’homme en apesanteur, est le produit de la société de marché et l’idéal de la démocratie planétaire. A nier la condition politique, nous avons pensé que l’individu absolu était l’homme du futur, alors qu’un tel individu, non seulement, n’existe pas, mais peut s’avérer être un monstre capable de tout. Ce que nous commençons à entrapercevoir, ici ou là, dramatiquement. La mondialisation a donc sécrété une extrême violence. En sortir appellera en retour une violence identique. En clair, nous sommes partis pour une phase qui va répondre, au moins à moyen terme, à la brutalité de la mondialisation, sur fond de retour des questions de frontières, d’identités de souveraineté, de légitimité, lesquelles vont laisser muette une large partie de la classe politico-intellectuelle, qui, depuis une génération au moins, a désappris à penser la politique. Le temps de la décolonisation interne de nos sociétés est venu.
A vos yeux, les chefs d’ État occidentaux sont donc directement responsables de la crise que le monde traverse depuis trois ans ?
La crise a d’abord été une crise du sans-limite. Il est clair que lorsque des entreprises, qui se disent privées et n’apportent de l’argent qu’à leurs seuls actionnaires, tout en faisant jouer un effet de levier sur le collectif – État et contribuable –, parce qu’elles sont, selon l’expression consacrée, « trop grosses pour mourir », c’est qu’elles ont au préalable trop grossi. Cet effet de levier sur la collectivité n’est pas tolérable.
Seconde faute majeure, celle de l’interdépendance. La crise a été manifestement une crise de l’interdépendance. Or, si nous avons été sauvés, c’est par des pays dont la monnaie n’est pas convertible et qui se sont protégés des excès des mouvements de capitaux et de l’économie de marché. En somme, nous avons été sauvés parce que l’interdépendance n’est pas planétaire. Mais quels sont les conseils prodigués, au terme de la série des G20 suscitée par l’Occident, pour sortir de la crise ? Accroître l’interdépendance (on le voit avec la pression exercée sur la Chine et l’air pincé des institutions mondiales à l’encontre de pays comme l’Inde ou le Brésil qui refusent l’afflux de capitaux spéculatifs). C’est donc aussi une crise de l’absence de responsabilité. Ceux qui, par cupidité et refus de tout lien avec une communauté ou une collectivité quelconques, en ont été à l’origine ne veulent endosser aucune responsabilité, et même pour la plupart, ne seront tout simplement pas remis en cause. Les Américains n’ont-ils pas l’insolence de faire la leçon au monde ? On voit pourtant bien que le règne de la conformité à la norme et à la règle ne résout rien, tant il est vrai que la responsabilité ne s’exerce que devant une communauté ou une collectivité définies, la responsabilité planétaire n’existant pas. Mais encore une fois, ce qui a triomphé, c’est le principe du renard libre dans un poulailler libre.
Ce qui me conduit à ce constat quelque peu désolant : tout indique que nous sommes dans un système de crise. La crise, c’est ce que l’on a inventé de mieux pour casser les systèmes de protection sociale en Europe, pour étendre le règne du marché et pour liquider tout ce qui dans les sociétés humaines et les peuples constitués n’entendait pas s’abandonner à l’interdépendance et à la loi du marché mondial. Voilà où nous en sommes : tout faire pour que rien ne change, tel est le credo inentamé de l’Occident. Mais ajouter des liquidités à une mer de liquidités pour éviter la déflation, réclamer plus d’interdépendance pour faire financer le naufrage américain et occidental par ceux qui ont préservé jusqu’ici leur autonomie, tout cela ne pourra pas fonctionner. Le sauvetage du système peut faire illusion un moment, mais il ne fera que rendre la crise encore plus grave, par renforcement des illusions du libre-échangisme, du mondialisme et du sans-frontiérisme. Alors que ce à quoi devraient travailler les décideurs et responsables, c’est précisément de préparer l’après.
Ce que naturellement ils ne font pas ?
Parce qu’il s’agit avant tout de parer au plus pressé, parce que l’ensemble des cadres intellectuels mis en place depuis plus d’une trentaine d’années sont devenus totalement obsolètes. Nous devons nous habituer à la fin de l’universel, réapprendre que la condition humaine ne se réduit pas à l’existence d’un homme-bulle en apesanteur, redécouvrir les identités, les frontières, les nations, les religions, les passions politiques. Bref, nous devons rouvrir les yeux sur le monde. Or, en Europe et aux États-Unis, on semble persuadé que les autres sont destinés à devenir pareils à nous. Ce qui nous épargne d’avoir à nous y intéresser. Nous avons jadis conquis le globe parce que nous avons été extraordinairement riches en mondes, capables de nous intéresser à l’Autre, d’essayer de le comprendre, infiniment curieux, observateurs et ouverts. Mais voilà, nous sommes devenus pauvres en mondes. Nous ne voyons pas la manière dont le monde se renverse. C’est probablement le plus grand sujet d’inquiétude pour les années à venir. J’invite tous les dirigeants à partir à la redécouverte du monde. C’est la tâche la plus essentielle aujourd’hui. Il faut se départir de cet immense mensonge, quasiment criminel, selon lequel le monde serait devenu plat. Le monde n’est plat que pour ceux qui vont d’aéroports en Hilton et d’Hilton en aéroports. Nous sommes aveugles à l’impressionnante montée de l’Islam, facteur géopolitique aussi important que l’avènement de la Chine ; aveugles au contrôle d’Internet par les États-Unis ; aveugles au discrédit du soft-power occidental, résultat du « deux poids, deux mesures » appliqué dans le domaine nucléaire aussi bien que dans les agressions américaines contre l’Irak et l’Afghanistan ; aveugles aux renaissances politiques que provoquent les agressions des fonds d’investissement sur les terres agricoles ; aveugles aux effets de la diffusion planétaire des technologies de communication.
Propos recueillis par Philippe Marsay