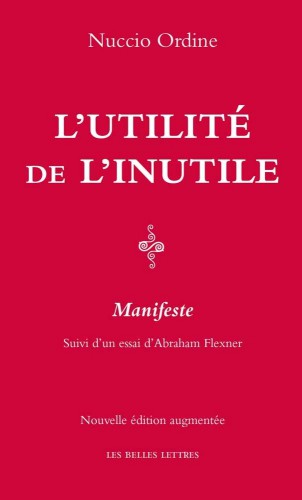Droit du travail : socialisme ou barbarie
La pensée unique consiste à rendre naturelle une évidence, au point que, comme Monsieur Jourdain, on fasse de la prose sans le savoir. C’est tout l’art d’une propagande protéiforme, mais univoque : une seule voix se propage (d’où la propagande), comme un bruit de fond, une musique lancinante qui imprègne les cervelles sans qu’on y prenne garde, et d’autant plus persuasive qu’elle s’écoule par mille bouches, celles des responsables politiques, des journalistes, des « experts », du MEDEF, en somme, des autorités. Il n’en faut pas davantage pour qu’une doxa, une opinion d’ensemble s’impose, marginalisant toute contestation authentique, considérée comme farfelue ou dangereuse.
L’une de ces vérités patentes, outre le métissage de la société, l’abolition des frontières ou l’égalitarisme pour tous, consiste à présenter la loi des marchés et l’adaptation de la société, notamment du code du travail, comme des nécessités contraignantes, dont l’on ne peut s’abstraire. Hors de là, point de salut. C’est en quelque sorte notre destin.
Le fait vaut le droit. « C’est comme cela » équivaut à une loi. Il est vrai que le libéralisme s’est toujours voulu naturel, la main du marché étant l’analogie d’un mécanisme universel dont la dynamique aboutirait à un équilibre, un peu comme dans une jungle.
Tout ce qui gêne le mouvement vers le progrès, la liberté de traiter, de produire et de manœuvrer, doit un jour disparaître. La Commission de Bruxelles ne cesse de donner le la de cette symphonie mondialiste, en écho aux organisations qui régissent l’ordre économique international, et surtout en réponse aux marchés financiers dont les oracles sont les agences de notation.
Il est donc entendu qu’un salarié doit se laisser licencier avec bienveillance, presque avec des remerciements, que la population doit, avec la même gratitude, se voir déposséder de ses droits sociaux, de ses protections, parce que les charges qui en sont la source, les dispositifs législatifs, qui les pérennisent, constituent une gêne pour nos champions de l’industrie, du commerce, et surtout des affaires. Un kit lexical est à la disposition de tous les agents d’endoctrinement, qui usent volontiers, pour enfumer, comme des charlatans de foire, de termes comme « moderniser », « bouger », « archaïsme », « rigidité », « adapter », « flexibilité » etc. Tout responsable qui adopte ce jargon doit être considéré, par les classes populaires, comme leur pire ennemi.
Comme nous ne sommes plus dans un système politique autoritaire et répressif, toute la maestria de la gauche et de la droite consiste à faire passer la pilule en douceur. L’arnaque, en ce qui concerne les négociations sociales qui se sont achevées le vendredi 11 janvier, a consisté, de la part de certains syndicats, du patronat et du gouvernement, à présenter leur conclusion comme un accord « gagnant-gagnant. En réalité, il s’agit d’une régression sociale, sans doute la pire depuis 1945, car les décisions qui ont été prises démantèlent les principes affirmés par le Conseil National de la Résistance.
La tromperie vise à faire croire que la « sécurisation » regarde autant les employeurs que les employés. En réalité, ce qui est présenté comme avancée (extension des complémentaires santé, « portabilité » des droits en cas de changement d'entreprise, amélioration de la formation et de l'information des salariés sur la stratégie de l'entreprise, droits des chômeurs renforcés, taxation des emplois précaires …), pour autant qu’il en résulte des changements substantiels dans le sort des salariés ou des chômeurs, ne suffit pas à masquer l’essentiel, à savoir que, désormais, les patrons ont le droit de licencier à volonté. Mieux, ou pire : il n’existera plus de CDI. Le CDD deviendra la norme dans le secteur privé, et dans celui du public soumis aux règles contractuelles. Ce dont rêvait Sarkozy vient de se réaliser sous un gouvernement « socialiste ».
Nous savons tous que la rhétorique contemporaine relève du théâtre. On fait croire que l’on s’affronte, et l’on se répartit les tâches : une équipe entame le travail, que l’autre, après alternance, achève. Le jeu est de faire croire à l’existence d’une gauche, qui critique l’ « injustice » d’une droite au pouvoir, quitte à appliquer son programme une fois au gouvernail, ce que n’a pas manqué de faire le parti socialiste depuis trente ans, ou, pour la droite, de marquer aux talons une gauche trop « timorée » dans les « réformes indispensables », et que l’on taxe de « socialiste », de « fiscaliste », de façon à se donner des raisons de démolir encore plus le modèle français, considéré comme périmé.
Cette réforme du code du travail est, en vérité, une hypocrisie de plus, car loin d’ouvrir des perspectives à un patronat soi-disant étouffé, elle ne fait que rendre visible légalement l’état de fait qui meurtrit et déprime la société française : car de nos jours déjà, lorsque l’on n’est pas au chômage, si l’on cherche un travail, on a désormais toutes les chances de n’obtenir qu’un emploi précaire, dont le taux est même supérieur à celui de l’Allemagne. L’intérim a explosé, les CDD de moins d’un mois ont quasiment doublé. Du reste, la Grande Bretagne, en stagnation, comme d’autres pays engagés profondément dans le libéralisme, montrent que la flexibilité n’entraîne pas forcément une amélioration de la situation économique. On risque même d’assister à une surenchère dans le dumping social, chaque pays voulant s’aligner, dans un système ouvert, sur ceux qui proposent les moindres coûts du travail. Ainsi, face à la menace d’une perte d’emploi, que le patronat peut décider sans mesure, le salarié n’a plus guère le choix que d’accepter une baisse de salaire, une mutation, ou un temps partiel.
Laurence Parisot, présidente du MEDEF, peut prétendre alors que cet accord « marque l'avènement d'une culture du compromis après des décennies d'une philosophie de l'antagonisme social », il s’agit plutôt d’une victoire patronale totale.
Plus personne n’est surpris par la politique d’une gauche qui ne cache même plus son libéralisme enthousiaste. Les coups de gueule de Mélenchon ou de Pierre Laurent sont des pétards mouillés : tout devrait rentrer dans l’ordre au moment des élections municipales de 2014… Au demeurant, leur seul rôle est de donner l’impression qu’il peut exister encore une vraie gauche, ce dont seuls les journalistes, qui sont payés pour cela, font mine de croire.
Un satisfecit patronal pour Chérèque, secrétaire de la CFDT, un de ces traîtres de théâtre de boulevard comme on n’en fait plus, est aussi à mettre à l’ordre du jour. Il a d’ailleurs si bien rempli son devoir, depuis tant d’années, qu’il a été récompensé par son ami Hollande, qui l’a nommé à l’Inspection générale des affaires Sociales (8 000 € d’émoluments pour se rouler les pouces). Par la même occasion, il devient le président de la strauss khannienne Terra Nova (comme Nicole Notat avait présidé le très élitiste Dîner du Siècle), qui promeut frénétiquement l’idéologie californienne, combat qu’avait mené jadis Rocard, aux dernières nouvelles filant le grand amour avec Sarkozy.
Il est vrai qu’il est des marqueurs infaillibles. Il n’est pas anodin de désigner le « coût du travail » comme la source des difficultés économiques, tout en occultant les méfaits des licenciements boursiers, provoqués par les fonds de pension américains, ou les délocalisations, qui ne touchent pas seulement les entreprises employant de la main d’œuvre bon marché, mais aussi des savoir faire, des techniques, des industries de pointe et des secteurs de recherche.
La « gauche » française (nous mettons maintenant les guillemets qui s’imposent) s’insère sans complexe dans une « troisième voie » européenne, qui n’est en fait qu’une variante du libéralisme le plus cynique. Que ce soit avec Tony Blair, qui a suivi la politique thatchérienne, Schroeder (avec sa réforme du marché du travail dite Harz IV), Zapatero, pour qui abaisser les impôts est de gauche, Papandréou, dont on vient d’apprendre qu’il a reçu ses trente deniers pour avoir trahi son peuple, le social libéralisme, de moins en moins social, est devenu un recours capital pour le capitalisme en crise.
Le gouvernement Hollande n’a, par exemple, rien fait de mieux que de poursuivre, avec une célérité stupéfiante, et sans état d’âme, la politique entamée par son prédécesseur de « droite ». On n‘a même pas fait semblant d’œuvrer pour les plus pauvres. Le premier janvier, le smic a été augmenté de … 3 centimes de l’heure ! Quant à la mesure « emblématique » de la taxation des hauts revenus à 75%, projet qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel, il paraît pour le moins étrange que des énarques, épaulés par une cohorte de spécialistes, ne se soient pas rendu compte du défaut incapacitant de cette loi. Tout laisse à croire que cet « échec » était prémédité, préparé avec la complicité de la droite, et qu’au fond, en cachette, la satisfaction est assurée de voir une mesure, qui aurait risqué de déplaire aux marché, renvoyée aux calendes grecques seule demeure.
De toute façon, cette réforme n’aurait touché que 3500 contribuables, et n’aurait presque rien rapporté à l’Etat. Le symbole était destiné en revanche à dissimuler une vilénie d’ampleur !
Dernièrement, le projet de « relance de la « compétitivité », présenté le 6 novembre 2012, s’est vu gratifié de la brillante étude d’un gestionnaire que la droite envie à la gauche, Louis Gallois, lequel considère le CDI comme obsolète. Le résultat fut un cadeau fiscal de 20 Milliards aux grandes entreprises, et une hausse de la TVA de 0,4%. Mais non, ce n’est pas la TVA sociale chère à Sarkozy, si décriée par la « gauche »… quand elle était dans l’opposition , le 30 janvier 2012 : « L’augmentation de la TVA est inopportune, injuste, infondée et improvisée. »
« Une révolution copernicienne ! » s’écrie le lyrique Moscovici. Et pour cause !
Sarkozy avait préparé la signature du Pacte de stabilité budgétaire, assorti d’une « règle d’or », qui consistait, à terme, à ne pas dépasser un déficit de 0,5%. Hollande et Moscovici ne firent pas mieux que de s’empresser de le signer, malgré ce qu’avait affirmé Hollande, le 17 mars 2012 : « J’aurai le devoir de renégocier ce traité » européen. » Mesure libérale, s’il en est. Les rentes financières seront consolidées, tandis que, par la force des choses, il faudra trouver des économies un peu partout. C’est la fonction publique qui est visée, les subventions sociales, enfin la vision keynésienne de l’Etat providence.
Ce même Etat n’est pas en odeur de sainteté. Ayrault fait l’apologie des marchés et du mondialisme, appelant de ses vœux un gouvernement planétaire. Ce ne serait pas lui, affirme-t-il, qui diaboliserait les patrons ! A Pessac, Hollande, répudie l’aide publique aux entreprises et vante les investissements privés
Il faut rappeler que l’une des stratégies de la « gouvernance » postmoderne est de présenter le socialisme étatique comme l’unique alternative, nécessairement discréditée par l’Histoire, au libéralisme. Ce qui est un mensonge, comme nous le verrons.
Souvenons-nous aussi : il était question, parmi les promesses du candidat Hollande, de séparer les activités de banque de dépôt et de banque d’investissement. Résultat ? Néant !
Il faut dire que le beau monde se bouscule autour du président. Tous des libéraux, qu’on a quelque peine à créditer de quelque souvenir socialiste : le sulfureux, douteux J. Cahuzac, accusé par Médiapart d’avoir dissimulé en Suisse, puis dans un paradis fiscal, une somme importante, et qui nie farouchement que la lutte de classe existe, JP Jouyet, D.G de la CDC, H. Lavenir, patron de la CNP, Moscovici, Villeroy de Gallot, de la BNPP, H. de Castries, d’Axa, Jean Hervé Lorenzi, de la banque Rotschild, le déjà nommé Louis Gallois, ex de la SNCF puis d’EADS, Pascal Lamy, secrétaire de l'OMC (qu’a dit Lamy au président, le 27 décembre 2012, à l’Elysée, pour que Jean-Marc Ayrault publie dans Le Monde du 3 janvier, un article intitulé « Pour un nouveau modèle français » ?), et last but not least, Emmanuel Macron, un ancien de la banque Rotschild, qui conseille le président sur toutes les questions économiques.
On est loin du discours du Bourget, du 22 janvier, où Hollande désignait la « finance » comme l’ « adversaire ». Il est vrai que quelques jours après, à Londres, il disait exactement le contraire.
Combien d’exemples encore pourrions-nous donner, comme le refus de supprimer la défiscalisation des investissements dans les DOM-TOM, malgré les promesses électorales ?.
La « gauche » actuelle ne fait que poursuivre une stratégie lancée, dès 1985, par des dirigeants comme Delors (dont Pascal Lamy était le bras droit), puis Fabius etc. Les privatisations, qu’accéléra Jospin, allaient s’avérer catastrophiques pour le pays. Les capitaux privés ont été massivement délocalisés, avec des technologies industrielles importantes.
Les finances publiques, exsangues, obligées de s’en remettre au marché financier, véritable usurier, devaient nécessairement entrer en déficit, entraînant chômage et endettement, ruine accrue par une ouverture des frontières déraisonnable, à la mesure d’une idéologie libérale bruxelloise, enivrée par le dogmatisme.
On doit donc rembourser la dette. La spéculation a le dernier mot. La volonté politique est à son service. Pauvre Jaurès … La nation est devenue l’esclave des agences de notation, de Goldman Sachs, qui impose ses pions, un à un, dans les pays d’Europe.
Et pourtant, l’Argentine et l’Islande ont réussi ce qui semble impossible, envoyer balader cette dette, reprendre les rênes du pays, et se libérer. Pourquoi pas nous ? N’y a-t-il pas des raisons inavouables ?
Contrairement à ce que prétend l’infâme Cahuzac, la lutte de classe existe bel et bien. Non pas uniquement parce que les Français l’affirment à 64% (40% le jugeaient ainsi en 1964, et 44% en 1967), mais parce que c’est le capital qui fait la guerre au peuple. Ce dernier n’en a pas toujours bien conscience, même si, pourtant, la trahison des ouvriers de Florange montre pour qui roule le gouvernement.
Du reste, il ne s’agit pas de critiquer, en soi, un gouvernement qui prend des mesures impopulaires pour redresser le pays.
Mais le pays ne se redressera pas, car ces mesures obéissent à une logique qui a fait ses preuves, celle du libéralisme mondialiste, tombeau des peuples et de leur prospérité. Les règles déloyales de concurrence, qui mettent face à face des aires de civilisations complètement différentes, et de niveaux de vie inégaux, ne peuvent que nuire aux pays développés, sans garantir un progrès social et politiques chez ceux qui en profitent. En vérité, le libéralisme sème le chaos et la destruction, est facteur de conflits, de guerre, et déracine les traditions, au point que l’absence de repères jette les peuples dans le doute et le trouble, voire le désespoir.
Comme le rappelle opportunément Jean-Claude Michéa, le choix politique est avant tout une option morale. Ce n’est certes pas un critère que retiennent les thuriféraires du marché et de l’économie, les adulateurs du profit, de la spéculation et de l’argent-roi.
Et pourtant c’était ainsi que nos ancêtres voyaient la chose politique. Le socialisme n’avait alors rien à voir avec l’Etat ou la politique politicienne, encore moins avec le libéralisme. A l’époque de Pierre Leroux, inventeur du mot « socialisme », en 1832, auteur, en 1848, de la Ploutocratie ou le gouvernement des riches, pamphlétaire dont nous reproduisons la photographie, les souvenirs étaient encore vivaces, dans le peuple, des solidarités paysannes ou artisanales, des fraternités villageoises et des unions corporatives. Contre l’avidité d’une classe bourgeoise vulgaire et rapace, qui dénigrait autant la vieille France ancrée dans les traditions, que le peuple, troupeau digne d’être exploité, on estimait que certains comportements ne devaient pas exister.
Quoi de commun par exemple entre un ouvrier, un employé actuels, et un bobo enrichi, un parvenu de la politique qui a triché durant toute sa carrière, et a profité de manipulations propagandistes pour se faire un petit nid douillet ? Quoi de commun entre le chômeur ou le travailleur précaire, et le représentant syndical qui profite des dessous de table du patronat et roule dans une grosse voiture avec chauffeur ? Quoi de commun entre le SDF et le propriétaire de « gauche » d’un palais au Maroc ?
Le libéralisme est un utilitarisme qui place l’humain au service de la chose, de la consommation, de la production. Le progrès qu’il loue est l’accroissement des rentes versées aux actionnaires, l’augmentation du capital financier, seule forme de relation économique en adéquation totale avec l’abstraction universelle, la déterritorialisation, le déracinement, tous si bien incarnés par le nomadisme professionnel présenté sous le terme « flexibilité ». C’est le métier qui est nié, l’attachement à un travail qui humanise et intègre à la communauté, au profit du job, du boulot, de l’ « employabilité » fonctionnelle et condamnant à l’errance perpétuelle. Le système économique et social actuel est l’ennemi direct, mortel, du socialisme authentique, qui valorise la solidarité, la décence des relations, l’honnêteté et la vertu. L’individualisme en est la base, ainsi que l’atomisation forcée des personnes, devenues des individus réduits en esclavage.
Claude Bourrinet (Voxnr, 12 janvier 2013)