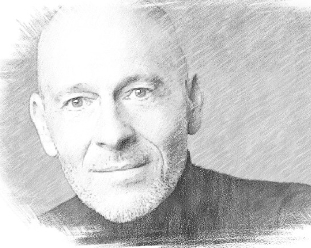Trump : la fin du soft power U.S. ?
Trump peut-il détruire le soft power américain ? Dans tous les cas, il suffit d’ouvrir un journal ou une télévision n’importe où dans le monde pour être au courant de sa provocation quotidienne, des manifestations ou des déclarations qui se déchaînent contre lui, des indignations qu’il suscite. Nixon au moment des bombardements du Vietnam ne provoquait pas plus de rejet, ou, pour employer un mot à la mode, n’était pas plus clivant. Et le contraste entre les mois Trump et les années Obama, dont le passage en France vient de montrer l’incroyable popularité hors frontières souligne le contraste.
Bien entendu, que l’image d’un homme ou d’une politique repousse n’implique pas que l’on parle moins anglais à travers le monde, que l’on porte moins de Nike ou que l’on programme moins de blockbusters, ni même que nos mœurs politiques ou autres s’américanisent moins en profondeur comme le montre Régis Debray dans Civilisation. Mais, si l’on considère que le soft power comprend un volet d’attraction spontanée, celle d’un mode de vie, d’une culture, des goûts des populations(au sens du mainstream, de ce qui plaît à tout le monde, sur toute la planète) mais aussi une part de stratégie délibérée de séduction, de réseaux et de persuasion, le second volet fait singulièrement défaut.
Au-delà du caractère d’un homme ou de l’image d’une politique, l’influence ne se réduit pas au fait d’être gentil ou de bien communiquer.
Comme on le sait, le terme « soft power » a été « inventé », ou au moins popularisé, par Jospeh Nye dans un livre de 1990, Bound to Lead.
L'émergence de ce concept-valise dans cette période s'inscrivait dans un contexte de soulagement (disparition de l’ennemi) et d'optimisme (la mondialisation heureuse). Il fait la synthèse d'une pluralité d'éléments :
- l'assimilation des industries culturelles américaines à un modèle universel : l'irrésistible attirance du contenu "mainstream" prolonge la prédominance politique et économique de l'hyperpuissance
- l'exemplarité du mode de vie US, que l'on cherche à imiter partout sur la planète, l'admiration pour une société ouverte et prospère
- plus largement encore, la notion qu'une sorte de sens de l'histoire qui menait l'humanité à adopter un même modèle politique, économique et culturel, favorisé par la fin de la grande confrontation Est Ouest et par l'émergence des nouvelles technologies
- le triomphe des valeurs occidentales confirmé par leur victoire contre le communisme
- et la stratégie qui semblait en découler : chercher le plus possible à obtenir le consensus, l'alliance et le soutien de autres nations. Bref, ne pas se montrer autoritaire pour rester séduisant.
Le tout repose sur deux éléments : l'absence de réelle compétition face à un modèle présumé triomphant, et la fin inéluctable de l'hostilité. Contrairement à la vision volontariste et agressive de la diplomatie publique antérieure (la lutte idéologique contre le communisme menée depuis les années 60 sous l’étiquette « diplomatie publique »), il ne s’agissait plus de gagner une compétition entre deux visions du monde ou de déstabiliser l'autre, mais d'assurer paisiblement une transition heureuse sur fond de pax americana. De ne pas contrarier un mouvement auquel tendent les lois de l'économie et de la technique (via la révolution de l'information ). Et d'attirer encore davantage vers ce que tous tendent naturellement à admirer.
Le 11 septembre bouleversa tout. Autant que la révélation de sa fragilité, l'Amérique fut frappée par le retour du tragique et du conflit. La figure de l'Ennemi revient et avec elle le principe de compétition idéologique. Dans un réflexe presque pavlovien, l'une de premières réactions de l'administration Bush fut de recréer un sous secrétariat d'État à la Diplomatie Publique. Ses missions : répondre à l'angoissante question "Mais pourquoi nous haïssent-ils ?", rétablir l'image de l'Amérique en lançant de nouveaux médias arabophones cette fois (et, modernité oblige quelques sites Internet), mener une politique de séduction envers le monde arabe en séparant ceux avec qui l'Amérique a "des valeurs communes" de "ceux qui haïssent notre liberté et notre mode de vie". Plus tard, on s’essaiera au contre-discours et à la déradicalisation comme réponse psychologique à un problème géopolitique. On commencera aussi à pratiquer quelques interventions pour soutenir des mouvements politiques de type révolutions de couleurs qui devaient liquider les derniers autocrates de la planète, avec de l’argent, des médias et une formation à l’activisme non violent.
Les schémas de guerre froide trouvent une nouvelle jeunesse dans une perspective de guerre au terrorisme (que l'administration Obama rebaptisera pudiquement "combat contre l'extrémisme violent"). Avec la même notion sous-jacente d'un malentendu : si les gens nous connaissaient vraiment, ils nous aimeraient. L'anti-américanisme est évoqué en termes de "misperception", comme si tout était affaire de mauvaise compréhension. Une bonne communication « basée sur les faits », qu’elle passe par des chaînes internationales ou par les réseaux sociaux (où va se déployer une diplomatie numérique) doivent y porter remède.
Durant les années Obama, l’image du personnage - celle qui lui permet, par exemple, d’avoir été le président américain qui a fait le plus de guerres et le plus longtemps pendant ses mandats tout en ayant la réputation d’être l’archange de la paix - occulte bien des choses.
D’abord la multiplicité des acteurs qui s’essaient au jeu du soft power. Les autres grandes Nations qui adoptent des stratégies d'image (on parle désormais de "Nation branding") et de communication. La prolifération des chaînes internationales d'information (y compris qatarie, saoudienne, vénézuelienne, russe...) en est un bon symptôme. La Chine, la Russie adoptent les mêmes méthodes : développement de médias internationaux, réseaux d’influence, protections de leur espace Internet et intervention sur celui des autres.
Mais les États ne sont pas seuls à jouer le nouveau jeu : les lobbies internationaux, les mouvements d'idées, les ONG, les groupes activistes transnationaux, etc. sont aussi entrés en lice avec des moyens de dénonciation, d'inspiration, de mobilisation jusque là inconnus. Ils sont désormais à même d'imposer leur thématique, leurs débats, leurs exigences à des États courant souvent derrière l'évolution de l'opinion pour reprendre le contrôle de leur agenda et l'initiative politique. Même les mouvements terroristes (après tout le terrorisme, "propagande par le fait" est aussi un moyen d'influence) fonctionnent avec des moyens d'expression nouveaux que ce soit sur le Net ou à travers des médias classiques (voir le Hezbollah se dotant d'une chaîne de télévision par satellite).
- Les réseaux numériques perturbent la donne. En interne, ils affaiblissent le contrôle des États : la critique venue de l'extérieur ou de l'intérieur, l’appel à la résistance et à l’action se développent avec le Web 1.0 puis 2.0. Tandis que dans le camp des démocraties, le discours officiel est contredit par le journalisme citoyen, la fuite ou le "whistle blowing" (de la circulation des images de sévices à Abou Graibh aux révélations à très grande échelle de Wikileaks). La tendance lourde d'Internet s'est exaspérée (une capacité de communiquer avec la planète entière à la portée de chacun, pourvu qu'il parvienne à mobiliser les réseaux de l'indexation, de la citation, de la recommandation etc, qui permettront à son message d'émerger et d'attirer l'attention de l'opinion en situation de surinformation). Du coup, ce qui enchantait l’Occident au moment du printemps arabe - l’État ne peut contrôler l’expression, les réseaux se jouent des frontières, l’information est produite par tout un chacun, émetteur et prescripteur à la fois - change de signe au moment de l’Ukraine et surtout de l’année de l’élection présidentielle US. C’est désormais la subversion 2.0 que l’on craint.
Avec la propagande djihadiste, les États-Unis ont découvert la résistance de croyances « archaïques » face aux effets sophistiqués des machines à produire du consensus global. En clair le fondamentalisme islamique se renforce du spectacle de nos démocraties et de nos modes de vie. Et, surprise, voilà que se développent des courants populistes, des idéologies « illibérales », assumées à l’est de l’Europe, et que la Russie recommence à exercer attraction et influence hors de ses frontières.
Le phénomène arroseur arrosé culmine en 2016 et 2017 quand l’appareil d’État américain se met à dénoncer la désinformation et les manipulations que subiraient les U.S.A. L’ingérence venue du froid est devenue une machine à expliquer la conduite des peuples qui votent mal (Brexit, Trump, Catalogne)... Moscou utiliserait conjointement les réseaux humains (sa cinquième colonne) et les réseaux virtuels pour répandre théories conspirationnistes et fake news. Pire, les Russes attaquent sur tous les fronts (cela s’appelle la guerre hybride) : interventions militaires et soutiens à des gouvernements ou mouvements armés, propagande par des médias internationaux (Russia Today et Radio Spoutnik), trolls et pirates en ligne, intrusions dans les ordinateurs du Parti démocrate ou de Macron pour faire fuiter des informations compromettantes, alimentation des réseaux de fausses nouvelles...
Que Trump se fiche du soft power, c’est une évidence. Il s’adresse bizarrement à son électorat, à des gens qui hurlent de joie chaque fois qu’il choque les médias et les élites, des gens qui l’ont, après tout, élu sur un programme isolationniste. Mais derrière Trump cause, il y a Trump symptôme. Celui d’une Amérique qui avait déjà perdu le monopole des moyens et de l’ambition de séduire la planète. Idéologiquement, en tout cas.
François-Bernard Huyghe (Huyghe.fr, 6 décembre 2017)