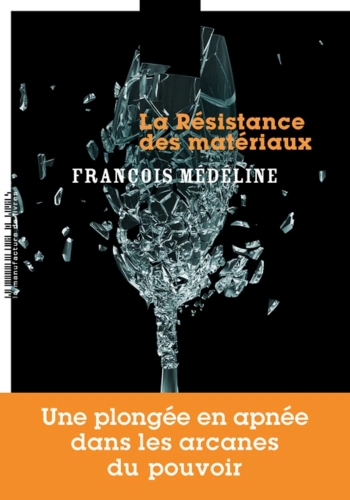Alain de Benoist : « Pour les libéraux « occidentalistes », c’est plus que jamais la Bérézina »
Une fois n’est pas coutume, il s’agit d’un tour d’horizon de l’actualité et non point d’un sujet spécifique. Que penser de la triomphale réélection de Vladimir Poutine, avec 76,6 % des voix dès le premier tour ?
Je m’en réjouis, bien entendu. Mais le plus important, c’est de constater que les seuls concurrents de Poutine étaient les communistes de Pavel Groudinine (11,7 % des voix) et les ultra-nationalistes de Vladimir Jirinovski (5,6 %), tandis que l’unique candidat libéral, Ksenia Sobtchak, a décroché le score mirobolant de 1,6 % des suffrages : à peu près le score de Philippe Poutou à la présidentielle de 2017 ! Pour les libéraux « occidentalistes », c’est donc plus que jamais la Bérézina. Emmanuel Macron (24 % des voix au premier tour, trois fois moins que Poutine) se trouve maintenant face à un nouveau tsar en Russie, à un nouvel empereur en Chine, à un nouveau sultan en Turquie, tous trois au summum de leur popularité. Partie inégale.
La tentative d’assassinat de l’ex-agent double Sergueï Skripal, dont les Anglais, immédiatement soutenus par Macron et par Donald Trump, ont immédiatement attribué la responsabilité à la Russie, n’a apparemment pas nui au maître du Kremlin ?
Elle a, au contraire, encore renforcé sa popularité. Les Russes savent mieux que personne que si Poutine a sans doute des défauts, il est difficile de le considérer comme un idiot. J’ai, pour ma part, beaucoup de mal à imaginer que Vladimir Poutine n’avait vraiment rien de plus pressé, à la veille d’une élection présidentielle (pour ne rien dire de la Coupe du monde de football), que d’aller faire tuer un individu inactif depuis plus de cinq ans, en utilisant un gaz neurotoxique pointant vers le Kremlin. Comme l’a écrit Slobodan Despot, autant laisser sur place sa carte d’identité ! Je comprends, en revanche, fort bien comment pareil coup monté pouvait être utilisé contre lui, afin de servir la russophobie des gouvernements et des médias. Quant au sort de Sergueï Skripal, il m’indiffère : je n’ai pas de sympathie pour les traîtres.
Nicolas Sarkozy mis en examen dans l’affaire d’un présumé financement libyen de sa campagne électorale ?
Sarkozy s’est, à mon avis, déjà déshonoré deux fois : la première en réintégrant la France dans le giron de l’OTAN, dont le général de Gaulle l’avait fait sortir, la seconde en déclenchant contre la Libye une guerre criminelle dont nous n’avons pas fini de subir les conséquences. Sur l’affaire dont vous parlez, je ne suis pas dans le secret de l’instruction. Je ne ferai donc de procès d’intention à personne, non par respect de la présomption d’innocence (ainsi dénommée par antiphrase, puisque c’est au contraire quand on est suspecté d’être coupable que l’on est mis en examen), mais parce que je n’ai qu’une confiance très mesurée dans la Justice de mon pays. En tout état de cause, si les charges étaient avérées, ce serait un scandale d’État sans précédent.
Le projet de réforme de la SNCF, incluant la remise en cause des privilèges des cheminots, et l’imposant programme de grèves annoncé par les syndicats ?
Les grèves des transports ne sont jamais très populaires, ce que l’on peut comprendre. Mais arrêtons de prendre pour boucs émissaires des cheminots dont les « privilèges » ne sont qu’une goutte d’eau face à ceux des grands patrons du CAC 40 ! Ce n’est pas la faute des cheminots si les trains n’arrivent plus à l’heure et si les lignes de chemin de fer ne sont plus entretenues. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de la gestion désastreuse qui a transformé la SNCF en tonneau des Danaïdes (47 milliards de dettes). La seule vraie question qui se pose dans cette affaire est de savoir si la SNCF va rester un service public au service de tous les usagers, où qu’ils habitent, ou si l’on va s’orienter progressivement vers une privatisation dont les conséquences inéluctables seront une hausse des tarifs (+27 % en Angleterre depuis dix ans) et la suppression programmée de centaines de petites lignes à la rentabilité insuffisante, ce qui accentuera encore la coupure entre les métropoles et la France périphérique.
Macron n’aurait jamais été élu sans le soutien massif des retraités et des fonctionnaires, deux catégories l’une et l’autre protégées jusqu’ici des effets de la mondialisation. Dès son élection, il s’est attaqué aux premiers, il s’attaque maintenant aux seconds, qui représentent 22 % du salariat. Il scie donc lui-même la branche sur laquelle il est assis. Le jour où la classe moyenne, qui se trouve déjà en état d’insécurité culturelle, se retrouvera en état d’insécurité sociale, les choses basculeront.
Les dernières élections italiennes ont vu la victoire massive des populistes de tous bords. Pour le moment, seule la France semble « résister » à cette vague en Europe. Pourquoi ?
Elle n’y résiste pas tant que ça, puisque les grands partis de gouvernement ont déjà presque disparu, et que c’est pour faire face à la déferlante populiste que Macron a saisi cette occasion d’engager une recomposition générale du paysage politique. Mais vous avez raison : la déferlante en question pourrait être plus ample. Ce qui manque, c’est un homme (ou une femme) susceptible de l’incarner.
Mayotte se trouve en première ligne face à l’immigration clandestine. Que faire ?
L’indépendance me semble être une bonne solution.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 26 mars 2018)