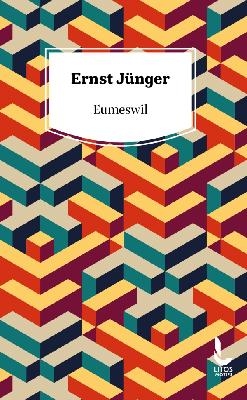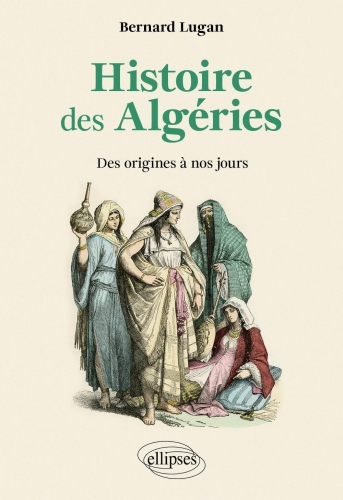Les frontières après Trump : Groenland et Panama
Le président Trump a stupéfait le monde des relations internationales en expliquant récemment qu’il souhaitait acquérir le Groenland ainsi que le canal de Panama, et qu’il n’excluait pas l’usage de la force à cette fin. Il ajoutait qu’il apparaissait naturel que le Canada soit lui aussi intégré dans l’Union, mais cette fois sans usage de la force.
Il va de soi que dans la logique de Donald Trump, ceci est largement un discours destiné à faire pression dans une négociation, et ne signifie pas automatiquement intention arrêtée de passer à l’acte. Cela pourrait aussi relever de son goût pour les provocations apparemment gratuites, ce dont Gaza vient de faire les frais de façon spectaculaire. Mais le cas du Groenland et du Panama est plus plausible.
Il est dès lors intéressant de le prendre au mot, et d’analyser la signification de telles déclarations pour le cadre international dans son ensemble.
Rappel de réflexions d’ensemble
Dans un billet précédent j’avais évoqué la question de la modification des frontières par la force. Je notais : « il peut être légitime de vouloir poser le principe d’un respect des frontières existantes, qui ne seraient pas modifiables sauf accord mutuel, et cela au nom de la paix… Cela dit, l’examen des précédents depuis 1945 montre que même s’il a servi de règle de base, le principe a connu une existence souvent chaotique. On a pu régulièrement s’assoir dessus, et même justifier son exact contraire, parfois par de grands arguments moralisants ».
Mais je rappelais par ailleurs que « la mise en œuvre du principe peut aboutir à des résultats embarrassants. Prenons le cas de Taiwan, reconnue comme partie intégrante de la Chine par la plupart des Etats. Le respect des frontières reconnues, compris littéralement, va ici manifestement dans le sens de Pékin. Ce qui choque. Et donc on cherche à moduler le principe… Soit en considérant qu’une frontière même contestable au départ devient légitime avec le temps, ce qu’en pratique on fait assez largement… Soit en se calant sur des procédures d’autodétermination… Mais si on retient ce critère, on risque justement de conduire à des remises en causes nombreuses des frontières existantes par toutes sortes de séparatistes, ou d’intervenants extérieurs, du plus souple au plus violent ».
Je concluais que « ce principe a rendu de réels services ici ou là. C’est un moyen de calmer le jeu, qui n’est pas à mépriser. Mais à condition de ne pas le voir comme le grand principe moral qu’on tend à en faire ; c’est simplement une règle pratique, pragmatique, permettant de maintenir la paix dans bien des cas. »
Le cas du Groenland
Que peut-on dire des cas évoqués ? Pas grand-chose sur le Canada, car Trump ne parle pas d’employer la force. Les deux autres sont de ce point de vue plus intéressants. En commun est le fait qu’ils constituent ou peuvent constituer des enjeux stratégiques majeurs, et qu’en même temps la population directement concernée est minime.
L’immense Groenland est un enjeu géopolitique majeur, dans la perspective du contrôle de l’Arctique et pour ses matières premières, et il le devient chaque jour plus avec le réchauffement climatique. Concrètement, même tout impérialisme mis à part, et sans vouloir choquer personne, on pourrait dès lors défendre l’idée que les 57 000 habitants actuels ne peuvent être le seul décideur, et peut-être même pas le décideur principal – ce qui n’exclut pas de respecter leurs droits par ailleurs (autonomie, accès aux fruits des ressources, culture etc.). En sens inverse, le principe d’autodétermination a un rôle réel : c’est, comme le respect des frontières, une balise, frêle, mais qui régule et limite quelque peu les appétits.
Qui d’autre alors aurait voix au chapitre ? Côté américain, la revendication est ancienne, mais n’a aucune base historique ou culturelle. Elle ne peut donc consister que dans l’affirmation d’un équivalent de la prise de possession d’une res nullius : cela revient à dire que le Groenland n’étant ni peuplé par une vraie nation, actuelle ou potentielle, ni capable de se défendre, ni d’exploiter ses ressources, un autre peut et doit le faire. Or, pourrait-on avancer dans cette ligne, les Etats-Unis sont ceux qui actuellement assument ces fonctions, même si c’est sur le mode mineur (notamment par une base militaire). Mais évidemment, dans un tel cas, d’autres pourraient avoir aussi des ambitions. En un sens, la déclaration d’intérêt de Trump est au minimum un moyen de dire à ces derniers : attention, ça m’intéresse, n’y touchez pas ou vous aurez affaire à moi.
Outre le principe d’autodétermination, une objection majeure vient évidemment du rôle du Danemark et derrière lui, de l’Europe. Jusqu’à récemment le Groenland était danois. Désormais, c’est un territoire autonome, simplement associé à l’Union européenne, mais dont le Danemark assume en théorie la défense, et qui demande l’indépendance. D’un côté donc, le lien existe, et dans la mesure où on entrerait dans le raisonnement précédent, les Danois seraient plus fondés que les Américains à revendiquer l’île, et derrière eux l’Europe. Cela dit, il ne paraît pas évident que ce soit l’option préférée des Groenlandais eux-mêmes. Mais d’un autre côté, sans l’appui déterminant des Américains, les Européens seraient incapables de défendre le Groenland contre une attaque par un grand pays. Il n’est donc pas évident qu’ils soient en état de revendiquer pour eux seuls la décision ; même s’ils sont légitimement une partie prenante.
Dès lors, en cas de pression soutenue de Trump, on peut concevoir qu’une solution se dégage après négociation, avec inévitablement un rôle appréciable des Américains. On peut aussi imaginer que la question passe dans l’arrière-plan pendant un temps.
Cela dit, la situation pourrait se tendre dans la zone, avec une vraie menace (russe, chinoise ou autre), militaire ou économique. Ce n’est pas le cas actuellement. Mais si cela se produisait, une action un peu brutale des Etats-Unis serait certes contraire au droit, mais ni incohérente avec leur comportement passé (et pas seulement au XIXe s.), ni purement arbitraire. Dans un cas extrême, ce serait peut-être même indispensable. Mais alors les Groenlandais seraient peut-être les premiers à la demander…
Le cas de Panama
Ce cas est assez différent historiquement, car l’Etat même de Panama a été de fait créé assez brutalement par les Etats-Unis (par sécession forcée hors de la Colombie, en 1903), justement à propos du canal. Ce dernier est une voie d’eau internationale majeure. En outre, les Etats-Unis en avaient gardé le contrôle total jusqu’en 1999, le retrait faisant suite à une décision de restitution prise sous le président Carter.
Si donc les Américains revenaient sur cette décision, en reprenant le contrôle du canal, ils pourraient évoquer le précédent historique. Ils pourraient en outre, comme pour le Groenland, souligner l’intérêt majeur du canal ainsi que l’incapacité du Panama (pays de 4,5 M d’habitants, sans armée véritable) de le défendre contre une puissance agressive. Plus, inversement, le risque éventuel d’un pouvoir local qui en fasse un usage hostile. Et, contrairement au Groenland, ils sont la seule puissance ayant vocation à intervenir.
Là aussi, sauf négociation aboutissant plus ou moins paisiblement à une solution, un usage de la force ne serait certainement pas fondé à ce stade. Mais si une vraie menace devait se concrétiser, il ne faudrait pas s’étonner de voir les Américains agir. Et, au moins dans certaines circonstances (non réalisées à ce jour), cela pourrait se défendre.
Conclusion
En conclusion, il ne faut voir en l’espèce les paroles de Donald Trump ni comme des paroles en l’air, ni comme de la pure arrogance irrationnelle. L’intérêt des Américains a une certaine rationalité. Mais sauf concrétisation manifeste d’une menace sur ces territoires, actuellement non avérée, l’usage direct de la force peut difficilement être défendu.
Une telle action, si elle se produisait, serait en outre un coup de canif appréciable dans une conception westphalienne des relations internationales, où en principe on respecte la souveraineté des autres ; et a fortiori si on se réfère à une norme basée sur le droit. Certes, on l’a rappelé, ce ne serait pas le premier de ces coups de canif. Mais la manière de faire serait un élément nouveau. En effet, même si sur Panama ou même le Groenland on pourrait soutenir que le réalisme donne quelconque consistance aux objectifs de Trump, le fait d’assumer sans complexe un comportement régulé par ses seuls intérêts et envisageant sans retenue le recours à la violence pour les satisfaire constitue un élément nouveau dans les relations internationales actuelles.
Bien sûr, on resterait dans le contexte d’un interventionnisme militaire américain qui est une donnée quasiment permanente depuis 1945 (sauf, étrangement, sous Trump I !). Mais l’adoption d’une ligne explicitement centrée sur les seuls intérêts américains est néanmoins une nouveauté, car les motivations affichées par eux pendant cette période avaient toujours une forte dimension idéologique (sincère ou pas), et en tout cas affichaient le respect de certaines règles. Ici on raisonnerait sur un critère d’enjeu purement stratégique, qui justifierait d’agir sans plus de considération.
Sur la planète, cela pourrait inquiéter un peu plus pas mal de monde. Mais cela constituerait évidemment et surtout un pas majeur dans le glissement vers un nouveau style de rapports. On l’a dit, il ne s’agit pas là de principes absolus et sacrosaints ; mais ils ont une certaine vertu pour calmer le jeu à l’occasion. Dans un tel monde, il n’y aurait plus de motif pour condamner l’invasion du Koweït par Saddam : si une coalition se formait dans un tel cas afin de résister au coup de force, ce serait par un pur calcul d’intérêts ou de rapports de forces. Et donc, même si on doit reconnaître les limites des règles, leur effacement complet représenterait un changement a priori peu souhaitable.
Ajoutons qu’à terme une telle évolution serait particulièrement favorable à la résurrection du concept d’empire, appelé à un vrai avenir comme je l’ai évoqué par ailleurs.