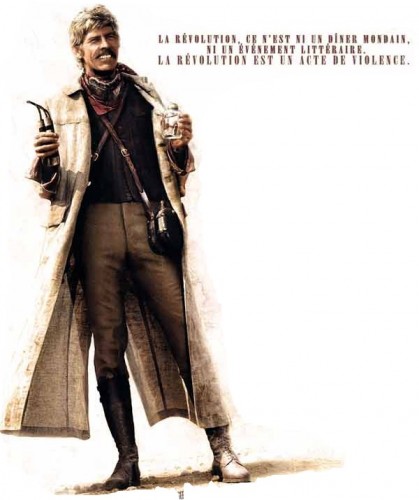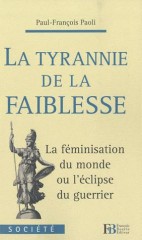Nous reproduisons ci-dessous un texte de Pierre Le Vigan consacré à la dictature de l'urgence dans nos sociétés...

Tout s’accélère : la maladie de l’urgence
Tout s’accélère. Nous mangeons de plus en vite. Nous changeons de modes vestimentaires de plus en plus vite. L’obsolescence de nos objets quotidiens (téléphone mobile, Ipad, ordinateur, etc) est de plus en plus rapide. Nous envoyons de plus en plus de mails, ou de SMS. Nous lisons de plus en plus d’informations en même temps (ce qui ne veut pas dire que nous les comprenons). Nous parlons de plus en plus vite : + 8% de mots à la minute entre l’an 2000 et 2010. Nous travaillons peut-être un peu moins mais de plus en plus vite – conséquence logique de la RTT. Les détenteurs d’actions en changent de plus en plus souvent : la durée moyenne de possession d’une action sur le marché de New York est passée de 8 ans en 1960 à moins d’un an en 2010. Nous imaginons et produisons des voitures de plus en plus vite. Nous zappons d’un film à l’autre de plus en plus vite : les films ne durent même pas une saison, parfois moins d’un mois. Ils passent sur support DVD de plus en plus rapidement après leur sortie en salle, parfois presque en même temps. Les films anciens (qui n’ont parfois que 3 ans) que l’on peut encore voir en salles diminuent à grande vitesse : l’oubli définitif va de plus en plus vite. C’est ce que Gilles Finchelstein a bien analysé sous le nom de La dictature de l’urgence (Fayard, 2011). L’urgence va avec la profusion, la juxtaposition des divers plans du vécu et la dissipation. Dans le même temps que la durée de vie des films est de plus en brève, pour laisser la place à d’autres, le nombre de plans par films s’accélère – et est quasiment proportionnel à la médiocrité des films. Conséquence : les plans longs sont de moins en moins nombreux. Et… de plus en plus court ! 3 secondes cela commence à être beaucoup trop long. Il se passe de plus en plus de choses à la fois dans les feuilletons : comparons Plus Belle La Vie (PBLV pour faire vite) à « Le 16 à Kerbriant (1972) ». Paul Valéry écrivait : «L'homme s'enivre de dissipation : abus de vitesse, abus de lumière, abus de toxiques, de stupéfiants, d'excitants, abus de fréquences dans les impressions, abus de diversités, abus de résonances, abus de facilités, abus de merveilles. Toute vie actuelle est inséparable de ces abus.» (Variété, 1924).
Il y a plus de 50 ans, André Siegfried de son coté analysait « l’âge de la vitesse » dans Aspects du XXe siècle (Hachette, 1955). Il soulignait que la vitesse des bateaux avait été multipliée par 5 avec la vapeur remplaçant la voile. Que ne dirait-il quand aux progrès de la capacité de stockage et de calcul de nos ordinateurs ! Mais la vitesse peut être un vice : le « seul vice nouveau du XXe siècle » avait dit Paul Morand. « L'homme résistera t-il en à l'accroissement formidable de puissance dont la science moderne l'a doté ou se détruira-t-il en le maniant? Ou bien l'homme sera-t-il assez spirituel pour savoir se servir de sa force nouvelle? » s’interrogeait encore Paul Morand (Apprendre à se reposer, 1937).
Elle nous fait bouger de plus en plus vite, ou surtout, elle nous fait croire que ce qui est bien c’est de bouger de plus et plus, et de plus en plus vite. En cherchant à aller de plus en plus vite, et à faire les choses de plus en rapidement, l’homme prend le risque de se perdre de vue lui-même. Goethe écrivait : « L’homme tel que nous le connaissons et dans la mesure où il utilise normalement le pouvoir de ses sens est l’instrument physique le plus précis qu’il y ait au monde. Le plus grand péril de la physique moderne est précisément d’avoir séparé l’homme de ses expériences en poursuivant la nature dans un domaine où celle-ci n’est plus perceptible que par nos instruments artificiels. »
Notre société malade de l'urgence
Nos enfants sont les enfants de l'urgence. Et tout simplement parce que nous-mêmes sommes fils et filles de l'urgence. Et ce sentiment d’urgence va avec la vitesse. Si c’est grave, et il n’y a pas d’urgence sans gravité, alors, il faut réagir tout de suite. De nos jours, explique la sociologue et psychologue Nicole Aubert, l'homme doit réagir aux événements "en temps réel". Au moment même. Plus encore, même quand il « ne se passe rien », il est sommé d'être "branché", connecté avec le monde, au cas où il se passerait quelque chose. Une urgence par exemple. L’homme est mis en demeure de provoquer des micro-événements sans quoi il ne se sent pas vivre. Il s’ennuie. De ce fait, ce ne sont pas seulement les machines, c'est l'homme lui-même qui vit "à flux tendu". La durée, qui suppose l'endurance, a été remplacée par la vitesse, qui répond à une supposée urgence. Mais cette vitesse n'a pas une valeur optimum, c'est l'accélération qui est requise. La bonne vitesse c’est la vitesse supérieure à celle d’hier. De même qu’un ordinateur performant ce n’est pas un ordinateur qui suffit à mes besoins c’est un ordinateur plus performant que les autres et en tout cas plus performant que ceux du trimestre dernier. Il y a dans ce culte de l’urgence et de la vitesse – ce n’est pas la même chose mais cela va ensemble - une certaine ivresse.
« L’expérience majeure de la modernité est celle de l’accélération » écrit Hartmut Rosa (Accélération. Une critique sociale du temps, la Découverte, 2010). Nous le savons et l’éprouvons chaque jour : dans la société moderne, « tout devient toujours plus rapide ». Or le temps a longtemps été négligé dans les analyses des sciences sociales sur la modernité au profit des processus de rationalisation ou d’individualisation. C’est pourtant le temps et son accélération qui, aux yeux de Hartmut Rosa, permet de comprendre la dynamique de la modernité. Pour ce faire, nous avons besoin d’une théorie de l’accélération sociale, susceptible de penser ensemble l’accélération technique (celle des transports, de la communication, etc.), tout comme l’accélération du changement social (des styles de vie, des structures familiales, des affiliations politiques et religieuses) et l’accélération du rythme de vie, qui se manifeste par une expérience de stress et de manque de temps. La modernité tardive, à partir des années 1970, connaît une formidable poussée d’accélération dans ces trois dimensions. Au point qu’elle en vient à menacer le projet même de la modernité : dissolution des attentes et des identités, sentiment d’impuissance, « détemporalisation » de l’histoire et de la vie, etc. L’instantanéisme tue la notion même de projet, fut-il moderne. « En utilisant l’instantanéité induite par les nouvelles technologies, la logique du Marché, avec ses exigences, a donc imposé sa temporalité propre, conduisant à l’avènement d’une urgence généralisée. » note Nicole Aubert (Le culte de l’urgence, Flammarion, 2004 ; L’individu hypermoderne, Eres, 2004).
Hartmut Rosa montre que la désynchronisation des évolutions socioéconomiques et la dissolution de l’action politique font peser une grave menace sur la possibilité même du progrès social. Déjà Marx et Engels affirmaient ainsi que le capitalisme contient intrinsèquement une tendance à « dissiper tout ce qui est stable et stagne ». Dans Accélération, Hartmut Rosa prend toute la mesure de cette analyse pour construire une véritable « critique sociale du temps » susceptible de penser ensemble les transformations du temps, les changements sociaux et le devenir de l’individu et de son rapport au monde. »
L’ivresse de la vitesse fait même que la figure tutélaire de notre société est la personnalité borderline, une personnalité qui recherche toujours l'extrême intensité dans chaque instant. Mais la contrepartie de cette recherche est la fragilité : la désillusion, le dégrisement douloureux, l’atonie, la désinscription dans une durée qui ne fait plus sens parce qu'elle n'a jamais été la durée d'un projet et que l'intensité ne peut suppléer à tout. C'est pourquoi on peut analyser certaines maladies de l'âme comme des réponses plus ou moins conscientes à une pression du temps social vécue comme excessive (Nicole Aubert, Le culte de l'urgence. La société malade du temps, Flammarion, 2003).
La dépression, une stratégie de ralentissement du temps ?
Ainsi la dépression est-elle en un sens une stratégie de ralentissement du temps. L'homme dépressif succède à l'homme pressé - celui-ci dans tous les sens du terme, pressé de faire les choses et pressé comme un citron. Le dépressif se donne du temps - et c'est sans doute cela aussi que Pierre Fédida désignait, paradoxalement, comme "les bienfaits de la dépression". Bien évidemment cette solution n'est pas satisfaisante si elle perdure, car le dépressif mélancolique souffre d'un temps sans histoire personnelle possible, par sentiment de perte irrémédiable et de destruction de son estime de soi. La cassure de l'"élan personnel" du mélancolique lui interdit de produire sa temporalité propre. La dépression ou la griserie passagère, toujours à réactiver, du psychopathe borderline, tels sont ainsi les deux effets du culte de l'urgence.
L'ensemble de notre société et de ses dirigeants est pris dans cette obsession d’une temporalité « en temps réel », c'est-à-dire d'un temps de l'action sans délai de transmission. Action sans médiation. C’est une fausse temporalité. C'est un instantanéisme ou encore un présentisme. Les plans d'urgence fleurissent, élaborées eux-mêmes dans l'urgence. Les lois d’urgence aussi : sur les Roms, sur les étrangers délinquants, sur le logement, sur des sujets aussi techniques que la suppression du tiers payant quand on refuse un médicament générique (Rousseau, reviens, ils ont oublié la grandeur de la Loi), etc. De là un "mouvementisme" (Pierre-André Taguieff), puisqu'il s'agit de toujours "coller" à un présent par définition changeant. Aussi, au culte de l'urgence doit succéder un réinvestissement du temps dans son épaisseur. Il est temps de réencastrer l'instant dans le temps du projet et de la maturation. "Il est temps qu'il soit temps" dit Paul Celan (Corona). Par principe, le temps est « ce qui nous manque ». C’est la condition humaine. « L’art a besoin de ce temps que je n’ai pas » dit Paul Valéry.
Résister à l’urgence
L’urgence ? Réagir dans l’urgence, c’est souvent la catastrophe. « Au nom de l’urgence », c’est le titre d’un film d’Alain Dufau (1993) sur la construction, très vite et trop vite, des grands ensembles HLM dans les années 50 à 70 (cf. <Voir et agir> et <Politis> : Au nom de l’urgence). Au nom de l’urgence, ce pourrait aussi être le nom d’un reportage sur la folie de l’immigration décidée par le grand patronat et les gouvernements qui lui étaient et lui sont inféodés à partir de 1975. (Hervé Juvin, Immigration de peuplement, realpolitik.tv). Immigration décidée pour fournir, très vite, de la main d’œuvre pas cher au patronat des trusts et pour tirer tous les salaires, y compris bien sûr ceux des Français, vers le bas. Au nom de l’urgence, c’est la réaction de Sarkozy et de presque toute la classe politico-médiatique face à la répression rugbyllistique des agitations et rebellions (armées) en Libye par Mouammar Kadhafi. Réaction inconsidérée et épidermique. En urgence et à grande vitesse c’est même ainsi que l’on décide de la construction ou non de lignes de train à grande vitesse, dites TGV.
Un nouveau dictionnaire des idées reçues de Flaubert dirait donc peut-être : « Urgence. Répondre à. » Répondre en urgence à la question du mal-logement par exemple. Avec… des logements d’urgence. Erreur. La bonne réponse est : « Résister à. » Il faut (il faudrait !) résister à l’urgence. Mais ce n’est pas si simple. La preuve : en tapant sur un célèbre moteur de recherche « résister » et « urgence », vous n’obtenez guère de réponses sur le thème « il faut résister à l’urgence, au diktat de l’urgence, et voici comment » mais beaucoup de réponses du type « Il est urgent de résister » ! Ce qui n’est pas du tout la même chose et est même le contraire. 0r s’il est parfois nécessaire de résister (à bien des choses d’ailleurs) il est plus nécessaire encore de comprendre à quoi l’on devrait résister, pourquoi on en est arrivé là, et comment résister de manière efficace – ce qui nécessite en général de prendre un peu de temps. Le contraire de réagir dans l’urgence.
Les techniques proliférantes nous imposent l’immédiateté. Difficile de répondre à Nicolas Gauthier que son courrier nous demandant pour jeudi au plus tard un papier sur l’urgence est arrivé trop tard, pour cause d’un accident de cheval au relais de poste. Dans le même temps, nous vivons de plus en plus vieux mais sommes de plus en plus angoissés par l’avenir, par le temps, et surtout par… la peur du manque de temps. Jacques André, professeur à l’Université Paris-Diderot, a appelé cela Les désordres du temps (PUF, 2010). L’immédiateté en est un des aspects, la frénésie de « ne pas perdre son temps » en est un autre aspect : elle amène à aller vite, à faire plein de choses en peu de temps, voire… en même temps, à rencontrer plein de nanas parce que le temps est compté, à être tout le temps « surbooké » sans guère produire de choses définitives ni même durables. Nicole Aubert écrit : « Pour les drogués de l’urgence, atteindre le but fixé, s’arrêter, c’est l’équivalent de la mort. On le voit très bien dans les séries télévisées qui ont actuellement le plus de succès : ‘’Urgences’’, ‘’24 heures chrono’’… Elles mettent en évidence que si l’on cesse de foncer ne serait-ce qu’une seconde, quelqu’un va mourir. » Exemple : que restera t-il de Sarkozy ? Le symbole d’un homme pressé, inefficace, et un peu dérisoire. Trois fois moins que Spinoza ou Alain de Benoist, qui n’ont pas fait de politique mais qui ont pris le temps d’une oeuvre et d’une pensée.
Chercher la performance donc la vitesse est gage d’efficacité dans notre monde. Ce n’est pas strictement moderne. Napoléon, le dernier des Anciens, était comme cela. Mais le monde moderne tend à ériger cela – qui était l’exception - en modèle. Le rapport faussé au temps est une des formes du malaise de l’homme moderne. « Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'incuber les événements et de les élever au statut d'événements psychiques » note le psychanalyste Richard Gori. Nous nous laissons ballotés par le présent sans nous donner le temps de le digérer. Nous ne maitrisons plus rien car toute notre énergie est dans la réaction à ce qui nous arrive. Le psychanalyste Winnicott note : « Pour pouvoir être et avoir le sentiment que l'on est, il faut que le faire-par-impulsion l'emporte sur le faire-par-réaction. » Il faudrait pour cela échapper à la pression, c'est-à-dire à l’urgence. Laurent Schmitt, professeur de psychiatrie, s’interroge, dans Du temps pour soi (Odile Jacob, 2010) sur notre faculté à suroccuper notre temps, fusse par des futilités. « Cette facilité à combler le moindre temps mort conduit tout droit à l’ennui et au mal-être. Voici un nouvel enjeu essentiel à notre qualité de vie. Le combat ne se limite plus à gagner du temps libre mais à reconnaître ’’notre’’ temps, derrière les multiples occupations, celui en accord avec notre intimité et nos vraies aspirations. » En fait, ce que l’économiste américain Joseph Stiglitz appelle Le triomphe de la cupidité concerne aussi notre rapport au temps. Peter Soterdijk remarque : «Notre nouveau rapport au temps peut s’appréhender comme « existentialisme de la synchronisation » et implique « l’égalité de tous devant le présent homogène de la terre. »
Ne pas vouloir « perdre son temps », ne pas discuter avec un inconnu, ne pas consacrer du temps à un gamin revêche, etc, à un certain degré, cela relève de l’égoïsme. De la volonté forcenée de ne pas « gaspiller son temps ». Se libérer de l’urgence c’est aussi se libérer de cela.
Le culte de l’urgence est lié à celui de la transparence. Il s‘agit de réagir vite à une situation que l’on suppose claire, transparente, sans équivoque. Les deux maux se tiennent. Ils concourent tous deux à ce que Pierre Rosanvallon appelle « la myopie démocratique ». La logique du monde moderne c’est de saturer à la fois l’espace et le temps. « Le progrès et la catastrophe sont l‘avers et le revers d’une même médaille. C’est un phénomène qui est masqué par la propagande du progrès. » note Paul Virilio. La propagande du progrès est en d’autres termes le court-termisme, l’absence d’horizon. Face à cela, la fonction présidentielle, à laquelle nous pouvons penser hors de l’urgence – il reste plus de 12 mois- devrait répondre aux besoins de long terme, de permanence des choix et des identités, à la sécurité de notre être personnel et collectif, on appelle cela la nation, ou plus simplement encore : le peuple, notre peuple. L’exercice de cette fonction devrait répondre aux besoins de durabilité de la France, notre pays, et de l’Europe, notre destin. Le moment viendra où il faudra s’en souvenir.
Pierre Le Vigan
Version enrichie du texte paru dans le numéro 62 du magazine Flash (24 mars 2011)