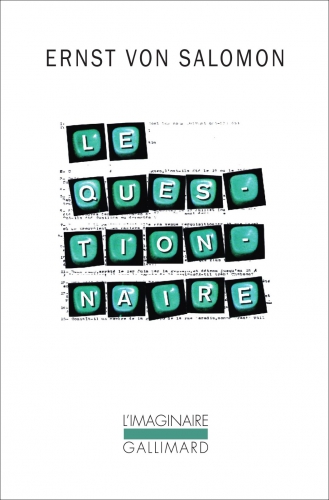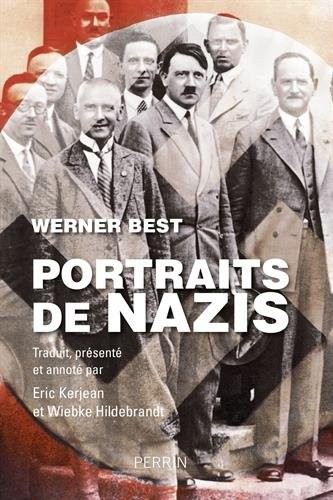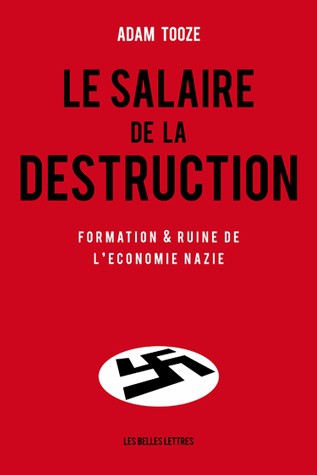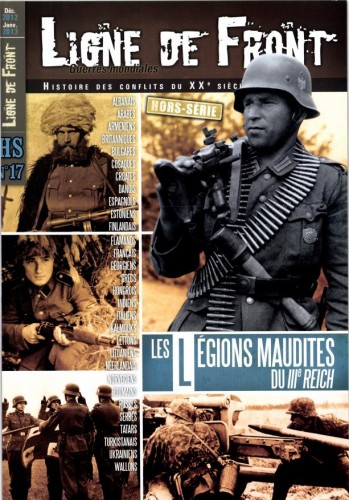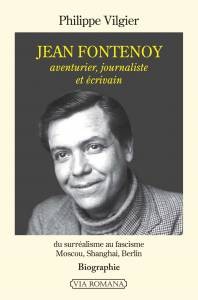Les éditions Pardès viennent de rééditer Essais politiques, un recueil d'articles de Julius Evola consacrés à l'idée d'empire, au corporatisme, au protectionnisme ou au national-socialisme allemand. Penseur essentiel du traditionalisme révolutionnaire, écrivain au style limpide et puissant, Julius Evola est notamment l'auteur de Révolte contre le monde moderne (1934) et de Chevaucher le tigre (1961).
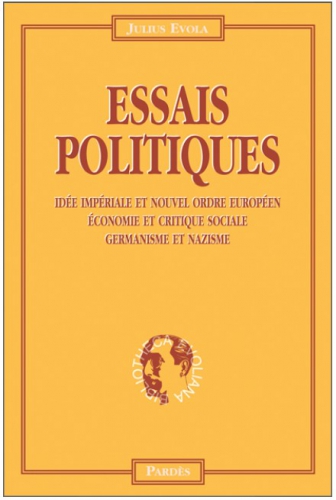
" Cet ouvrage rassemble vingt-huit articles de Julius Evola parus entre l’année 1930 et l’année 1958. Les textes sont classés en trois sections thématiques : «Idée impériale et Nouvel Ordre européen», «Économie et critique sociale », « Germanisme et nazisme ». Consacrés à une critique du nationalisme moderne, à la redéfinition de l’idée d’Empire, à la question d’un véritable « droit européen », ou encore à l’analyse des conditions spirituelles et structurelles de l’unité de l’Europe, les premiers articles de ce recueil relèvent des grandes orientations métapolitiques. Le lecteur trouvera dans la deuxième partie un article très précieux sur un sujet méconnu – la conception nationale-socialiste de la corporation – et des textes reflétant les débats des intellectuels fascistes sur un point important : le «procès de la bourgeoisie ». Dans la troisième partie, enfin, Evola se livre à des analyses, parfois très critiques, de plusieurs aspects du national-socialisme : son nationalisme völkisch et particulariste, son racisme biologique, ses dérives « révolutionnaires » et « antiromaines », son paganisme et les liens de celui-ci avec la Réforme et les Lumières, sa conception de l’État, etc.
S’il permet de mieux saisir en perspective l’itinéraire d’Evola et la nature de son engagement métapolitique durant l’entre-deux-guerres, ce recueil est avant tout un irremplaçable instrument d’information sur les idées dont on débattait sous le fascisme et le national-socialisme. Les polémiques incessantes autour de ce dernier phénomène témoignent surtout de l’ignorance affligeante de l’historiographie officielle française sur les sources et les références
idéologiques du national-socialisme : d’où l’extrême intérêt des articles d’Evola, souvent écrits sur la base d’une documentation de première main.
Les textes sont précédés d’une longue présentation de François Maistre et suivis d’une notice bio-bibliographique, due à Renato Del Ponte, sur un dirigeant fasciste encore très mal connu : Giovanni Preziosi. "