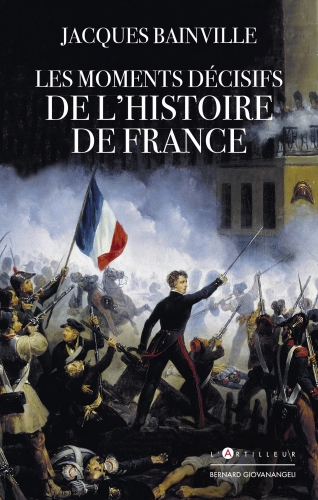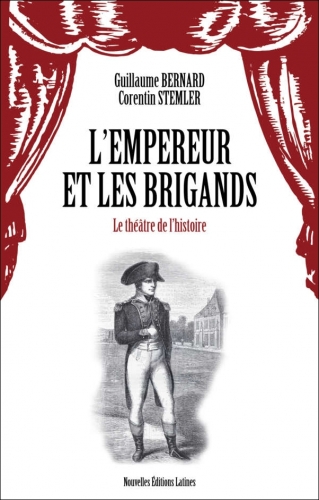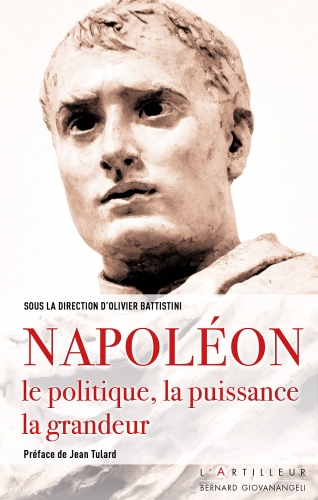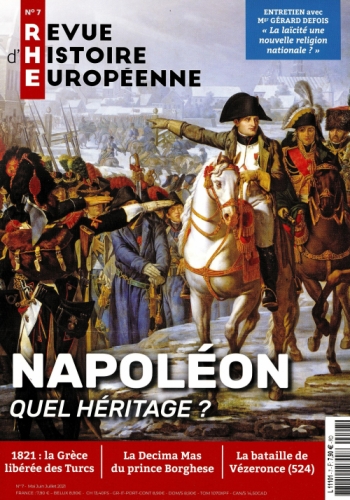Le trente-sixième numéro de la revue Livr'arbitres, dirigée par Patrick Wagner et Xavier Eman, est en vente, avec un dossier consacré au Val de Loire pour poursuivre le tour de France littéraire entamé dans les numéros précédents...
La revue peut être commandée sur son site : Livr'arbitre, la revue du pays réel.
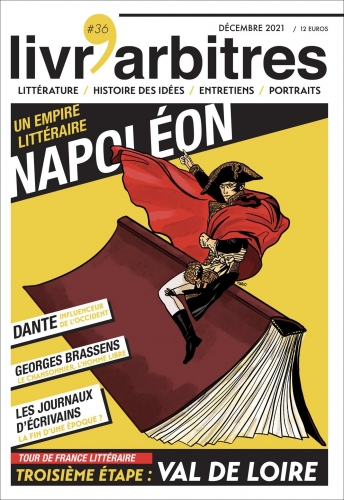
Au sommaire de ce numéro :
Éditorial
Plaisirs solittéraires
Coups de cœur
Editions Æthalidès
Lionel Lecœur
Sélection du prix des Hussards
Venise
Portrait
Barbellion
Prosper Mérimée
Dossier
Val de Loire
Diaristes
René Fallet
Christian Millau
Claude-Michel Cluny
Christian Dedet
Gabriel Matzneff
Roland Jaccard
Raymond Espinose
Entretien
Christian Authier
Jean-Paul Charygues de Olmetta
Aristide Leucate
Domaine étranger
William Makepeace Thackeray
Réédition
Jacques Chardonne
Histoire panorama
Jean de La fontaine
Dominique Venner
Saïgon
In Memoriam
Dante
Napoléon
Dostoïevski
Brassens
Nouvelle
Polar
Dominique Guiou et Thomas Morales
Nadine Monfils
Frédéric Rouvillois
Jean Ollé-Laprune
Littérature jeunesse
Bande dessinée
Terpant-Giono
Orwell-L'Herminier
Jean-François vivier, Régis Parenteau-Denoël
Drôle d'époque
Carrefour de la poésie
Carte postale
Vagabondage