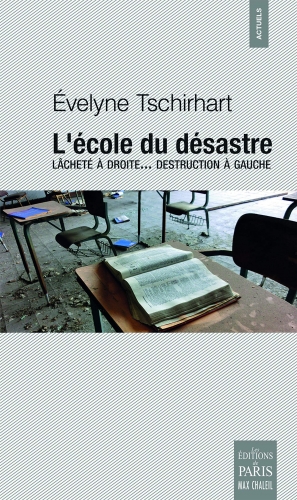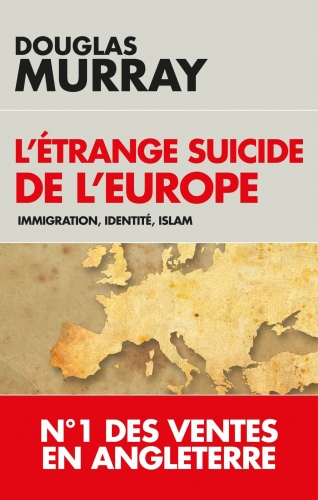Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alexis Carré, cueilli sur Figaro Vox et consacré à l'effondrement des sciences sociales à l'université sous les coups du multiculturalisme et de l'idéologie victimaire. L'auteur est doctorant en philosophie politique à l’École normale supérieure.

Une «culture du viol» chez les chiens ? La gauche identitaire au piège de ses propres obsessions
Des voix de plus en plus nombreuses à gauche voudraient faire de la défense des minorités opprimées le nouvel horizon indépassable de notre temps. Dans le cadre d'un tel projet d'hégémonie culturelle, il n'est pas compliqué de voir en quoi la gauche identitaire a besoin de l'université pour survivre et se développer. À une époque où l'accès aux classes supérieures est de plus en plus étroitement conditionné par l'obtention d'un diplôme universitaire, l'influence de cette institution sur les esprits qui nous gouvernent n'a certainement jamais été aussi grande. Et, si cela ne suffisait pas, la durée des études supérieures augmente elle aussi, et avec elle notre exposition aux discours et aux modes qui prévalent dans ce milieu. Or, nous n'avons presque que des raisons de nous en inquiéter. L'idée édifiante selon laquelle l'université serait un lieu, et même le lieu par excellence, d'apprentissage de l'esprit critique souffre en effet de bien des démentis à l'ère de l'éducation de masse et des classements internationaux. Et c'est la rigueur même des savoirs qu'elle transmet qui est aujourd'hui remise en cause par des expériences telles que celle effectuée par Helen Pluckrose, James Lindsay et Peter Poghossian.
Une mise en cause de la rigueur universitaire des études victimaires
Lindsay et Boghossian s'étaient déjà rendus célèbres il y a un an en faisant publier un premier canular: Le pénis conceptuel comme une construction sociale dans la revue Cogent Social Science. Un certain nombre de critiques avaient alors considéré que la portée de la démonstration demeurait limitée du fait que la revue n'était pas de premier ordre et qu'il était difficile de diagnostiquer l'état de tout un champ de recherche sur la base d'une seule bévue éditoriale. C'est donc avec l'aide d'Helen Pluckrose qu'ils ont cette fois-ci soumis 20 articles à l'approbation d'une pluralité de revues reconnues. Comme on le sait, 7 de ces articles furent acceptés, et 7 autres avaient une possibilité de l'être également au moment où les trois universitaires ont été obligés d'interrompre leur expérience du fait de l'emballement médiatique engendré par l'une de leurs publications.
Au-delà du caractère spectaculaire de l'entreprise, leur démarche invite à s'interroger sur les causes de cet engouement pour ce qu'ils appellent les «grievance studies», et qu'on pourrait traduire par «études plaintives» ou «victimaires», c'est-à-dire centrées sur les individus ou les groupes qui se disent victimes d'un tort dont le système organisant la société serait responsable. Cette désignation qui leur est propre regroupe en réalité une variété de disciplines et de niches allant de la théorie critique raciale aux études de blanchité en passant par les théories queer, féministe ou postcoloniale. Malgré leur prestige grandissant, la légitimité de ces nouveaux champs de recherche est souvent débattue du fait de leur politisation et des pressions qu'ils font peser sur les procédures qui gouvernent la production des savoirs. La question est de déterminer si ces manquements à la déontologie universitaire sont dus aux défauts individuels des chercheurs qui se consacrent à ces études ou bien si le cadre conceptuel qu'ils utilisent ne porte pas une part de responsabilité dans leurs erreurs.
Des racines européennes
Inspirée par la théorie française post-marxiste (Foucault, Deleuze, Derrida etc.) et par l'école de Francfort, cette pensée victimaire s'est élaborée à partir d'une réappropriation intellectuelle et militante de la déconstruction et de la théorie critique au service des minorités opprimées. Si elle comporte parmi ses défenseurs des universitaires établis comme Judith Butler, Kimberlé Crenshaw ou Kwame Appiah, elle repose également sur un vivier particulièrement actif de militants associatifs, de journalistes et d'adeptes des réseaux sociaux (pour ne citer que quelques noms: Ta-Nehisi Coates, Linda Sarsour, Tamika Mallory, Anita Sarkeesian etc.) chargés de mobiliser les communautés concernées autour d'un certain nombre de revendications.
Le mode d'action de ces activistes, malgré la multiplicité des chapelles que nous avons évoquées, comporte toujours ces deux dimensions: la lutte pour la reconnaissance et la critique de la domination. Or ces deux concepts, qui au premier abord semblent être tout à fait respectables, s'articulent ensemble dans une relation qui rend impossible la recherche de la vérité. Ce n'est donc pas par paresse intellectuelle, ou quelque autre cause remédiable, que ces revues prestigieuses ont pu se laisser ainsi berner par ces trois chercheurs, mais parce que l'idéologie qui les anime les y prédispose.
La remise en cause des ressorts mêmes de la discussion publique
L'idée de critique de la domination ne consiste pas à opposer au discours de légitimité du pouvoir un autre discours de légitimité mais à attaquer les catégories sur lesquelles tout pouvoir est censé se fonder. En s'attaquant par exemple à la distinction entre folie et salubrité, culpabilité et innocence, ignorance et connaissance, l'héritier de Foucault prétend remplir une fonction à la fois épistémologique et sociale. Dans un entretien récent, Geoffroy de Lagasnerie déclarait: «Dire la vérité de ces institutions et les mettre en question sont une seule et même chose.» L'intention sous-jacente à cette critique est en effet d'atteindre, derrière la fausseté des concepts sur lesquels elle repose, l'autorité du psychiatre, du juge ou du professeur sur le malade, le prévenu ou l'élève, afin que celui-ci puisse leur résister. Ce faisant, on part du principe que tout pouvoir s'exerce nécessairement aux dépens de celui qui le subit, réduisant l'activité de soigner, de juger ou d'enseigner à leur dimension disciplinaire. Cette discipline formant un système de contrôle social suppose évidemment un bénéficiaire dans la personne du dominant et du groupe privilégié auquel il appartient.
Alors que la gauche socialiste et la droite libérale se disputaient le même objet — il fallait organiser le travail pour l'une, le libérer pour la seconde —, la gauche identitaire s'attaque aux concepts mêmes qui nous servent à saisir la réalité. L'objectif n'est plus de corriger une compréhension de la justice qui serait erronée chez ses interlocuteurs mais de recourir à des récits communautaires qui dispensent du besoin et nient même l'existence d'une conception commune de la justice. Ce même Geoffroy de Lagasnerie ajoute ainsi dans l'entretien déjà cité: «Si vous construisez un mouvement politique en invoquant le concept de “citoyen”, vous attirez toujours ceux qui se pensent comme universels — la classe moyenne blanche.»
À qui doit-on s'adresser dans ce cas? Ce type d'argument révèle la faible valeur, et pire, la faible ambition argumentative ou rhétorique de ces théories. Leur rôle n'est pas de convaincre d'autres individus mais de définir les signes par l'adoption desquels ses membres exprimeront leur appartenance au groupe. Cette manière de comprendre le monde ne va être d'aucune utilité dans l'économie des rapports entre les individus qui en sont membres et ceux qui ne le sont pas. Ces derniers vont se voir soumis à des injonctions dont le but est de supprimer toute possibilité de discussion.
Le caractère subversif de la reconnaissance
La lutte pour la reconnaissance change en effet profondément les paramètres du discours, que celui-ci soit académique ou politique. Puisque les revendications des dominés ne sont plus médiatisées par une compréhension de la justice commune, c'est de leur souffrance elle-même qu'ils tirent la légitimité de leurs revendications. En l'absence d'action délibérée et revendiquée de la société en vue d'infliger de telles souffrances, ils ne peuvent comprendre la souffrance qu'ils ressentent sans un récit démystificateur qui prétend dévoiler les mécanismes de pouvoir invisibles à l'œil inexercé. Cette souffrance qui trouve son sens dans la mise en récit identitaire est indissociablement produite et exprimée par cette dernière. Se voir et se sentir victime du racisme d'État n'est pas une condition spontanée comme celle de se voir et se sentir victime d'une répression par une dictature militaire. Une telle compréhension de soi nécessite d'adhérer à une explication bien particulière de la structure de la société dont on est membre.
L'identité que fonde cette explication justifie la demande d'une reconnaissance de la souffrance subie. La règle commune n'est pas injuste parce que j'en démontre l'injustice ; l'injustice est démontrée par le fait que j'en souffre et qu'elle est donc conçue pour le bénéfice de ceux qui n'en souffrent pas.
Un jeu à somme nulle
Cette compréhension du monde finit par dicter une politique centrée sur des rapports de force et des jeux à somme nulle. Son objectif est moins de faire comprendre que de faire céder. Des arguments opposés peuvent engendrer un concept qui surmonte leur contradiction ou un compromis qui organise leur opposition pacifique. Alors que chacun se reconnaît dans ces solutions théoriques ou pratiques au problème, la demande de reconnaissance n'admet qu'une capitulation complète. Celui qui me reconnaît comme victime, admet par là même que son argument reposant sur une règle commune à lui et moi dissimulait en réalité sa volonté de perpétuer une situation d'oppression.
S'il est peu adapté à une conversation académique authentique, un tel discours unilatéral exploite des faiblesses morales et intellectuelles bien réelles. Lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un, la recherche d'un principe sur lequel s'accorder à nouveau est incertaine et laborieuse, chacun a par ailleurs de bonnes raisons de douter de sa propre position. Alors qu'un argument est toujours discutable et dépend de l'intelligence de celui qui le défend, la grande efficacité de la posture victimaire sur beaucoup de gens de bonne volonté tient au contraire à ce qu'une souffrance authentiquement ressentie est un état de fait, même si le récit qui l'a produite s'avère erroné. Faire la démonstration de cette erreur requiert des capacités que certains n'ont pas et que d'autres n'ont pas envie de mettre en œuvre, tâche un peu vaine quand l'interlocuteur organise de toute façon l'impossibilité de la discussion.
L'agressivité de telles demandes explique certainement le peu de succès politique de cette stratégie qui ne s'épanouit que là où elle peut s'exprimer sans contradicteurs. C'est pourquoi l'influence galopante qu'elle acquiert partout où les institutions lui permettent d'exercer un pouvoir vertical sur l'opinion publique devrait être un réel motif d'inquiétude.
Une stratégie d'infiltration institutionnelle mise en échec
Aux États-Unis, Mark Lilla, Yascha Mounk, William Galston et dernièrement Francis Fukuyama ont déploré les effets néfastes de ces mouvements sur les capacités électorales des partis de gauche. Mais il n'est pas certain que les victoires électorales soient un objectif immédiat de la gauche identitaire tant le pouvoir dévolu aux élus est de toute façon bien souvent délégué à des administrateurs et des experts qui prendront à leur place les décisions affectant la vie de leurs électeurs.
Les commissions d'admission dans les universités prestigieuses, les comités d'éthique, les conseils d'administration des grandes associations caritatives, les directions des grands médias sont des lieux où le pouvoir de ces nouveaux militants peut s'exercer à l'abri et à l'encontre de la majorité, là où leur poste dépend, non pas d'électeurs qu'il faut convaincre, mais de pairs qui le sont déjà. Toutefois cette forme d'entrisme n'est pas sans conséquence pour ceux qui le subissent. Il est par exemple impossible de nier le rôle au moins partiel qu'a joué ce phénomène dans le divorce entre ces lieux de représentation et la société, qui ne se reconnaît plus en eux.
Obnubilée par les rapports de domination, la gauche identitaire souhaitait utiliser ces derniers afin de servir les groupes qu'elle se proposait de défendre. Cette instrumentalisation a nui à la crédibilité des autorités dont elle tâchait de s'emparer. Cela vaut particulièrement pour l'université, où la monoculture intellectuelle qui s'y est développée au nom de la diversité a considérablement appauvri les départements de sciences sociales et d'humanités. Elle amenuise chaque jour leur capacité à informer et leurs étudiants et le monde extérieur sur les enjeux qu'ils partagent. Comme ce canular le prouve, il devient impossible pour des chercheurs certainement dévoués à leur domaine d'étude, de faire la différence entre un charabia aléatoirement rassemblé et un authentique travail d'analyse. La déconstruction a vécu. Trop occupée à démontrer le caractère artificiel des normes de production du savoir, elle s'est mise hors d'état de produire une connaissance que des chercheurs étrangers à ses formes d'activisme politique pourraient vouloir préserver.
Alexis Carré (Figaro Vox, 8 octobre 2018)