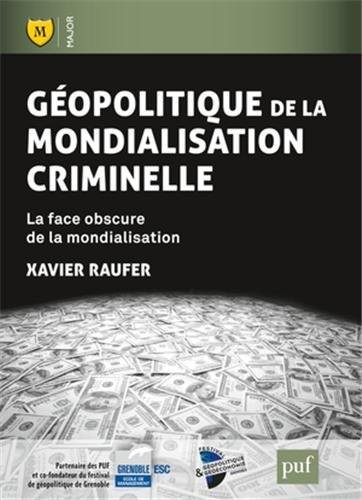L'avenir de la violence
L’Europe a toujours occupé une position phare dans votre pensée. Comment la définiriez-vous ?
Comme un continent, une origine, un creuset de culture et de civilisation, une série de paysages qui m’appartiennent et auxquels j’appartiens. Une histoire complexe qui, à partir de racines remontant pour le moins au paléolithique, n’a cessé d’évoluer et de s’enrichir d’éléments nouveaux. Un continent dont les géopoliticiens font le centre du monde. Et aussi le lieu de naissance de la philosophie, ce qui compte beaucoup pour moi.
Aujourd’hui, n’est-elle pas le joug sous lequel ploient les peuples ?
Vous confondez l’Europe et l’Union européenne. Telle qu’elle a été mise en œuvre par ses initiateurs et poursuivie par leurs successeurs, la construction européenne s’est faite dès le début en dépit du bon sens. Elle est partie de l’économie et du commerce, au lieu de se faire à partir de la politique et de la culture. Elle s’est opérée par le haut, sous la férule d’une instance technocratique acquise au centralisme jacobin et au principe d’omnicompétence, la Commission de Bruxelles, au lieu de se mettre en place par le bas, en respectant le principe de subsidiarité ou de compétence suffisante à tous les niveaux, du plus local au plus général. Elle s’est faite en dehors des peuples, sans que ceux-ci soient jamais sérieusement consultés sur sa raison d’être ou sur son mode de fonctionnement. Après la chute du système soviétique, au lieu de chercher à approfondir ses structures de décision politique, elle a choisi un élargissement hâtif à des pays qui ne cherchaient qu’à bénéficier de la protection américaine, ce qui a aggravé son impuissance et paralysé ses institutions. Le problème de ses finalités -Europe-puissance ou Europe-marché- et le problème de ses frontières -géopolitiques- n’ont jamais été clairement posés non plus. La mise en place de l’euro dans des conditions totalement irréalistes a de son côté aggravé l’endettement public, dans le contexte de crise financière mondiale que nous connaissons aujourd’hui. Le résultat est que l’« Europe », qui apparaissait naguère comme une solution, n’est plus aujourd’hui qu’un problème parmi d’autres. Loin d’être une puissance autonome, l’Europe actuelle est politiquement dépendante, financièrement victime des marchés financiers, économiquement mise en concurrence dans des conditions de dumping avec la main-d’œuvre sous-payée des pays tiers, socialement en proie à des programmes d’austérité insupportables, bref affaiblie à tous égards. Non seulement l’Union européenne n’est pas l’Europe, mais aujourd’hui elle travaille clairement contre les Européens.
L’Europe a-t-elle jamais été démocratique ? N’est-elle pas le legs des élites aristocratiques aux élites bourgeoises libérales ?
Dans l’histoire de l’Europe, la plupart des régimes ont été des régimes mixtes. Des éléments de démocratie y ont toujours été présents, même là où le pouvoir appartenait à des oligarchies. Cela dit, il faut évidemment nuancer selon les époques et les lieux : la démocratie grecque n’est pas la démocratie islandaise du Moyen Age ; la cité-Etat n’a pas fonctionné de la même manière que l’Etat-nation, qui n’a pas fonctionné lui-même à la façon de l’Empire. Quant au remplacement des élites aristocratiques par des élites bourgeoises, il commence très tôt sous l’Ancien Régime, tout particulièrement en France.
A la faveur de la crise actuelle, ne s’aperçoit-on pas que c’est toujours la même ligne de clivage, le « limes » romain, qui sépare l’Europe en deux mondes (romanisés/barbares, Réforme/Contre-Réforme, etc. ?
Il y a bien sûr un clivage Nord-Sud, qui a pris dans l’histoire diverses formes politiques ou religieuses. Mais on ne peut pas tout ramener à la confrontation du monde latin et du monde celto-germanique. La Grèce, pour ne citer qu’elle, appartient tout autant à l’Europe « orientale » orthodoxe qu’au monde méditerranéen.
Qu’est-ce que cela vous évoque, le fait que l’Europe puisse imploser par la Grèce ?
C’est évidemment un symbole. D’une certaine manière, on pourrait dire que l’Europe est née en Grèce, et que c’est également là qu’elle est en train de mourir. J’ai moi-même écrit souvent qu’on meurt de ce qui vous a fait naître. Mais encore une fois, l’Union européenne n’est pas l’Europe. La première doit disparaître, dans sa forme institutionnelle actuelle, pour permettre à la seconde d’émerger à nouveau. La crise grecque peut aussi être un point de départ, l’occasion d’un nouveau commencement.
Dans les années 1980, vous avez publié un livre intitulé « Europe, Tiers-monde, même combat ». Il était sous-titré « Décoloniser jusqu’au bout ». Pouvez-vous nous rappeler la thèse qu’il défend ?
C’est un livre qui a été publié à l’époque de la guerre froide, lorsque le Nomos de la Terre s’identifiait au duopole américano-soviétique. L’idée générale que j’y développais était que la vocation naturelle de l’Europe n’était pas de s’identifier ou de s’aligner sur l’une des deux grandes puissances, mais de rechercher une tierce voie en collaboration avec des pays qu’à cette époque on ne qualifiait pas encore, d’« émergents ». La dette du Tiers-monde, fruit de l’idéologie du « développement », elle-même fondée sur l’ethnocentrisme occidental, l’idéologie du progrès et l’application du principe de Ricardo (la théorie dite des avantages comparatifs, qui pousse un pays à se spécialiser outrageusement et à privilégier ses exportations aux dépens de ses cultures vivrières et de son marché intérieur), y faisait l’objet d’une analyse qui pourrait aussi bien être appliquée aujourd’hui à bien des pays occidentaux.
Peut-on lutter contre la mondialisation ?
La mondialisation (ou globalisation) est un fait acquis, mais on ne peut l’analyser et la comprendre qu’en tenant compte de son caractère éminemment dialectique. La mondialisation unifie en même temps qu’elle divise. Elle pousse à l’homogénéisation planétaire mais, par le fait même, provoque en retour des fragmentations nouvelles. D’autre part, la mondialisation ne veut pas dire grand-chose aussi longtemps qu’on n’en a pas déterminé le contenu actuel et les autres contenus possibles. Aujourd’hui, la mondialisation est avant tout technologique et financière. De ce point de vue, le slogan : « Mondialisez-vous ou il vous en coûtera cher ! » n’est qu’un mot d’ordre terroriste. Toute la question est de savoir si la globalisation débouchera sur un monde unipolaire, inévitablement contrôlé par la principale puissance dominante que restent encore aujourd’hui les Etats-Unis d’Amérique, ou sur un monde multipolaire, où les grands ensembles de puissance et de civilisation pourront jouer un rôle de régulation dans le processus de mondialisation en cours. C’est évidemment vers un monde multipolaire (un pluriversum, non un universum) que vont mes vœux. Cette alternative conditionne l’avènement d’un nouveau Nomos de la Terre. Elle détermine aussi un clivage d’opinion beaucoup plus important que l’obsolète clivage droite-gauche.
Qu’évoque pour vous le mot « universalisme » ? Le paganisme est-il une alternative ?
Je définis l’universalisme comme une corruption de l’universel. Vous connaissez cette belle formule de l’écrivain portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ». La singularité est un mode de médiation vers l’universel. L’universalisme consiste à statuer a priori sur la nature de toute réalité particulière, tandis que l’universel part de cette réalité pour s’épanouir et acquérir une portée plus générale. C’est en s’affirmant profondément espagnol, allemand ou anglais, que Cervantès, Goethe ou Shakespeare prennent une dimension universelle. L’universel, pour le dire autrement, ne s’atteint pas par la négation ou le dépérissement des particularités, mais par leur approfondissement. L’universalisme nie l’altérité, il ignore l’Autre en tant qu’Autre. Il considère que les hommes sont en tous temps et en tous lieux les mêmes, et que ce qui vaut pour les uns vaut nécessairement pour les autres. Cette croyance a servi de fondement à l’impérialisme occidental, et on la retrouve aussi au fondement du racisme. Le paganisme est assurément une alternative, d’un point de vue intellectuel et spirituel, puisqu’il se tient par définition à l’écart de l’Unique. Affirmer qu’il y a plusieurs dieux conduit à n’en rejeter aucun. Le « polythéisme des valeurs » (Max Weber) est un principe de tolérance, en même temps qu’une manière de respecter ce qui fait la richesse du monde, à savoir sa diversité.
Il semble que, de la démocratie représentative, il ne reste plus que la représentation. Les représentants sont parfois ouvertement méfiants envers le suffrage populaire. Comment les peuples peuvent-ils reprendre le pouvoir ?
Carl Schmitt disait que plus une démocratie est représentative, moins elle est démocratique. C’était aussi l’opinion de Rousseau : lorsque le peuple délègue à des représentants le soin de parler en son nom, il ne peut plus être présent à lui-même. Ce qui fonde la légitimité de la démocratie, à savoir la souveraineté populaire, implique la possibilité donnée à tous les citoyens de participer aux affaires publiques, c’est-à-dire de décider le plus possible par eux-mêmes de ce qui les concerne. La vraie démocratie est donc avant tout une démocratie participative. La crise actuelle de la représentation tient au fait que les citoyens constatent en permanence qu’ils ne sont même plus représentés. La Nouvelle Classe dirigeante redoute de son côté que les classes populaires ne veuillent pas aller dans la direction qu’elle leur assigne. L’idéologie dominante, enfin, place la souveraineté populaire sous conditions : une décision adoptée démocratiquement n’est plus acceptée aujourd’hui que pour autant qu’elle ne contredise pas l’idéologie des droits de l’homme. Un fossé s’est ainsi creusé entre le peuples et les élites. « Reprendre le pouvoir », cela signifie d’abord comprendre que, dans l’espace public, l’individu ne doit pas s’affirmer comme consommateur, mais comme citoyen. Cela signifie ensuite chercher à mettre en place, et d’abord localement, une démocratie de base suffisamment forte pour résister aux injonctions qui viennent d’en-haut.
On assiste à des scènes quasi insurrectionnelles en Grèce. La violence est-elle une solution pour les peuples ?
Des scènes quasi-insurrectionnelles ? On n’en est pas encore là, malheureusement peut-être. Pour l’instant, ce que l’on voit le plus en Grèce, c’est la misère, le désespoir et bon nombre de suicides. La violence est la solution lorsqu’il n’y en a plus d’autres. On dit souvent que l’Etat moderne a le monopole de la violence légitime, mais en réalité il n’a que le monopole de la violence légale. Or, légalité et légitimité ne vont pas forcément de pair, sans quoi l’on ne pourrait dire d’une loi qu’elle est injuste.
La décrédibilisation de la violence comme mode d’expression de soi n’est-elle pas l’une des causes de la perte de pouvoir du peuple ? Les dirigeants ne doivent-ils pas avoir un peu peur du peuple pour garder en tête ses intérêts ?
Toute société implique un minimum de concorde entre les citoyens. Il s’en déduit que, si violence est parfois légitime, elle ne saurait constituer un « mode d’expression de soi » permanent. Les dirigeants, d’autre part, ne doivent certes pas être préservés de la colère du peuple, mais il y a des institutions qui les obligent plus que d’autres à tenir compte de ses réactions éventuelles. Je pense par exemple au mandat impératif. En cas de conflit, en tout cas, c’est au peuple d’imposer sa loi par tous les moyens qui peuvent le lui permettre.
La violence est-elle un mal en soi ?
Je ne sais pas très bien ce qu’est un « mal en soi » rapporté aux affaires humaines. En matière politique et sociale, le bien et le mal sont rarement absolus. Beaucoup de choses dépendent des circonstances. C’est en recourant à la violence que nombre d’anciennes colonies ont recouvré leur indépendance. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance avait elle aussi recours à des moyens violents pour lutter contre l’occupant. Face à la violence d’Etat, qui peut aussi être une violence impersonnelle ou structurelle (la violence n’implique pas nécessairement la mise en œuvre de moyens violents), le recours à la violence est souvent la seule arme dont disposent ceux qui sont injustement dominés. Mais la violence n’est pas toujours légitime. Dans ses Réflexions sur la violence (1908), Georges Sorel fait l’apologie de la « violence prolétarienne », mais prend soin de la distinguer de la Terreur. La violence ne doit pas non plus être confondue avec la force. Lorsque l’on dit que la force précède le droit, on ne plaide pas pour la « raison du plus fort ». On dit seulement que le droit est impuissant sans la force nécessaire pour garantir son application.
Sommes-nous une société pacifiée, une société de lâches, ou les deux ?
La société dans laquelle nous vivons n’est pacifiée qu’en apparence. Derrière le « cercle de raison » cimenté par la pensée unique, elle est au contraire traversée de contradictions profondes qui, à la faveur d’une crise généralisée, éclateront avec d’autant plus de force qu’on aura longtemps tenté de les dissimuler. « Société de lâches » est peut-être excessif. Là encore, ce sont souvent les conjonctures, les circonstances, qui révèlent d’un côté les lâches et de l’autre les courageux. Si nous sommes aujourd’hui dans une « société de basses-eaux », comme disait Castoriadis, c’est aussi que nous sommes dans une époque de transition, un Zwischenzeit (en Français, un intermède Ndlr). Nous voyons s’effacer un monde qui nous fut familier, mais nous ne percevons pas encore pleinement les enjeux du futur. Plutôt que de lâcheté, je serais tenté de parler de déperdition d’énergie. Amnésiques et culpabilisées, les sociétés européennes actuelles sont comme vidées de leur énergie. A cette fatigue historique s’ajoutent les effets de la « distraction » au sens pascalien du terme, c’est-à-dire les effets de l’industrie du divertissement.
Un petit recueil de Kantorowicz s’intitule Mourir pour la patrie. Y a-t-il quelque chose qui justifie de se sacrifier aujourd’hui ?
Il y a toujours quelque chose qui vaut qu’on se sacrifie pour elle, mais cette chose n’est pas forcément perçue dans la claire conscience. Disons qu’il vaut toujours la peine de se sacrifier pour quelque chose qui nous dépasse. La question est de savoir si nos contemporains estiment qu’il y a quelque chose qui excède leur existence individuelle et leurs désirs immédiats ou s’ils jugent que, par définition, rien n’est pire que la mort. Un peuple qui pense que rien n’est pire que la mort est mûr pour la servitude. Le problème est que la notion même de don de soi va totalement à l’encontre d’un climat général dominé par l’utilitarisme, la raison marchande et l’axiomatique de l’intérêt. Anthropologiquement parlant, l’idéologie dominante fait de l’homme un producteur-consommateur uniquement désireux de maximiser son meilleur intérêt. Dans une telle perspective, tout ce qui n’est pas calculable est considéré comme dénué d’intérêt, toutes les valeurs sont rabattues sur la valeur d’échange, et la gratuité ne correspond plus à rien. Réaliser ce pour quoi il vaut la peine de se sacrifier implique une véritable décolonisation de l’imaginaire symbolique.
Georges Sorel, dans ses Réflexions sur la violence, décrit une élite bourgeoise peureuse, qui cède au moindre froncement de sourcil populaire. Est-ce encore vrai ? Et si oui, qu’est-ce qui fait que les peuples soient si sages, finalement ?
Je n’ai pas l’impression que Sorel décrive une bourgeoisie si craintive. Il la décrit plutôt comme prête à tout, y compris à la guerre, pour défendre ses intérêts. Il n’en est pas moins vrai que les élites redoutent le peuple, et qu’on peut s’étonner de voir ce dernier accepter si facilement de vivre dans les conditions qui sont les siennes aujourd’hui. La raison principale en est la relative abondance matérielle que nous connaissons. La vie devient de plus en plus difficile, le travail de plus en plus précaire, mais il y a toujours de l’essence à la pompe et les rayons des centres commerciaux sont pleins. Il n’en ira pas toujours ainsi. L’épuisement des ressources naturelles, la détérioration objective des conditions de la croissance, la suppression de fait des acquis sociaux obtenus en un siècle et demi de luttes sociales, aboutiront peu à peu à une prise de conscience qui mettra fin à la « sagesse » – en fait à l’apathie, à l’aliénation du « spectacle » et à la fausse conscience généralisée – dont vous parlez.
Vous avez dans votre jeunesse été très à droite, vous dites désormais n’être ni de droite ni de gauche. Comment avez-vous dépassé ce clivage ? Pourquoi luttez-vous aujourd’hui ?
Je n’emploie pas la formule « ni droite ni gauche », qui ne veut pas dire grand-chose. Je dis seulement que le clivage droite-gauche, qui a depuis deux siècles renvoyé aux oppositions les plus différentes, n’a plus guère de sens aujourd’hui. Il devient obsolète. Les notions de droite et de gauche, nées avec la modernité, s’effacent avec elle. Elles ne survivent, péniblement, que dans la sphère étroite du jeu parlementaire, mais tous les sondages montrent qu’elles perdent chaque jour un peu plus de leur clarté. Les grands événements de ces dernières décennies ont fait apparaître de nouveaux clivages qui, chez moi, ont stimulé un désir de synthèse. Dans mon livre de mémoires, Mémoire vive, j’explique dans le détail comment je suis parvenu à ce constat que les notions de droite et de gauche ont cessé d’être opérationnelles pour analyser sérieusement le moment historique que nous vivons. Je dis aussi que je me considère plutôt comme un « homme de droite de gauche » ou un « homme de gauche de droite ». Au lecteur de décider par lui-même ce qu’il peut ou doit en tirer !
Alain de Benoist (Ragemag, 13 juillet 2012)