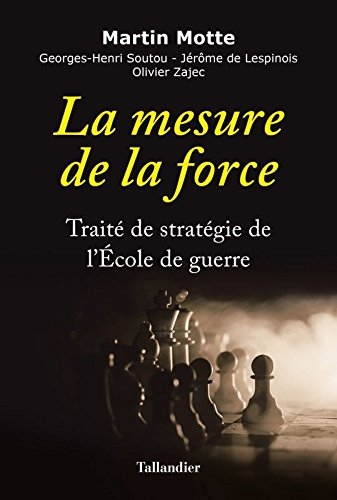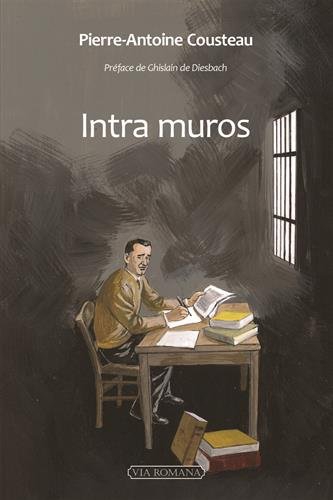Les quatre scandales de Machiavel
La puissance et la vérité de la pensée de Machiavel (1469-1527) sont intimement liées au caractère scandaleux de son maître-ouvrage Le Prince. De fait, peu de noms sont aussi maudits que le sien. La malédiction commença tôt. Dès les années 1540-1550 les camps catholiques et protestants s’entre-attribuent polémiquement la paternité de ce livre, accusé d’athéisme. On se lance le nom de Machiavel à la figure, en guise d’injure: l’adversaire serait machiavélique, ses idées seraient celles du secrétaire florentin. Son nom fixe les haines : le machiavélisme est, au choix, l’anglicanisme, le calvinisme, l’athéisme, le jésuitisme, le gallicanisme, l’averroïsme; il est toujours l’Autre dans ce qu’on imagine de pire. De son côté, l’intolérance de la Contre-Réforme se convainc que Le Prince a été écrit de la main même de Satan, conduisant le concile de Trente à le mettre à l’index ; il en suivra des autodafés un peu partout en Europe jusqu’au milieu du XVIIème siècle. En 1615, à Ingolstadt, on élève un bûcher pour y brûler en place publique l’effigie de Machiavel. Des nuées de théologiens, catholiques et réformés, parcourent le vieux continent clamant urbi et orbi que Machiavel est une incarnation du Diable, qu’il s’est échappé de l’enfer pour perdre l’humanité, errant à cette sinistre fin de pays en pays. On torture son nom en quête de l’aveu de son origine diabolique: Match-evill, Matchivell, “ Match-evill, that evill none can match ” répète-t-on. En France l’antimachiavélisme se développe sous les couleurs de l’italianophobie, de l’aversion suscitée par la princesse Catherine de Médicis et son entourage. En Italie, Machiavel est haï pour d’autres raisons : il accusé de justifier un pouvoir se constituant aux dépens de la richesse, de la morale et de la religion. Multiforme, la haine antimachiavélienne poursuit sa course de nos jours.
Imaginons qu’un mage de foire nous offre l’occasion de remonter le temps – l’inverse des Visiteurs – jusqu’au XVIème siècle. Que verrions-nous ? Une époque agitée et terrible ! Un temps tourmenté, violent, créatif ! Fils de petite noblesse, Nicolas Machiavel commence à exercer des responsabilités après l’épisode Savonarole, qui, postérieurement à son excommunication par le pape Alexandre VI, fut condamné à la pendaison suivi du bûcher en 1498. L’aventure politique de Jérôme Savonarole, moine exalté et fanatique dont le gouvernement théocratique culmina dans l’organisation d’un “ bûcher des vanités ” destiné à consumer dans les flammes toutes les richesses “ superflues ”, y compris les instruments de musique, les œuvres d’art et les poèmes de Pétrarque, de Florence en 1497, marqua puissamment Machiavel qui en tira la leçon selon laquelle “ tous les prophètes désarmés furent vainqueurs, et les désarmés déconfits ”. Savonarole fut un “ prophète désarmé ”, n’ayant pu, de ce fait, conserver le pouvoir obtenu au gré de circonstances exceptionnelles. Machiavel commence sa carrière officielle de secrétaire politique et de diplomate quelques jours après le supplice de Savonarole. Cette existence de secrétariat et d’ambassade, dangereuse au sein de jeux politiques aussi subtils que cruels où l’erreur se paie comptant, lui fournit le terrain d’observation d’où jaillira son œuvre. Il composa ses livres politiques pendant sa période d’éloignement forcé de la vie publique, entre 1512, année de l’écroulement de la république, et 1526, année où, il se met au service de la famille Médicis. Quel homme rencontrons-nous grâce à ce voyage rétrospectif? Pas le diable assurément, n’en déplaise aux sombres fanatiques et à leurs autodafés. Pas non plus un théoricien – un philosophe au sens de l’antiquité classique ou de l’intellectuel médiéval – ni un héros ou un prince, mais un observateur désabusé et un diplomate fidèle.
Que trouve-ton dans Le Prince, réputé le bréviaire des méchants ? Essentiellement de l’histoire naturelle prenant pour objet non les plantes et les animaux, mais l’univers de la politique. Les postures religieuses s’intègrent à leur tour dans la description en termes d’histoire naturelle. Un prince doit paraître posséder les qualités exigées par la religion – “ faisant beau semblant de les avoir, elles sont profitables ” – tout en évitant de les pratiquer trop scrupuleusement, car alors elles deviendraient nuisibles, conduisant à la perte. Histoire, dans “ histoire naturelle ”, se dit au sens grec de description et enquête: description froide et désillusionnée de la conduite des affaires politiques. Pourtant, Machiavel se sépare des Grecs. Dans Les Parties des animaux, Aristote inventa l’histoire naturelle, dont Machiavel suit l’esprit si ce n’est la méthode. Cependant, Aristote appliqua à toute la nature la notion de finalité, ce qui faussa son regard, quand, parallèlement, il mit à part de l’histoire naturelle les activités humaines tenues pour les plus hautes, l’éthique et la politique. Machiavel fait sauter ces deux verrous : d’un côté, il décrit ce monde politique comme si nulle finalité autre que la soif de pouvoir n’existait, et de l’autre, son regard de naturaliste porte beaucoup plus loin que celui d’Aristote, puisqu’il intègre dans sa logique quasi mécanique, l’univers de l’existence collective des hommes. Que les Borgia et les Médicis agissent comme il le firent, voilà qui est dans l’ordre de la nature!
Il appuie ses analyses sur une idée de l’homme issue de l’observation, non sur un présupposé métaphysique radical comme le feront Hobbes et Rousseau. Sur une anthropologie en situation. Qu’est-ce que l’homme ? Regardez-le en situation, observez-le dans les intrigues de cabinet, les empoisonnements de banquets, dans l’assaut d’une cité ou bien la défense d’une place forte, vous en apprendrez plus sur lui que dans les traités des philosophes et des théologiens ! Mais justement, regarder et observer sont des activités difficiles – il faut, pour y voir, pour ne point avoir la berlue, s’être guéri de la métaphysique et de morale, avoir jeté par-dessus bord tous ces filtres empêchant d’apercevoir la logique des choses. Le premier grand scandale que causa Le Prince, qu’il continue de causer, réside dans cette posture : écrire une histoire naturelle des activités humaines tenues pour les plus élevées, une histoire naturelle de la politique.
Le contenu du Prince s’éclaire par ce choix initial – décrire sans juger. Nous ne sommes plus, en cette première décennie du XVIème siècle, dans l’Antiquité, où la politique s’articulait intimement à l’éthique (Aristote, Platon), ni au Moyen Age, où elle s’ordonnait à Dieu, s’articulant à la théologie. En même temps, nous sommes pas encore dans la modernité, où la politique trouvera une configuration différente comme expression et organisation de la justice (de Rousseau à Rawls en passant par Marx). Machiavel occupe une position singulière dans cet entre-deux ères. La Renaissance est un mouvement de retour à l’antique ; le secret de Machiavel est de prendre des exemples dans l’Antiquité pour développer une conception de la politique a-éthique que l’Antiquité aurait repoussée, impensable dans l’univers gréco-romain. De ce point de vue, Machiavel n’est pas un homme de la renaissance italienne! Pas plus qu’un homme d’une autre époque – il n’est pas pour autant un homme de tous les temps, mais un type anthropologique que Nietzsche aurait appelé “ un intempestif ”, un homme à contre-temps.
Que dit-il, cet intempestif, dans Le Prince ? Le politique doit se conduire selon une exacte observation des hommes. Les “ hommes changent volontiers de maître, pensant rencontrer mieux ”. Cette propension à la versatilité explique l’instabilité des régimes tout en procurant une leçon de politique : il faut toujours être sur ses gardes, nul pouvoir ne se possédant définitivement. Des traits constants dessinent l’humanité : “ les hommes se doivent ou se caresser ou s’occire ; car ils se vengent des légères injures, et des grandes ils ne peuvent ; de sorte que le tort qui se fait à l’homme doit être tel qu’on n’en craigne point la vengeance… ”. Ou bien : “ c’est certes chose fort ordinaire, et selon nature, que le désir de conquérir ”. Et ceci : “ les hommes hésitent moins à nuire à un homme qui se fait aimer qu’à un autre qui se fait redouter ”. Les événements surviennent non en fonction d’une finalité ou de la volonté de Dieu, mais d’une logique aussi observable que celle guidant les comportements humains. Sur cette logique des événements, Machiavel est disert : “ une guerre ne se peut éviter, mais seulement se diffère à l’avantage d’autrui ”. Ou encore : “ celui qui est cause qu’un autre devient puissant se ruine lui-même ”, ainsi “ causant en Italie la grandeur du Pape et de l’Espagne, les Français y ont causé leur propre ruine ”. La logique des armes mercenaires : “ si on perd on reste battu, et si on gagne on demeure leur prisonnier ”. Logique aussi : “ la haine s’acquiert autant par les bonnes œuvres que par les mauvaises ” par suite le prince, pour conserver ses Etats “ est souvent contraint de n’être pas bon ”.
Et le prince, figure passagère de l’éternel politique, comment l’envisager ? On peut se faire prince par talent (tel François Sforza), on le peut par fortune (tel César Borgia). Le fondement de la politique repose dans la guerre (Julien Freund et Carl Schmitt le retiendront) : “ un prince ne doit avoir ni autre objet ni autre penser, ni prendre autre matière à cœur que le fait de la guerre et l’organisation militaire ”. Le prince doit savoir imiter et le lion et le renard : “ être renard pour connaître les filets, et lion pour connaître les loups ”. Toute l’attention du prince doit se porter sur les sentiments du peuple à son endroit. L’énoncé “ qui devient prince par l’aide du peuple, il le doit toujours maintenir en amitié ” en appelle un autre, encore plus important : tout prince “ doit sur toutes choses chercher à gagner à soi le peuple ”. Ne voyons pas ici le concept moderne de peuple, un sujet politique; le peuple s’identifie à la plèbe, une force passionnelle. Un conseil en découle: “ les princes doivent faire tenir par d’autres les rôles qui attirent rancune, mais ceux qui apportent reconnaissance les prendre pour eux-mêmes ”. La politique est la guerre entre les loups, pas la guerre contre la plèbe. Ainsi la pensée de Machiavel se situe-telle à mille lieues de la tyrannie anti-populaire, de la dictature et du totalitarisme. Elle n’est pas non plus une utopie, forme pensée pour la première fois par un contemporain de Machiavel, Thomas More. L’utopie est totalitaire, tandis que la principauté machiavélienne est un lieu de violence parce que la liberté du désir de conquête ne peut jamais être contenue définitivement.
Pourquoi tant de haine contre Machiavel ? Son livre convoque à paraître une vérité dont l’humanité veut ignorer l’existence sans pouvoir l’éloigner de ses yeux. Quelque chose dont le germe ou le grain sommeille en chacun de nous, hommes et femmes ordinaires. Quelle chose? Ni héros grec, ni monarque médiéval oint de Dieu, le prince machiavélien n’est pas d’une autre nature; il est chacun d’entre nous, possédant l’anneau de Gygès, il fait ce que nous ferions tous dans des circonstances analogues, et, il est aussi ce que nous faisons en petit, chacun d’entre nous, en dehors de la politique, chaque jour. Le prince, c’est l’homme ordinaire en grand, l’homme ordinaire libéré. Le second scandale de l’œuvre de Machiavel se dévoile: le prince n’est personne d’autre que chacun d’entre nous. La révélation de notre parenté secrète avec le prince rend Machiavel insupportable. En décrivant la politique, Machiavel nous tend un miroir, renvoyant une image si vraie et si difforme de nous-mêmes que nous ne la supportons pas.
Mais peut-être la haine se justifie-t-elle de la définitive déception que la vérité machiavélienne adresse à toutes les illusions humaines ? Dans ce cas, la haine anti-machiavélienne serait comparable à la haine anti-freudienne. La Bible et le Capital dessinent conjointement un horizon de salut, livres prophétiques promettant à l’humanité la fin de la vallée des larmes, un avenir radieux. Le Prince au contraire ne promet rien. Si gît une prophétie en lui, elle s’appelle répétition : dans le futur, se répétera ce que nous avons sous les yeux, qui s’est déjà produit. Ecoutons-le : “ les hommes marchent toujours par les chemins frayés par d’autres […] ils se gouvernent en leurs faits par imitation ”. Les cités changent, les techniques progressent, les hommes se répètent. Cette répétition ne repose nullement sur l’affirmation d’une nature humaine – ce qui serait de la métaphysique, tour d’esprit éloigné de Machiavel – mais sur la considération de la logique des situations humaines et des passions qui les investissent – ce qui est une mécanique des forces et des passions. Ce point de vue sur l’homme est beaucoup plus subtil qu’un banal pessimisme anthropologique. L’homme est toujours en situation, donc il est toujours méchant. Il est méchant, et non mauvais – mauvais est un terme de morale, renvoyant à une essence, un jugement n’entrant pas dans la perspective machiavélienne, tandis que méchant demeure un terme descriptif, suggérant qu’il ne peut en aller autrement. Se montre alors le troisième scandale de Machiavel: le mal n’est pas condamnable, puisque, loin de résulter d’une mauvaise nature des hommes (écho du péché originel), il suit de la logique situationnelle s’imposant à eux. L’homme n’est pas mauvais, il est méchant: la méchanceté est constante sans pour autant être de nature.
Machiavel prend place dans la galerie des auteurs tenus à jamais pour ennemis de l’humanité. Et cela, du fait que sa pensée n’est en aucune façon sauvable par la morale ou l’optimisme anthropologique. Il est beaucoup plus désespérant que Hobbes, chez qui le contrat neutralise la méchanceté, spontanée plutôt que naturelle, de l’homme. Au contraire, cette méchanceté spontanée forme chez Machiavel la matière sur laquelle travaille le politique. Elle est la toile dans laquelle la politique taille son habit (la cité, l’Etat). Tandis que chez Hobbes la politique inhibe cette méchanceté, chez Machiavel elle se sert de cette méchanceté comme le sculpteur se sert du marbre pour sa statue. Ici se présente le quatrième scandale de Machiavel: la politique ne promet aucune rédemption de la méchanceté, mais sa reconduction à l’infini.
Nulle doctrine politique ne se trouve dans Le Prince. Plus: on n’y rencontre aucune critique directe des théories politiques existantes. Machiavel est un penseur politique sans philosophie politique. Construit sur ce vide philosophique, son ouvrage est une éclaircie, un dévoilement : la clairière de la politique. Elle livre à la visibilité la pure politique. Avant Machiavel, la politique était recouverte par des philosophies, des mythes, des religions, des considérations morales; elle demeurait invisible. La pensée politique – sous la forme des philosophies politiques – empêchait de voir et regarder la politique dans son effectivité (“ il m’a semblé plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que son imagination ”). Après lui, après l’émergence de l’Etat moderne comme solution aux déchirements de l’Europe, se développeront les idéologies politiques, le progressisme, le marxisme, l’anarchisme, le libéralisme, tout un ensemble de dispositifs théoriques qui, du point de vue de la connaissance de la politique, reviendront au même que celui qui précéda Machiavel, empêcher de voir. L’œuvre de Machiavel est l’éclaircie entre deux nuits politiques, deux périodes où la politique tout en continuant de se pratiquer est occultée par les philosophies politiques. L’absence de philosophie politique conditionne l’accès à la vérité.
Les quatre scandales du Prince de Machiavel (la politique traitée comme une histoire naturelle; l’identité entre le prince et chacun de nous; l’homme étant méchant sans être mauvais; aucun horizon de rédemption ne se dégageant de la politique) se ramènent à un seul: Machiavel rend visible par l’écriture ce qui est fait pour ne pas être regardé, pour demeurer caché. Comme la nature selon Héraclite, la politique, en son essence, aime à se cacher, à se rendre invisible derrière ces voiles que sont les doctrines, les idéologies, les philosophies. L’écriture de Machiavel est analogue à la peinture, occupée à rendre visible l’invisible. Mais Le Prince peint ce qu’il ne faut pas peindre, visibilise ce qui, par nature, répugne à la visibilité: la politique. D’où son éternel scandale : demain comme hier.
Robert Redeker (La Vanvole, 21 juin 2017)