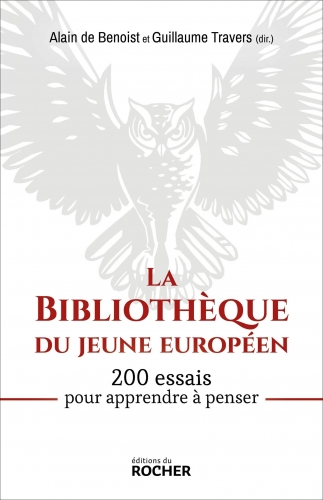La revue de presse de Pierre Bérard
Au sommaire :
• Dans l’émission de Tv Liberté consacrée aux dessous de la science Floriane Jeannin et Nicolas Faure abordent le point sensible des différences génétiques entre populations. À l’aide d’entretiens très divers avec de nombreux spécialistes ils concluent raisonnablement à une différence entre les populations examinées. Cette émission va au rebours de toute la bien pensance qui a imposé depuis la fin de la dernière guerre mondiale le dogme d’une égalité parfaite entre groupes humains. On appréciera à cet égard cette tribune paradoxale de Laurent Alexandre militant pour l’obscurantisme publiée dans Le Monde en 2018 : « La génétique ne peut pas prendre le risque de cautionner une idéologie inégalitaire. À titre personnel je suis farouchement opposé à l’ouverture de cette boîte de Pandore : exceptionnellement, les savants doivent faire passer la vérité scientifique après le principe philosophique fondamental de l’égalité des groupes d’homme ». Ne croirait-on pas entendre le pape s’exprimer face aux travaux de Galilée ?Galilée reprenant les conclusions de Copernic mettait en cause le dogme de l'immobilité de la terre au centre du cosmos. Les autorités ecclésiastiques craignaient que cette révélation ne fasse perdre leur foi aux chrétiens. Condamné, Galilée n’en murmura pas moins « Eppur si muove ». À notre époque qui se dit et se veut « progressiste » il semble bien que Lyssenko ait de nombreux adeptes, toujours acharnés à réduire au silence des scientifiques dont les conclusions déplaisent :
• Très éloigné des chimères, Machiavel entendait redécouvrir une pratique du politique affrontant le réel avec tout ce qu’il comporte de ténèbres. Partant d’une conception de l’homme tel qu’il est, Machiavel dans son art politique s’obstinait à se servir aussi bien de ses qualités que de ses défauts pour parvenir plus efficacement au but visé. Les vices des hommes ne sont donc pas un obstacle à la politique comme on l’estimait généralement à son époque mais peuvent s’avérer autant d'atouts pour atteindre le bien commun. Il écrivait : « En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal » et encore « Un prince ne doit avoir autre penser, ni prendre autre matière à coeur que le fait de la guerre et l’organisation et discipline militaire ; car c’est le seul art qui appartient à ceux qui commandent ». Un enseignement que sauront retenir tous les philosophes réalistes de Carl Schmitt à Julien Freud. La force alliée à la ruse est ce qui fait la Puissance qui déjà un bien nous apprend ce patriote italien qui a beaucoup fait pour déniaiser la conception du politique. Ici un présentation lumineuse d’Ego Non :• Une belle réflexion de Pierre le Vigan sur l’amor fati. Méditation entre liberté, sens des limites et lucidité. Il fait la part belle aux nihilismes contemporains qu’il convient absolument de surmonter :• Le dernier numéro d’I-Média porte essentiellement sur la révolte des personnels militaires et policiers contre la mollesse, pour ne pas dire l’impuissance, de l’appareil gouvernemental vis à vis de la violence qui monte inexorablement en France et contre la protection de fait dont jouissent trop souvent ses auteurs. Si cette révolte appuyée par une grande majorité de nos concitoyens, est pour le moment purement symbolique elle n’en accuse pas moins un délitement de la nation qui pourrait prendre un tour dramatique. Les animateurs de l’émission citent à ce propos George Orwell : « À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire ». Ne se pourrait-il pas que malgré le travail consciencieux des médias de propagande la vérité finisse par sortir du puits ? :• Très brève recension par Aristide Leucate du livre d’Alain de Benoist L’homme qui n’avait pas de père. Le dossier Jésus. Une biographie de 964 pages in-octavo, c’est dire si le laconisme de l'article en question voulu par le format des éditoriaux de Boulevard Voltaire ne suffit pas à rendre compte de cette oeuvre monumentale. On y souligne néanmoins que cet opus est de facture universitaire :• Commentant le dernier livre de Patrick Buisson La fin d’un monde (Albin Michel) l’économiste Guillaume travers souligne la hauteur de vue de l’auteur qui se montre un excellent historien des mentalités. S’attachant à décrire la véritables révolution des moeurs qui s’étend sur la période 1960-1975 l’auteur à l’aide de tout un ensemble de documents dresse un inventaire précis de tout ce que nous avons perdu au cours de ces quinze années marquées par la fin du monde paysan, l’effondrement de l’Église et l’éclipse du sacré ainsi que l’effacement des pères. « Les noces multiséculaires du catholicisme français et du monde rural, fondées sur la permanence, la stabilité, la répétitivité, et l’étroite correspondance des cycles religieux et des cycles temporels, furent ainsi rompues comme fut refoulé l’univers symbolique qui s’y rattachait ». Ces pertes ont fait place au vide intégral et à l’étrange soulagement de n’être plus rien qui accable l’homme contemporain :• Patrick Buisson l’antimoderne plein de subtilité s’en prend au capitalisme accusé d’être le grand broyeur des moeurs, des coutumes et de l’esprit traditionnel et ainsi d’avoir fait le malheur des hommes qu’il a privé de sens et mis intégralement à nu. Une réflexion solide sur le sens du sacré et des permanences bouleversées depuis quelques décennies par l’évolution d’un système dont l’hubris est partie prenante. Ce que nous dit Buisson c’est que le capitalisme n’est que secondairement un système économique; il est d’abord et avant tout une anthropologie :• Commentant les trois numéros spéciaux qui ont consacré leur une à l’immigration (Le Figaro enquêtes, Front Populaire et Valeurs Actuelles hors-série) Paul Tormenen de Polémia tire la conclusion qu’il y a péril en la demeure. Ces numéros présentent en effet des enquêtes très fouillées qui montrent que « Le grand remplacement » loin d’être une « théorie » « complotiste » ou « paranoïaque » comme s’efforcent de nous le faire croire ceux qui ne veulent pas voir est bien une réalité. L’immigration est une réalité brûlante qui pourrait demain exploser à la figure de ceux qui pratiquent la cécité volontaire au nom d’un humanisme à courte vue :• Michel Maffesoli vient de faire paraître L’ère des soulèvements qu'il présente comme un pamphlet. De l’éruption des gilets jaunes à la contestation de la gestion de la pandémie (il parle de psycho-pandémie), des grèves émeutières pour contrecarrer le libéralisme mondialisé à la vague d’émotion planétaire suscitée par l’incendie de Notre-Dame et encore à l’existence aseptisée qu’on nous propose, ce sociologue de l’imaginaire et du quotidien traque le changement de paradigme que nous sommes entrain de vivre. Pour lui il est évident que le règne de la rationalité, de la technique et de l’individualisme forcené s’achève convulsivement pour le meilleur et pour le pire. Nous entrons dans l’ère des révoltes, ce que la ploutocratie politico-médiatique, démocrate mais non démophile, ne veut pas voir. Ci-joint un entretien avec le site Breizh info :• La Nouvelle Librairie produit une vidéo d’une heure et demi avec Renaud Camus dont elle vient de publier une édition complète et actualisée du livre Le Grand Remplacement :• Dans cette excellente vidéo l’africaniste Bernard Lugan reprend les arguments essentiels de son denier livre Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Il analyse la généalogie de ces mouvements, leur corpus idéologique et leurs objectifs ainsi que les relais sur lesquels ils s’appuient pour diffuser leurs idées boiteuses dans le corps social :• Le site de Geopragma relaie le texte de la Tribune des généraux et pose intelligemment la question d’une interprétation trop restrictive du devoir de réserve dans l’expression des militaires. Une obligation trop ficelée qui peut en effet brider les intérêts les plus élevés de la nation tandis qu'une réflexion libre peut par sa pertinence amender la sclérose intellectuelle des état-majors. Les exemples en sont nombreux de Charles de Gaulle à Marc Bloch. Le texte pose le problème de l’utilisation de la matière grise des combattants du front, souvent en contradiction avec celle trop attendue des béni-oui-oui de la hiérarchie en reprenant opportunément cette citation de Thucydide : « Une nation qui fait une grande distinction entre ses érudits et ses guerriers verra ses réflexions faites par des lâches et ses combats menés par des imbéciles ».• L’historiographie espagnole grande pourvoyeuse de la révision du mythe d’al-Andalus comme prétendu paradis de la tolérance religieuse. Dans ce texte de Nicolas Klein nombreuses réflexion sur les relations qu’entretient l’Espagne avec le monde arabe :• Frédéric Le Moal explique très bien comment le fascisme parvint au pouvoir face à un régime libéral éreinté et déconnecté des masses :