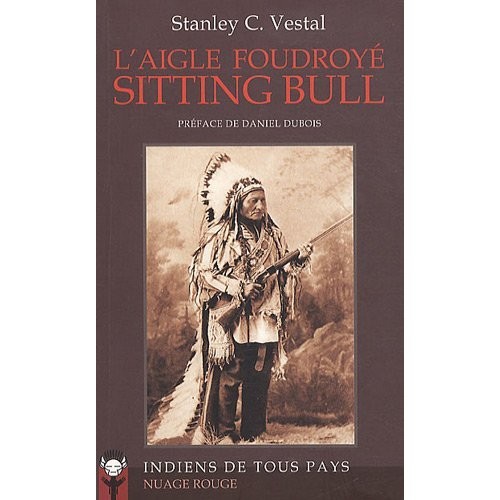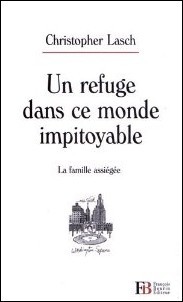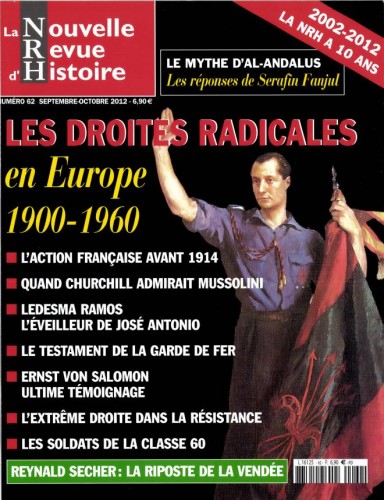« Les partis politiques, quels qu'ils soient, sont par nature allergiques aux idées »
A quoi attribuez-vous la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012 ?
Je pense qu’on l’avait tout simplement trop vu. La vulgarité du personnage, sa façon de vouloir tout faire, d’être partout, d’intervenir sur tout, avaient suscité dans l’opinion une sorte d’overdose. D’où la chute de popularité sans précédent qu’il a connue dans la seconde partie de son quinquennat. Cela dit, il y a aussi des raisons plus sérieuses, sinon plus ponctuelles. Sarkozy a déçu son électorat de droite sans parvenir à séduire la gauche. Il avait proposé de « travailler plus pour gagner plus », mais ceux qui ont travaillé plus ont finalement gagné moins. Insécurité grandissante, baisse du pouvoir d’achat, précarisation de l’emploi, multiplication des délocalisations : les gens ont constaté que rien ne s’est amélioré dans leur vie quotidienne. Ils ont réagi en conséquence. C’est ce qui a donné à leur vote l’allure d’un plébiscite pro ou anti-Sarkozy.
Faut-il tenir Patrick Buisson – l’ancien conseiller spécial du président sortant – pour responsable du fiasco ? La stratégie de droitisation. Orientation fortement remise en cause par des caciques de l’UMP.
Je ne le crois pas un instant, tout au contraire. Si Sarkozy a pu passer de 27 % des voix au premier tour à plus de 48 % au second, ce qui représente une progression considérable, c’est bien parce qu’il a verbalement infléchi son discours à droite entre les deux tours. S’il ne l’avait pas fait, il n’aurait pas dépassé 35 %. Les caciques de l’UMP qui se refusent à le reconnaître sont des gens qui s’imaginent qu’on peut séduire la droite en lui tenant un discours centriste, ou qu’un discours plus recentré aurait permis à Sarkozy d’obtenir un plus grand nombre de voix d’électeurs de gauche. Cela aurait pu être vrai s’il avait eu à affronter Mélenchon au second tour, pas François Hollande que personne ne pouvait considérer comme un extrémiste (comme en témoigne le ralliement de François Bayrou).
Qu’est-ce que le sarkozysme ? Une idéologie ? Un style de présidence ? Une façon de voir le monde ?
Rien de tout cela, pour la bonne raison que le « sarkozysme » n’existe pas. Il y a simplement eu un moment Sarkozy dans l’histoire de la Ve République. Ce moment s’est caractérisé par la mise en œuvre d’une sorte de libéralisme autoritaire, par une désacralisation accélérée de la fonction de chef de l’Etat, par une pratique sociale au service des plus riches, par un alignement de fait sur la politique des Etats-Unis d’Amérique, par le règne du paraître et le pouvoir des mots.
Quel bilan faites-vous du mandat de l’ancien chef d’Etat ? Et y a-t-il des choses positives ? Jean d’Ormesson dans une interview accordée au Figaro Magazine (1) pense que dans quelques années, on se rendra compte qu’il était un grand président. Qu’on l’a mal jugé !
Aucun régime n’est jamais totalement bon ni totalement mauvais. Mais c’est le bilan général qui compte. Je le trouve pour ma part détestable. Avec Sarkozy, nous avons assisté à la liquidation d’un certain nombre d’acquis sociaux hérités de plus d’un siècle de luttes sociales, à une désindustrialisation grandissante, à une perte d’indépendance dont la piteuse réintégration du commandement intégré de l’Otan a été le point d’orgue, à un engagement militaire dans des guerres qui ne nous concernent en rien (Afghanistan) ou des opérations militaires totalement dépourvues de sens (Lybie). Face à la crise financière mondiale, Sarkozy a déplacé beaucoup d’air, mais n’a rien réglé sur le fond. Le sentiment de Jean d’Ormesson, qui s’y entend en politique à peu près comme moi en mathématiques supérieures, a le mérite du pittoresque, mais je crois qu’il rêve debout. Sarkozy me semble plutôt appelé à connaître le sort de ces présentateurs de télévision qu’on voit tous les soirs, mais auxquels personne ne pense plus dès qu’ils ont définitivement quitté l’écran. Il a abandonné le pouvoir il y a trois mois à peine, mais j’ai l’impression qu’on l’a déjà oublié.
Nicolas Sarkozy était-il de droite ou à droite ?
Pour répondre à cette question, il faudrait déjà savoir quel sens on donne au mot « droite », et si ce sens n’est pas aujourd’hui devenu obsolète.
Quels thèmes auriez-vous souhaité que les politiques abordent pendant cette campagne ?
J’aurais aimé les entendre parler de géopolitique mondiale, des causes profondes de la crise financière actuelle, de la guerre menée par les marchés financiers contre les Etats, de la mise en place d’un nouveau « Nomos de la Terre », s’interroger sur les finalités de la construction européenne ou sur les fondements de la logique du profit et de l’axiomatique de l’intérêt, discuter de la question des alliances et des rapports de force, évoquer l’Asie centrale et la crise du Proche-Orient, l’épuisement des ressources naturelles, etc.
Pourquoi cette hémiplégie ?
D’abord, parce que ce ne sont pas là des sujets qui passionnent les électeurs (ils ne réalisent pas en quoi cela les concerne). Ensuite, parce qu’on ne peut pas en traiter sans se référer à idées, et que les idées, c’est bien connu, divisent l’opinion alors que dans une élection présidentielle on cherche avant tout à rassembler. Enfin et surtout parce qu’aucun des candidats ne se situait dans une perspective de franche rupture par rapport à l’idéologie dominante. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’abstention progresse assez régulièrement : les gens comprennent bien que les élections permettent une alternance, mais ne fournissent pas d’alternative.
La droite française est-elle en pleine crise idéologique, en « décomposition » comme le disent les politologues ? Ou bien s’agit-il d’une mauvaise passe ?
Toutes les familles politiques, « de droite » comme « de gauche », sont aujourd’hui plongées dans une profonde crise d’identité dont les causes sont nombreuses. L’une de ces causes est le « recentrage » des discours et des programmes, qui donne l’impression (confirmée dans les sondages) qu’il n’y a plus de véritables différences entre la droite et la gauche. Les divers partis apparaissent de plus en plus comme interchangeables, ce qui explique la volatilité électorale : les gens votent pour un parti après l’autre de la même façon qu’ils « zappent » entre des chaînes de télévision. Comme le résultat est toujours plus ou moins le même, ils sont toujours plus déçus. Une autre cause est que le paysage politique actuel continue d’être structuré, surtout dans sa dimension parlementaire, par des références obsolètes. La preuve en est que tous les grands événements de ces quinze dernières années ont créé des clivages nouveaux, qui traversent en diagonale les familles existantes. Le clivage droite/gauche est né avec la modernité, il tend à disparaître avec elle. Quant à la « décomposition » des partis, elle va de pair avec une décomposition plus générale : disparition des repères, incapacité à transmettre, instauration d’un climat sub-chaotique, dé-liaison sociale généralisée.
Vous avez beaucoup travaillé sur la droite, entre autres. Qu’est-ce qui la différencie aujourd’hui de ce qu’elle était, il y a dix ans, sous l’ère Chirac ?
Je ne vois guère de différences. La droite se partage toujours entre une composante populaire plus ou moins nostalgique du gaullisme, une petite-bourgeoisie (les classes moyennes inférieures) qui louche vers le Front national, et une grosse bourgeoisie acquise au libéralisme et à la mondialisation. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le libéralisme n’a cessé de monter en puissance à l’intérieur de la droite, fût-ce en se conjuguant avec une rhétorique populiste xénophobe qui n’appartient pourtant pas à son héritage historique.
Le score de Marine Le Pen à la présidentielle, la montée en puissance de ses idées, augurent-t-il des jours sombres pour l’UMP ?
En théorie, oui. Mais l’UMP reste une machine de guerre dotée de moyens matériels infiniment supérieurs à ceux du FN, qui souffre de surcroît d’un sérieux manque de cadres. La logique des choses voudrait que l’on assiste d’abord à une décomposition politique de la droite suivie d’une décomposition sociale de la gauche, ce qui aurait au moins le mérite de déblayer le paysage. Mais la logique est une chose, la réalité historique en est une autre. Beaucoup de choses dépendent en outre des circonstances extérieures, qui sont aujourd’hui plus incertaines que jamais. L’histoire des hommes est par définition imprévisible, et donc toujours ouverte.
Vous venez de publier Mémoire vive (2). Une autobiographie dans laquelle vous parlez à cœur ouvert. Pourquoi cet ouvrage maintenant ? Un désir de faire le point sur votre vie et de mieux faire partager votre pensée à un public qui a beaucoup entendu parler de vous mais qui vous connaît peu, finalement !
Je crois qu’à partir d’un certain âge, on devient toujours un peu chroniqueur de soi-même. On éprouve aussi le besoin de faire au moins un bilan d’étape. Mémoire vive est en fait un livre double. C’est d’un côté un livre strictement autobiographique, où je raconte des choses très personnelles dont je n’avais jamais eu auparavant l’occasion ni le désir de parler. De l’autre, c’est une tentative de reconstruction d’un itinéraire intellectuel, d’un « chemin de pensée » poursuivi depuis déjà un demi-siècle. Chemin faisant, j’évoque les événements et surtout les personnalités que j’ai eu l’occasion de connaître. Il ne s’agit nullement de « mieux faire partager ma pensée », mais seulement de donner à ceux qui me lisent la possibilité de mieux me connaître et à ceux qui ne m’ont pas lu une occasion, peut-être, de rompre avec quelques idées reçues.
Que reste-il de La Nouvelle Droite en 2012 ? Et d’après vous, quelles sont les idées dans ce courant de pensée que l’UMP a intégrées ?
Ce que les médias ont appelé à partir de 1979 « Nouvelle Droite » – étiquette dans laquelle je ne me suis jamais pleinement reconnu – a été une grande, belle et durable aventure de la pensée. Cette aventure s’est toujours tenue à l’écart des engagements politiques partisans, pour s’en tenir à un travail engagé dans le domaine des idées, de la culture, de la connaissance et du savoir. Elle se poursuit toujours, non seulement au travers de mon œuvre, mais par l’intermédiaire des revues (Eléments, Nouvelle Ecole, Krisis) dans lesquelles s’exprime cette école de pensée. Quelles sont les idées que l’UMP a intégrées ? Aucune, bien entendu. Je l’ai déjà dit : les partis politiques, quels qu’ils soient, sont par nature allergiques aux idées (ils préfèrent évoquer les « valeurs » dont ils se réclament, sans jamais dire desquelles il s’agit). C’est la raison pour laquelle on ne peut à la fois faire de la politique et prétendre être un intellectuel digne de ce nom. J’ajoute qu’il serait pour le moins paradoxal de voir un parti comme l’UMP mettre en cause la société de marché, dénoncer l’exploitation du travail vivant et la colonisation de l’imaginaire symbolique par les valeurs marchandes, l’arraisonnement généralisé de la planète par l’idéologie de la croissance et la logique du Capital, bref se réclamer d’une pensée critique qui contredit à angle droit ses intérêts de classe !
Dans votre livre, vous dites que vous êtes « de droite et de gauche ». Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire et comment peut-on être des deux à la fois ?
C’est d’abord une formule qui signifie que je suis indifférent aux étiquettes. Les étiquettes, c’est le paraître, le contenant, alors que seuls les contenus m’intéressent. Cela veut dire aussi qu’en tant qu’historien des idées, ce qui me paraît le plus nécessaire n’est pas tant d’identifier des « idées de droite » ou des « idées de gauche » que de distinguer les idées fausses des idées justes. Au cours des deux derniers siècles, de nombreuses thématiques sont d’ailleurs passées de droite à gauche, ou vice versa. C’est la raison pour laquelle mes auteurs de référence, que j’évoque longuement dans Mémoire vive, appartiennent à des familles politiques ou idéologiques extrêmement variées. Disons que c’est ma façon de voir le monde qui organise ces différentes influences dans un ensemble structuré que je crois cohérent.
Quelles sont les idées qui à droite sont passées à gauche et vice-versa ?
Le nationalisme, souvent classé à droite, est né à gauche à l’époque de la Révolution française, qui fut la première à considérer la nation comme une entité politique souveraine. Au XIXe siècle, l’idéologie coloniale fut essentiellement propagée par des hommes de gauche, comme Jules Ferry, tandis que la droite y était en général hostile ; au siècle suivant, ce fut le contraire. Le régionalisme et l’autonomisme se situaient plutôt à droite dans les années 1930, à gauche dans les années 1960. L’idéologie du progrès, associée à la philosophie des Lumières, a d’abord été combattue par la droite contre-révolutionnaire. Elle est aujourd’hui critiquée par la gauche écologiste, qui récuse le productivisme et les diktats de la techno-science. On pourrait donner bien d’autres exemples.
Vous dites, page 49, qu’il y a « un conformisme de l’anticonformisme. » Pouvez-vous nous donner des exemples ?
Le style « bobo » en est l’incarnation même. Le libéralisme sociétal (la « liberté des mœurs ») se donne volontiers pour anticonformiste, mais s’intègre pleinement dans un système économique dominant qui tire profit de la tendance des individus et des groupes à vouloir faire reconnaître n’importe quel désir comme une « norme ». La « libération sexuelle » des années 1960-1970 a surtout permis de créer un profitable marché du sexe. D’autres croient « violer des tabous » en s’en prenant à la famille, à la religion ou à l’armée, sans s’apercevoir qu’ils tirent sur des ambulances. Il y a longtemps que ce ne sont plus là des tabous ! Les mêmes prennent d’ailleurs bien soin de ne violer aucune des règles du politiquement correct actuel. Une autre manière de tomber dans le conformisme de l’anticonformisme est de s’engager contre le fascisme à une époque où le fascisme a disparu, ou contre le communisme à une époque où celui-ci s’est effondré. C’est à la fois rentable et sans aucun risque. Ces gens-là n’ont pas la moindre idée du moment historique où ils vivent. Ils cheminent dans l’existence en regardant dans leur rétroviseur, ils croient pouvoir livrer des guerres qui sont déjà terminées. Ils n’ont pas compris que l’époque postmoderne, qui est celle du capitalisme absolu, est à la fois post-fasciste et post-communisme, post-bourgeoise et post-prolétarienne.
Vous avez déclaré à plusieurs reprises que les valeurs du capitalisme sont plus un danger pour la civilisation occidentale que l’islamisme radical. Que l’impérialisme fait plus de dégâts que l’extrémisme musulman. Pourriez-vous développer ce point qui va à l’encontre des idées reçues ? Quels sont vos critères dans cette analyse ?
Je viens de le dire, nous vivons à l’époque du capitalisme absolu, qui est bien différent de l’ancien capitalisme marchand ou industriel. Le vieux capitalisme avait encore un ancrage territorial, tandis que le capitalisme actuel est entièrement déterritorialisé. C’est la raison pour laquelle son alliance avec les classes moyennes a pris fin. L’essence du capitalisme réside dans son illimitation (le Gestell dont parle Heidegger), dans cette forme d’hybris qui le porte à la suraccumulation du capital et qui explique son déploiement planétaire dans un monde qu’il rêve de transformer de part en part en marché homogène. Comme Marx l’avait bien vu, tout ce qui risque d’entraver cette perpétuelle fuite en avant (cultures différenciées, valeurs partagées, etc.) devient un obstacle à supprimer. Toutes les valeurs sont rabattues sur la valeur d’échange, ce qui revient à dire que rien n’a plus de valeur, mais que tout a un prix. L’Homo œconomicus est posé comme un être qui se réduit à sa fonction de producteur-consommateur et ne cherche dans la vie qu’à maximiser de manière égoïste son meilleur intérêt personnel. Tout cela me paraît en effet plus grave que l’« extrémisme musulman » car cela met en cause, non pas du tout seulement la « civilisation occidentale », qui n’est pas mon souci prioritaire, mais les modalités mêmes de la présence humaine au monde. Quant à l’« extrémisme musulman », qui n’est qu’un extrémisme politique sous habillage religieux, il faudrait encore savoir comment on le définit et surtout quelles en sont les causes.
Faut-il intervenir en Syrie comme le demande l’ONU ? Certains, comme Richard Labévière (3) disent que la situation est complexe. Que les médias occidentaux diabolisent le régime de Bachar Al Asaad et que des forces extérieures cherchent à démanteler le pays. Etes-vous d’accord avec lui ? En d’autres termes, à qui profite le crime ?
La première condition pour ramener le paix en Syrie consisterait, non pas à y intervenir, mais à cesser d’y intervenir, afin de laisser les Syriens décider par eux-mêmes de leur sort. Il y a maintenant des années que les puissances occidentales font tout pour déstabiliser la Syrie dans le cadre d’un programme de balkanisation du Proche-Orient, dont on a déjà vu les résultats en Irak et en Libye. Il s’agit toujours de diviser pour régner. En Syrie, la rébellion a dès le début été soutenue, financée et armée par l’Arabie Saoudite et le Qatar, appuyés par la France, l’Angleterre et les Etats-Unis. Parmi ceux qui combattent dans ses rangs, on trouve un grand nombre de « djihadistes » étrangers. Les médias occidentaux, auxquels le prétendu « printemps arabe » n’a pas servi de leçon, cherchent à faire croire que le conflit oppose un dictateur à des foules désireuses d’instaurer la démocratie et la paix. C’est être aveugle sur la réalité des choses. La fin du régime alaouite en Syrie donnerait le signal du massacre des chrétiens et se traduirait par la montée en puissance de ces mêmes extrémistes musulmans dont vous parliez à l’instant. La Chine et la Russie l’ont bien compris. Ils n’ont pas oublié que, depuis l’époque de la guerre froide, les Etats-Unis ont toujours soutenu les régimes islamistes contre les mouvements laïques du monde arabe. Reste à savoir si Israël veut voir les Frères musulmans s’installer sur sa frontière nord, après avoir déjà pris le pouvoir en Egypte.
Vous ne niez pas les exactions commises par le régime et le clan Al Assad !
Dans une guerre civile, il n’y a pas de partie innocente. Le gouvernement syrien combat la rébellion avec une grande brutalité. Les rebelles multiplient eux aussi les massacres et les exécutions sommaires ; les médias occidentaux oublient simplement d’en parler. Les Américains dénoncent Bachar Al Assad, qui est incontestablement un dictateur, mais ils s’accommodaient très bien de Moubarak en Egypte ou de Ben Ali en Tunisie, qui étaient leurs alliés. C’est aussi la raison pour laquelle ils ferment les yeux sur l’application de la sharia en Arabie Saoudite.
On s’est peu attardé sur la disparition du philosophe Roger Garaudy. Que retenez-vous de son œuvre et comment expliquez-vous ce service minimum ?
Ce service minimum s’explique apparemment par les polémiques auxquelles il a été mêlé à la fin de sa vie, et notamment à ses prises de position violemment « antisionistes ». Du coup, on a oublié son œuvre philosophique, qui n’est pourtant pas mince. Pendant des décennies, Garaudy a été le principal intellectuel du parti communiste français. Ancien déporté dans un camp d’internement de Vichy en Afrique du Nord, élu après la guerre député, puis sénateur, il fut longtemps membre du comité central du PC, dont il ne fut exclu qu’en 1970. Il est mort quasi centenaire après avoir publié plus de 70 ouvrages. Son livre sur La théorie matérialiste de la connaissance (1953), ses travaux sur la morale marxiste (1963) ou la pensée de Hegel (1966) mériteraient sans doute d’être relus aujourd’hui.
Qu’est-ce qui caractérise le plus notre époque, notre société ? Le spectacle, la diabolisation de certains intellectuels, la fin des idéologies, l’absence de débats ? Certains auteurs parlent de « liquéfaction » du corps social.
Difficile de répondre de façon succincte à cette question. Nous sommes actuellement dans une époque de transition. Nous voyons se dissiper les contours de l’ancien monde, sans que se précise nettement celui qui vient. Je ne parlerais certainement pas de « fin des idéologies ». Le thème de la fin des idéologies, très à la mode il y a une trentaine d’années, ne vaut pas mieux que celui de la « fin de l’histoire » lancé par Francis Fukuyama. Toute société humaine a son idéologie dominante. Celle qui domine aujourd’hui est l’idéologie de la marchandise. La diabolisation de certains intellectuels, l’absence de vrais débats, sont surtout des phénomènes propres à la France. Quant à l’approche de la société en termes de spectacle et de consommation, qui remonte pour le moins au situationnisme, elle reste encore insuffisante pour décrire des évolutions plus récentes, comme la montée du technomorphisme dans la vie quotidienne (la dépendance à la télécommande et aux écrans), la féminisation de la vie sociale, la vogue des « victimes », la montée comme type humain de l’individu narcissique immature, la désinstitutionnalisation, la privatisation de la foi (la croyance religieuse n’est plus aujourd’hui qu’une opinion parmi d’autres), etc. La notion de « société liquide » proposée par Zygmunt Bauman me semble intéressante. Elle explique bien comment le transitoire, le changeant, l’éphémère, tend dans tous les domaines à remplacer ce qui, auparavant, paraissait à la fois durable et constant. Les sociétés occidentales actuelles relèvent d’une logique à la fois « maritime » et commerciale : tout y est affaire de flux et de reflux, de communautés et de réseaux.
Que vous inspirent les nouveaux philosophes ? Gilles Deleuze parlait d’imposture à leur sujet. Il disait qu’il n’y avait aucune philosophie. Etes-vous de cet avis et qu’ont-ils apporté au débat d’idées ?
Voilà une question qui nous ramène plus de trente ans en arrière ! Deleuze n’avait pas tort de parler d’imposture à propos des ex-nouveaux philosophes, dont la contribution proprement philosophique reste encore à identifier. La « nouvelle philosophie » me paraît surtout avoir constitué une sorte de sas permettant à d’anciens révolutionnaires de se « repentir » à bon compte et, sous couvert de réalisme, de se rallier à un système en place gouverné par l’idéologie des droits de l’homme et celle du marché.
Comment expliquer leur popularité auprès des médias français ?
Les médias parlent de ce dont on parle, ce qui signifie qu’ils amplifient tout naturellement les « coups » médiatiques qu’ils ont été les premiers à lancer. Ils ont par ailleurs très vite compris ce qu’il y avait d’utilisable chez les « nouveaux philosophes », disons pour faire bref un nouveau mode de légitimation du désordre institué. Il est notoire, enfin, que les compétences philosophiques de la plupart des journalistes tiennent à l’aise sur un confetti.
Dans votre livre, vous semblez ne pas tenir grief à Pierre-André Taguieff. Or La Force du préjugé (4) est un essai théorique dans lequel il vous accusait « de racisme masqué ». Cet auteur, relayé par d’autres et qui se sont appuyés sur ses écrits, a contribué, pour une grande part, à votre diabolisation en France. Pourquoi cette mansuétude ?
Je n’ai pas du tout le sentiment que Pierre-André Taguieff ait joué un rôle majeur dans ce que vous appelez ma « diabolisation ». C’est bien plutôt lui qui a été diabolisé pour avoir tenté d’analyser le phénomène de la « Nouvelle Droite » autrement qu’à coups d’anathèmes et de slogans. Vous citez La force du préjugé, qui est un livre paru il y a plus de vingt ans. Depuis lors, Taguieff a publié nombre d’écrits dans lesquels il a adopté à mon égard des attitudes assez variées. Comme il lit ce dont il parle, il a tenu compte de mon évolution. J’ajoute qu’il a évolué lui-même, sans doute plus encore que moi (il ne fait pas de doute que je suis aujourd’hui beaucoup plus à gauche que lui !). Quant au « racisme masqué » d’un auteur, moi en l’occurrence, qui a publié à ce jour trois livres contre le racisme, la formule a plutôt de quoi faire sourire.
Il n’a jamais fait partie du GRECE5 (5)? On dit même qu’il participait à certains de vos travaux. Réalité ou légende ?
Légende, évidemment. Mais vous noterez qu’elle contredit votre question précédente : si Pierre-André Taguieff avait voulu « diaboliser » le GRECE, on ne l’aurait pas accusé d’en faire partie, ou du moins de nourrir à son endroit des sympathies suspectes. Taguieff a parfois assisté à des réunions ou des colloques organisés par le GRECE, comme l’ont fait de nombreux journalistes. J’ai souvent eu des discussions avec lui, et ne l’ai jamais regretté. C’est un interlocuteur d’excellent niveau.
Votre pensée a évolué au fil du temps et des rencontres. Pouvez-nous dire, néanmoins, les idées, les concepts auxquels vous n’avez jamais renoncé pour expliquer le monde, les rapports sociaux, politiques ?
Je n’ai d’abord jamais renoncé aux exigences de la pensée critique. Je n’ai jamais renoncé à militer en faveur d’une Europe autonome, politiquement unifiée, qui soit à la fois un pôle de puissance dans un monde multipolaire et un creuset de culture et de civilisation. Je n’ai jamais renoncé à l’idée que la diversité constitue la plus grande richesse du monde, et que toutes les doctrines universalistes, religieuses ou profanes, qui tentent de réduire cette diversité au nom de l’Unique, sont des doctrines nocives qui doivent être combattues sans merci. Mais je ne vais pas entamer ici un petit credo personnel. Pour en savoir plus, il faut lire Mémoire vive !
Qu’attendez-vous du gouvernement Ayrault et de la présidence Hollande ?
Quand les hommes politiques arrivent au pouvoir, c’est en général pour découvrir leur impuissance. Pour des raisons qui excèdent leurs personnes, je ne crois donc pas qu’il y ait beaucoup à attendre de François Hollande ou de Jean-Marc Ayrault. Je crains qu’ils n’aient pas la carrure nécessaire pour faire face à la crise généralisée dont la situation présente est un signe avant-coureur. Pour desserrer l’étau du système de l’argent, il faut beaucoup de volonté et beaucoup de moyens. A mon avis, les deux leur font défaut.
Merci Alain de Benoist. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Mémoire vive, avec François Bousquet, aux Editions de Fallois.
Alain de Benoist
Notes :
1. Jean d’Ormesson, « L’injustice faite à Sarkozy » in Le Figaro Magazine, le 03/05/2012.
2. Mémoire vive, Entretiens avec François Bousquet, Editions de Fallois, 2012.
3. Ancien rédacteur en chef de RFI et TV5 in Eléments, n°143, 2012, pp.6 et 7.
4. Pierre-André Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Editions Gallimard, 1991.
5 Groupement de recherches et d’études pour la civilisation européenne.