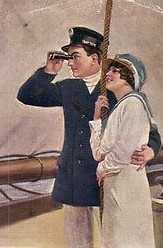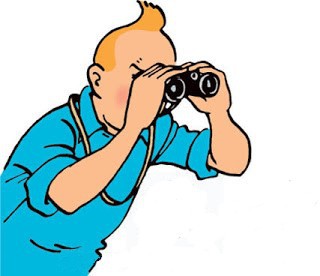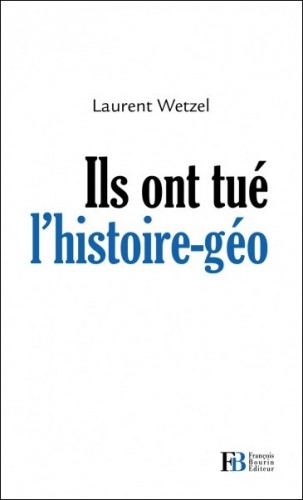Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jean-Paul Brighelli, cueilli sur le site du Point et consacré à la prise de pouvoir de Bruxelles dans le domaine de l'éducation "nationale"...

Le cauchemar de l'école européenne
Connaissez-vous le protocole de Lisbonne ? Non ? Vous avez tort : c'est, depuis quatorze ans, le programme qui réglemente l'école de la République.
Mais, dites-vous, il n'y a plus guère d'école.
Ben oui. Ni, d'ailleurs, de République. Il m'est arrivé, par pur esprit polémique bien entendu, de dire que la rue de Grenelle, où se trouve le ministère de l'Éducation, commence et finit à Bercy, tant la politique scolaire a été conditionnée, ces dernières années, par les oukases du ministère des Finances. Approximation ! La rue de Grenelle commence et finit à Bruxelles, grâce à la "stratégie de Lisbonne". Géographie curieuse ! Mais comme on n'enseigne plus trop la toponymie...
C'était en mars 2000. Les objectifs définis par le Conseil de l'Europe à cette date ont été réaffirmés à maintes reprises, en 2001 à Göteborg, puis à chaque "point d'étape" : dès 2003, en France, le "rapport Garrigue" déplorait une insuffisante mise en conformité (entendez-vous combien ce mot est proche de "conformisme" ?), et l'année suivante Wim Wok, l'ancien Premier ministre néerlandais, trouvait que les choses n'allaient pas assez vite : "Il y a beaucoup à faire pour éviter que Lisbonne ne devienne un synonyme d'objectifs manqués et de promesses non tenues", disait-il alors. Il fallait accélérer - c'est la stratégie européenne chaque fois que l'on va dans le mur. Chatel puis Peillon s'en sont chargés.
Le modèle américain
C'est que la "stratégie de Lisbonne", qui est exclusivement à visée économique, a pensé pour nous l'Éducation. C'est là, et nulle part ailleurs, que les politiques scolaires européennes ont été pensées. C'est en application des décisions prises par une assemblée d'économistes européens, dont on sait à quel point ils sont à la botte des grands argentiers internationaux, que l'école française connaît, depuis quinze ans, cette admirable embellie dont profitent tant nos élèves, comme le rappelle Pisa à chaque évaluation...
Quelles sont les décisions prises à cette époque - et appliquées sans faille depuis par les divers ministres, qui font semblant d'avoir des initiatives, mais qui, courageusement, s'en sont remis à un quarteron de banquiers européens pour penser à leur place ? Il s'agissait de faire de l'Union européenne "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde", sur le modèle (si !) du système américain, dont on avait alors l'impression qu'il était le plus performant au monde. Quelques illusions ont succombé depuis, au gré des crises (la stratégie de Lisbonne avait été élaborée durant une brève éclaircie économique), mais l'objectif demeure, selon le principe très technocratique selon lequel les choses vont mal parce qu'on n'a pas appliqué les décisions à fond. C'est l'argument des partisans du "collège unique", l'argument des inventeurs des Zep, l'argument de ceux qui aujourd'hui veulent réintégrer dans le flux général les élèves compliqués aujourd'hui pris en charge dans les Segpa. Toute apocalypse molle peut être effectivement remplacée par une apocalypse rapide.
Le libéralisme érigé en totem
Comment un objectif a priori économique a-t-il eu un tel poids sur les politiques scolaires ? C'est qu'il s'agissait d'augmenter "l'employabilité" et le niveau de qualification requis dans "l'économie de la connaissance" (on remarquera que, syntaxiquement, l'expression subordonne la connaissance à l'économie - le diable est dans les détails). Pour cela, l'Union européenne s'est imposée en "catalyseur" des diverses politiques - ou, si l'on préfère, en chef d'orchestre de ce que l'on continuait à faire semblant de décider dans les capitales européennes, mais qui était au final imposé par Bruxelles. Réaliser le retard que la plupart des pays européens avaient pris, par rapport aux États-Unis et à certains pays asiatiques, dans les investissements dans la recherche et l'université n'était pas en soi une mauvaise chose - en période de croissance. En période de crise, on a appliqué les conseils bon marché et on a négligé ceux qui risquaient d'écorner le portefeuille. Le libéralisme, qui pouvait être un moyen, est devenu un totem, alors même qu'il affichait ses limites - parlez-en aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens - et aux Français, qui viennent deux dimanches de suite de donner leur sentiment sur la question.
Les Français d'ailleurs ne s'y étaient pas trompés : ils avaient dit non par référendum à cette Europe qui n'était plus du tout les "États-Unis d'Europe" chers à Victor Hugo, mais un conglomérat d'appétits. Ceux qui, à l'UMP comme au PS, sont passés par-dessus la tête de la volonté populaire ne devront pas s'étonner d'en payer le prix en mai prochain.
Corvéables à merci
Faire passer l'école sous les fourches caudines de "l'employabilité" à tout prix (et si possible à bas prix) a eu des conséquences terribles. Le "socle de compétences" de base, c'est l'Europe - et l'on sait combien le "socle" a réduit comme peau de chagrin les exigences scolaires : miracle, des théories pédagogiques fumeuses sont venues au secours des ambitions politiques. La diffusion chez les élèves de "l'esprit d'entreprise", comme l'a encore récemment rappelé Geneviève Fioraso (qui elle aussi faisait semblant d'être ministre - aux Universités - pendant que les décisions étaient prises ailleurs), au détriment des savoirs fondamentaux et d'une culture humaniste réelle, c'est le protocole de Lisbonne. L'accroissement des coûts personnels des étudiants, pour les responsabiliser et les pousser vers des études "utiles", c'est encore le protocole : et aucun de ces grands argentiers, parce qu'ils n'y connaissent rien, n'a jamais pensé que les études que l'on commence parce qu'elles correspondent aux attentes des "marchés" peuvent cinq ans plus tard se retrouver complètement en porte-à-faux avec l'évolution de ces mêmes marchés. Et que seule une culture générale solide met à l'abri de ce genre d'aléa - cette culture que les cadres supérieurs trouvent dans les grandes écoles, que ce soit l'ENS, Polytechnique ou Oxford, pendant que vulgum pecus, ou si l'on préfère, le gros des élèves et des étudiants, seront si peu et si mal éduqués qu'ils resteront taillables et corvéables à merci.
Je ne suis pas le seul à hurler - parce que la France n'est pas le seul pays laminé par cette politique éducative absurde et inefficace au nom même de l'efficacité. De vrais grands esprits s'y sont opposés de toutes leurs forces - avec parfois un sens de l'invective bien supérieur au mien. En 2009, Arturo Pérez-Reverte, qui est sans doute le plus grand romancier espagnol contemporain, avait poussé un cri de rage que la décence m'empêche de traduire, mais que les lecteurs hispanisants se régaleront à déchiffrer. Il faut le dire et le redire haut et fort : mettre l'école sous la dépendance des marchés n'est pas une bonne idée - les marchés fluctuent, les marchés naviguent à vue, alors que le temps scolaire est long, très long même -, et ce n'est pas même un service à rendre aux marchés. Il faut une formation sérieuse, sans concession aux modes, aux lubies ou aux lobbies, le "tout informatique", dont on sait qu'il n'apporte rien à l'école, sinon des déficits, comme l'apprentissage précoce de l'anglais en primaire, alors même que le Français n'est pas maîtrisé, voilà deux des effets directs de cette "économie de la connaissance" qui a engendré ce que j'appelais et appelle encore la "Fabrique du crétin".
L'enseignement doit être national
Seule une formation humaniste peut construire des jeunes assez cultivés et souples pour s'adapter et survivre en milieu hostile. Si le tigre aux dents de sabre a disparu, c'est qu'il était étroitement spécialisé. Et nous savons depuis Claude Allègre - c'est bien la seule chose intelligente qu'il ait proclamée - que le "mammouth", auquel il a comparé le système scolaire, fut lui aussi victime de disparition précoce. L'enseignement privé, qui monte en flèche, se repaît du cadavre de l'école - et il est plébiscité par des parents qui ont compris, bien mieux que les grands argentiers européens, que des connaissances solides, une discipline sans faille, une transmission des savoirs sont les vraies bases d'une formation heureuse.
Vincent Peillon se retrouve tête de liste aux européennes (dans le Sud-Est). Ma foi, aucune contradiction avec ses fonctions ministérielles : après avoir servi ses maîtres, qu'il le veuille ou non, il part à Bruxelles chercher sa récompense. Je n'ai aucun conseil à donner aux électeurs. Mais nous tous qui voulons une vraie rénovation de l'école, nous nous efforcerons d'être au moins cohérents. L'enseignement doit être national, conçu en fonction des spécificités de chaque pays : c'est encore le meilleur moyen de les mettre en synergie, parce que nous ne sommes riches que de nos différences complémentaires. La "convergence" des systèmes éducatifs, qui nous prive de toute décision dans l'éducation de nos enfants, est un mantra d'une illusion. Et tout le reste est littérature.
Jean-Paul Brighelli (Le Point, 7 avril 2014)