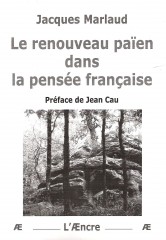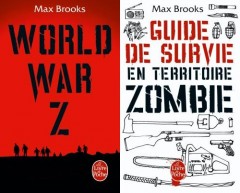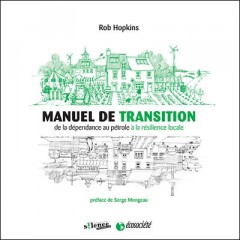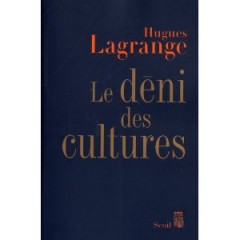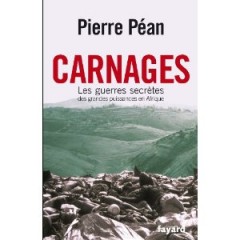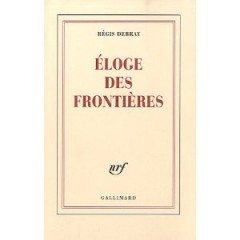La guerre des zombies
La prochaine guerre ne sera ni nucléaire ni conventionnelle.
Et ses motifs ne seront pas politiques. La prochaine guerre sera la guerre des zombies. D'ailleurs, et la disparition complète de l'humanité fut évitée de peu, elle a déjà eu lieu. Tel est du moins le postulat, car World War Z, présenté comme histoire orale, comme document pour l'histoire, vient a posteriori puisque l'auteur, missionné par l'ONU (encore affaiblie après sa quasi-destruction - rien n'échappe aux zombies et surtout pas les organisations mondialisées) de Dachang en Chine à Parnell dans le Tennessee, du Rajasthan à Sydney, du lac Baïkal à Kyoto, a enquêté auprès de divers survivants de toutes origines et professions dont il livre les témoignages. Au travers de points de vue multipliés, qui se recoupent, se complètent, se superposent subtilement et ordonnent donc une polydiégèse des plus fascinantes (des plus brillantes même), l'épidémie - sa propagation apocalyptique, son horreur, les bouleversements géopolitiques, sociaux, économiques qu'elle provoque - est ainsi progressivement renseignée.
Assurément, comme dans toute histoire de zombies, et selon que nous l'ont désormais appris les films de George A. Romero, dont l'auteur, Max Brooks (fils de Mel), est le thuriféraire et l'obligé, il n'y pas là que boucherie gore et viandes plus ou moins avariées. Une critique, une allégorie également, se font jour, du consumérisme et de l'individualisme contemporains, des monades urbaines qui sont connectées à tout mais liées à rien, qui ont remplacé les relations humaines par la communication en réseau, aussi vide que proliférante, et qui errent, sans passé ni avenir, dans l'immédiateté d'un présent perpétuel et l'assouvissement de leurs pulsions.
Retrouvons, semble-t-on nous dire dans World War Z, à peine de nous transformer en zombies, les grands récits collectifs, prescripteurs de durée, de temps et d'histoire: l'humanité n'aura jamais remporté la guerre contre les morts-vivants qu'en retrouvant ses fondations, qu'en se retrouvant elle-même. Une réussite littéraire.
Quant à l'aspect pratique, Max Brooks ne l'omet pas avec Guide de survie en territoire zombie, où l'on trouvera nombre de conseils des plus avisés, tandis que tout est rigoureusement analysé, les avantages comme les inconvénients: armes adéquates (préférez le pied-de-biche, le calibre 22, l'arbalète) et techniques de combat; sécurisation d'un périmètre, lieux offrant la plus efficace défense passive (préférez quais et docks, prisons, étages d'immeubles) ; fuites, déplacements et transport (évitez les zones urbaines, les plaines, préférez les forêts, le vélo, le véhicule blindé) ... En outre, c'est d'importance, le zombie, ses origines, sa nature, ses aptitudes, sont étudiés. Par exemple, le mal est viral, provoqué par le Solanum qui « envahit la circulation sanguine à partir de la blessure initiale et atteint rapidement le cerveau », le virus utilisant les cellules des lobes frontaux pour se multiplier, ce qui les détruit au passage ... Et la durée de vie d'un mort-vivant, « le temps pendant lequel il fonctionne avant de pourrir sur pied", est estimée entre trois et cinq ans. De même, on ne confondra plus - mais la méprise est aisée, il est vrai - le zombie vaudou, qui relève de néfastes pratiques de magie noire, et, donc, le zombie (le vrai) épidémique et infecté. Utile et préventif!
Arnaud Bordes (Eléments n°132, juillet septembre 2009)