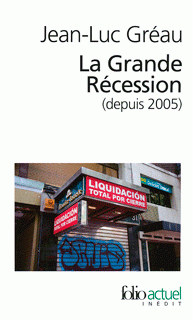Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Claude Bourrinet, cueilli sur Voxnr et consacré à l'affaire de Florange, qui a vu, une nouvelle fois, le gouvernement de gauche renier ses engagements...

Florange : de la gauche caviar à la gauche Judas
La « nationalisation » d’ArcelorMittal a fait long feu. Les hauts fourneaux ne redémarreront pas. Un goût très amer est l’unique résultat d’une comédie dont les prétentions affichées se sont dégonflées comme un ballon de fête électorale. On en a « gros sur le cœur ». Ce n’était donc que cela... La nationalisation, même « temporaire », du site sidérurgique de Florange, n’était, au mieux, qu’un moyen naïf de faire chanter Lakshmi Mittal, qui en a vu d’autres, au pire une tromperie aussi niaise. Les imbroglios insensés qui ont accompagné ce qui est présenté comme un compromis, mais qui n’est en fait qu’un pari, bien fragile au demeurant, porteraient à sourire, tellement le personnage haut en couleur qu’est Montebourg, affublé du titre grotesque de « ministre du redressement productif », s’est époumoné en promesses réduites impitoyablement en poussière par Ayrault. Mais où sont passés les « repreneurs fiables » ? Et que valent ses rodomontades pseudo-révolutionnaires, qui s’en prenaient aux méthodes du patron indien, lesquelles ne devaient pas trouver leur place en France ? Même pas peur ! Du reste, le pauvre Montebourg ne sait plus à quel saint se vouer : la raffinerie Petroplus, par exemple, n’a pas plus de repreneur libyen que de repreneur russe ou chinois pour Florange. Peut-être au fond sa tâche est-elle d’occuper la galerie, pendant que le sale boulot s’effectue hors du théâtre des opérations médiatiques. Par exemple quelque chose qui ressemblerait à la fermeture, malgré son activisme presque sarkozyen, du site d'Aulnay PSA.
Remarquons au passage que la nationalisation, qui est, littéralement, la reprise en main d’une entreprise par la Nation, est une action tout à fait légale, et envisagée par le préambule de la Constitution de 1946. Gageons que ce qui a pu choquer une ultralibérale comme Parisot a été justement cette évocation d’un geste qui heurte les libre-échangistes fanatiques qui nous dominent, plutôt que le poncif du manque de savoir-faire économique de l’Etat. Il aurait fallu plutôt se demander pourquoi un secteur qui concerne, en France, 40 000 personnes, qui produit un acier de très haute qualité, n’a pas été sauvegardé, protégé du dumping de prédateurs comme Lakshmi Mittal, qui a constitué son empire à coups de rachats d'entreprises défaillantes dans les pays émergents et pourquoi, au nom du dogme de la « main invisible », on réserve à l’industrie nationale et européenne les grands coups de poings qui la mettent à terre. Question oratoire, bien sûr... On préfère, dans un cadre mondial, sacrifier notre économie, notre pays, notre terre, au nom des principes. Et quels principes ? Tout le monde sait que Mittal contracte la production d’acier, dans un contexte de crise, pour sauvegarder des prix élevés. Sa démarche est entièrement financière. Une logique préoccupée de garantir des conditions de vie décentes à notre peuple aurait dû se fonder sur un volontarisme industriel, qui n’existe plus en France et en Europe, nonobstant notre ministre du Redressement productif. Que valent les leçons de « réalisme » lorsqu’on verse des milliards d’euros aux banques pour les sauver, et qu’on est soumis aux intérêts financiers transnationaux, voraces et cyniques ? Les dépenses occasionnées par des mesures d’ampleur, ambitieuses et véritablement soucieuses de notre intérêt, coûteraient bien moins cher que cette lente agonie qui nous ravale irrésistiblement au niveau de pays pauvre, désindustrialisé et dépouillé par les marchands apatrides. Nationaliser Florange, par exemple, exigeait 450 millions d'euros, mais n’oublions pas qu’après avoir été nationalisée, puis revendue, Alstom, qu’on donnait pour obsolète, lui a permis d'encaisser 1,6 milliard d'euros.
Autre source d’embrouille et d’enfumage : la solution alternative est loin de rassurer. Le projet européen «Ulcos» n’a d’ailleurs pas été mentionné dans le communiqué final. Du reste, il a la réputation d’être peu rentable et grevé d’incertitudes techniques et financière. Un avenir fondé sur du sable, en quelque sorte... «Il n'y aura pas de plan social à Florange. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions dans les cinq prochaines années» affirme Ayrault. Cinq ans, c’est long... Quant au « plan social », qui peut garantir que ce n’est pas partie remise ?
Toutefois, la seule question qui vaille la peine d’être posée est de savoir si la décision du gouvernement Ayrault sera aussi dévastatrice politiquement que celle de Jospin, en 1999, qui avouait, du ton technocratique qu’on lui connaît, qu’il ne pouvait rien faire, après des licenciements boursiers provoqués par Michelin. Décidément, la gauche s’est pliée à la logique libérale mondialiste, et ce ne sont pas les couinements de la patronne Parisot qui nous feront croire le contraire. En vérité, l’hypothèse de la nationalisation, outre qu’elle avait été envisagée par Sarkozy, qui s’y connaît pourtant lui aussi en matière d’enfumage, pour ce même ArcélorMittal, a été appuyée par une grande partie des responsables politiques, nationaux et locaux, de droite comme de gauche, adhésion qui ne plaide pas pour le caractère révolutionnaire d’une telle mesure. Il faut croire que, dans le jeu de dupe qu’est devenue la pratique politicienne contemporaine, on s’évertue à parodier les signes du combat ancien, où les affrontements idéologiques pesaient encore, et que cette agitation de pantins télévisuels, qui remuent leur verbe avec les accents faux d’une rhétorique surannée, ne vise qu’à préparer les trahisons futures, qui nous présenteront le dilemme entre un libéralisme mondialiste soft, contre un libéralisme mondialiste hard. Tant les mots sont plus importants que l’on ne croie pour faire avaler les choses.
Il est en tout cas certain que les 2 700 employés de Florange sont insignifiants par rapport aux 260 000 salariés du groupe, et surtout par rapport aux quelque 50 000 chômeurs qui, en ces temps de crise, restent, en France, chaque mois sur le carreau. Leur poids est symbolique, comme l’est le mot « nationalisation », qui renvoie à une France jadis industrialisée, dont le secteur sidérurgique, sans parler des autres, était florissant, où la classe ouvrière était fière, digne, orgueilleuse et combative, et, pour tout dire, quand la France était encore la France.
Le temps est donc au « réalisme », vertu que l’on brandit volontiers pour se donner un air d’honnête gestionnaire, et l’on ne prend même plus la peine d’user de ces feux d’artifices lyriques, qui faisaient frissonner la Mutualité. La chair est triste, hélas !, et je ne prends même plus la peine de lire tous les programmes, tellement ils se ressemblent et s’alignent platement sur les prétendues nécessités de l’économie mondiale.
Il est clair que Hollande a « écouté », dans l’affaire, Michel Sapin et Pierre Moscovici, plus sensibles à « l'image de la France » auprès des investisseurs étrangers qu’à la détresse des ouvriers français. La bourse vaut bien une fermeture. Le capitalisme prospère sur les cadavres économiques. Il n’est qu’à mesurer la hausse des cours boursiers quand des licenciements sont annoncés dans un secteur. « Say Oui to France » - certainement pas à la France des travailleurs !
Les économistes ont toujours d’excellentes raisons pour justifier les capitulations. On peut même dire que les brigades de « spécialistes », dont le nombre ne semble pas très rentable en matière de prévisions, si l’on prend la peine de rassembler toutes les erreurs d’analyse et de prédiction qui ont ridiculisé la profession depuis des lustres, occupent et saturent petit écran, grandes ondes et torchons baveux, et qu’ils n’ont jamais assez de mots pour assurer qu’en matière de rêve, c’est assez. Un jour, il faudra se pencher sur la condition de ces plumitifs qui prospèrent à Science Po, dans des fondations grassement subventionnées par des multinationales, et sur les petites chaises qui serrent de près les arrière trains de ces princes qui nous gouvernent. Ces tristes sires ont pour sale besogne de faire accepter l’inévitable, ou considéré comme tel, et de prôner la résignation.
La réalité économique que ces messieurs de la moulinette à Phynance est pour le coup assez peu ragoûtante, car on a eu souvent affaire, ces dix dernières années, à des licenciements boursiers, qui visaient à accroître les dividendes des actionnaires, en contractant la masse salariale. Danone, Lu, Michelin, Mark&Spencer, Hewlett-Packard, Moulinex, Aventis, Valeo et d’autres sont restées dans les mémoires.
La gauche n’a jamais essayé d’empêcher ces dérives. Du moins, comme pour le cas Danone, a-t-elle fait mine de prendre des mesures qui se sont révélées impuissantes. Car depuis le tournant de la « rigueur », que l’inénarrable et ex-stalinien Yves Montand avait bénie de sa gouaille d’histrion, en 1983, elle n’a de cesse que de prouver son « sérieux », c’est-à-dire, in fine, sa collusion avec la finance internationale, que Hollande, quand il était candidat, a rassuré, dans la patrie de la banque, en Grande Bretagne, en avouant que ses quelques piques contre elle était de la rigolade électoraliste. Avec Fabius et Bérégovoy, le mot d’ordre avait été la « réconciliation avec le monde de l’entreprise », en clair avec le fric, ce que les champions de la gauche caviar ont bien compris. On ne jura alors que par la concurrence, les privatisations, les baisses d’impôts, les déréglementations.
Rappelons les exploits d’une gauche qui a le culot de s’appeler encore « socialiste » (« Je n’aime pas les socialistes, parce qu’ils ne sont pas socialistes », disait déjà De Gaulle) : gouvernement Rocard : Crédit local de France, 5 avril 1991, privatisation partielle ; Renault, 1990, ouverture du capital ; gouvernement Jospin : Air France, 1999, ouverture du capital ; Autoroutes du sud de la France (privatisation partielle), mars 2002 : mise en bourse de 49 % du capital, recette : 1,8 milliard d'euros ; Crédit lyonnais , 12 mars 1999 (décret) ; France Télécom, 1997, ouverture du capital, 42 milliards de FF ; Octobre 1997 : mise en bourse de 21 % du capital ; Novembre 1998 : mise en bourse de 13 % du capital ; Framet, 1999; GAN, 1998; Thomson Multimedia ; 1998, ouverture du capital ; 2000, suite ; CIC, 1998; CNP, 1998; Aérospatioale (EADS), 2000, ouverture du capital.
Si Jean-Marie Le Pen n’avait pas été là en 2002, rien ne les empêchait de continuer sur cette lancée. La droite l'a fait pour eux.
Comment maintenant le gourvernement actuel va-t-il réagir quand des « plans sociaux » seront annoncés à Renault, SFR, Aetos ; aux Charcuteries Alsaciennes Iller , aux Rillettes Sarthoise Boussard, à la Société Générale, à Coca Cola, à l'AFPA (association nationale pour la formation professionnelle des adultes), à GOL, aux quotidiens régionaux La Provence, Nice Matin, Var matin et Corse Matin sont en vente, à la chaîne télé régionale TLM (Lyon), etc. ?
Les cadavres risquent de ne pas loger dans le placard !Claude Bourrinet (Voxnr, 2 décembre 2012)