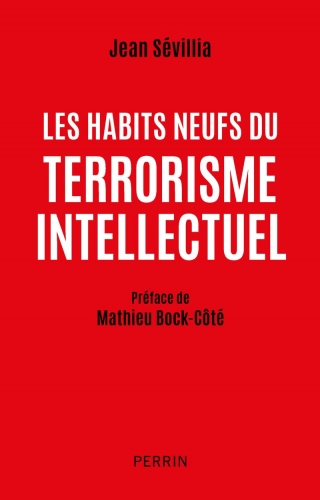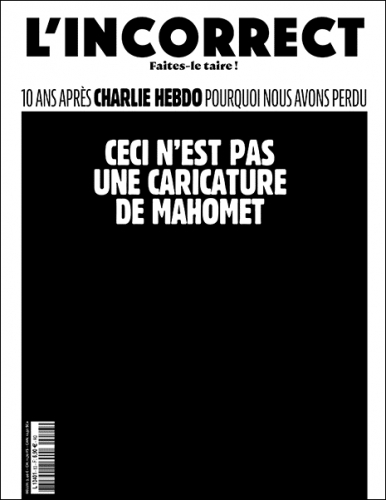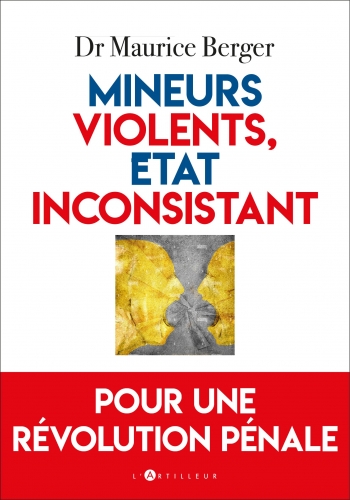Désoccidentaliser l’Europe
Au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1922, parut en Allemagne le second volume d’un livre à la destinée particulière, et à la postérité paradoxale : Le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler. Un siècle plus tard, en 2022, Michel Onfray intitulait « Fin de l’Occident ? » un numéro spécial de sa revue Front populaire, alors qu’Emmanuel Todd publiait en 2023 La Défaite de l’Occident. Le mot d’Occident est aujourd’hui plus que jamais dans toutes les bouches, accusant les accents dramatiques d’une fin de règne. Pourtant, sa signification a subi des revirements considérables.
Ce qui a longtemps été l’acception commune de l’Occident, c’est ce qu’outre-Rhin, on appelle Abendland, le pays du couchant. Le terme porte en lui toute la charge romantique d’un temps où le monde était divisé en deux moitiés — l’Occident chrétien d’une part, héritier de l’Empire romain du même nom, l’Orient d’autre part, qui commençait à Byzance et s’étendait dans un continent asiatique encore mal connu. Cependant, cet Occident s’est peu à peu effacé au profit de l’idée d’Europe avec l’entrée dans la modernité, à la Renaissance. C’était l’âge des grandes découvertes, le début du nomos de la terre, pour parler avec Carl Schmitt. Dès lors, les Européens se sont définis non plus par rapport à un axe est-ouest, mais par rapport à un territoire : le continent européen dans sa confrontation avec le reste du monde. Ce n’est qu’au cours du XXe siècle, et singulièrement dans le face-à-face des grands blocs durant la guerre froide que le terme d’Occident a été remobilisé pour désigner une réalité aux implications toutes différentes : le grand Ouest, the Western World.
Pour autant, et malgré cette rupture qui est à bien des égards pour l’Europe le synonyme d’une dépossession, la mobilisation de l’Occident comme notion de référence persiste, tout particulièrement auprès de ceux qui se veulent les défenseurs de l’identité européenne. Cet Occident n’est plus véritablement chrétien, et il prend de plus en plus les traits d’un « monde blanc » — une projection qui, au vu de la réalité ethnique de la société américaine, par exemple, pose évidemment des questions. La résurgence du terme suggère néanmoins l’idée qu’Occidentaux, Européens et « Blancs » sont unis dans leurs modes de vie et dans leurs relations avec le reste du monde du fait d’une matrice culturelle commune. L’entrée des troupes russes en Ukraine en 2022 ou de l’attaque d’Israël par le Hamas en 2023 ont encore favorisé la revendication du vocable, transposant ainsi un désir de reconnaissance identitaire dans le domaine des réalités géostratégiques. Son invocation semble d’abord avoir une valeur performative — on espère quelque chose de cet ensemble d’appartenance, on se cherche des alliés, voire des frères, au moment où les confrontations communautaires se font de plus en plus vives. Et comment, après tout, ne pas le comprendre ? Dans ce contexte, au regard de la situation géopolitique du XXIe siècle plus encore qu’avant l’effondrement du rideau de fer, il nous semble néanmoins que soutenir l’attachement de l’Europe à « bannière occidentale » relève d’une erreur historique fondamentale.
Elle se fonde sur l’idée fallacieuse selon laquelle l’Occident pourrait aujourd’hui fournir l’occasion de fonder un nouvel équilibre géopolitique, en s’appuyant exclusivement sur la solidarité entre populations d’origine européenne, dont la « dispersion » est le résultat d’aventures coloniales anciennes. Cette opportunité offrirait des perspectives de salut inattendues, grâce au soutien d’une « diaspora européenne » homogène et bienveillante, répartie pour l’essentiel en Amérique du Nord, dans certains pays d’Amérique du Sud, en Afrique du Sud, ainsi qu’en Israël, et confrontée à des défis démographiques et des menaces civilisationnelles similaires à ceux qu’affrontent aujourd’hui les Européens. S’il est manifeste que des convergences se font jour en vertu de ces racines communes, et s’il est éminemment souhaitable que ces convergences aboutissent à des synergies fructueuses, rappelons néanmoins que la réalité des logiques géopolitiques propres à chaque continent est susceptible de compromettre considérablement, à terme, ces perspectives de cohésion. À moins qu’on ne se contente ici de simples discours susceptibles de légitimer ponctuellement la coïncidence des intérêts particuliers et de la générosité du cœur.
Pourquoi alors ces racines communes ne priment-elles pas ? La plupart des nations « occidentales » situées sur d’autres continents sont issues d’un mouvement de colonisation ayant amené des populations originaires d’Europe à s’installer durablement au-delà des mers pour exploiter des terres qui semblaient à leurs yeux peu mises en valeur jusqu’alors, selon un processus comparable à celui qui conduisit sous l’Antiquité à la fondation de cités grecques sur le pourtour méditerranéen ou à l’expansion territoriale de l’Empire romain. Mais les nations anglo-saxonnes fondées jadis par des colons européens, à l’image des colonies grecques qui ont peu à peu échappé à la koinè qui les unissait à leur cité mère, se sont depuis longtemps émancipées de la tutelle du Vieux Monde, pour poursuivre légitimement la satisfaction de leurs intérêts propres, sur un territoire neuf permettant de démultiplier les possibles.
Les États-Unis, auxquels on a d’abord tendance à se référer lorsqu’il est question de l’ensemble occidental, n’ont jamais cessé de revendiquer une « destinée manifeste », justifiant ainsi leur profonde rupture avec la tradition européenne, même si les élites américaines et anglaises ont continué de tisser depuis deux siècles des liens personnels et familiaux étroits. Cette rupture procède de l’idéologie des « pères pèlerins », du rêve messianique des communautés fondamentalistes protestantes qui quittèrent l’Europe pour vivre dans une société purifiée de la corruption du « vieux monde », aristocratique et monarchique. En dépit de références récurrentes à l’Antiquité grecque ou romaine, permettant de revendiquer, de manière plus ou moins légitime, l’héritage de la démocratie athénienne et celui de la mission « civilisatrice » de l’Empire romain, la « ville sur la colline » s’est dès ses débuts pensée comme une refondation de Jérusalem, pour laquelle le long détour historique par l’Europe n’avait plus guère de signification. Par ailleurs, l’histoire de l’Amérique s’est fondée sur un épisode anomique en rupture volontaire et totale avec les institutions alors en place en Europe : c’est le Far West, en tant que système d’organisation de la conquête territoriale et du peuplement, puis la guerre de Sécession qui ont servi d’acte fondateur à un Nouveau Monde et qui en constituent aujourd’hui encore la mythologie dans l’imaginaire collectif américain.
Il en ressort qu’à bien des égards, la seule acception valable d’une « civilisation occidentale » est celle d’un canon de valeurs qui s’est diffusé de manière à peu près uniforme à la fin du XVIIIe siècle, par la cristallisation de ce que les historiens ont pu qualifier de « révolutions atlantiques », et dont les exemples américains puis français ne sont que les plus emblématiques. Un corpus philosophique projetant la fondation ex nihilo d’une société meilleure et d’un homme nouveau a ainsi pu emprunter les réseaux de puissance établis dans ce qui était alors encore la sphère d’influence de l’Europe triomphante. Les principes de liberté et d’émancipation individuelles, de démocratie, d’égalité devant la loi et de progrès devaient servir de socle à pères fondateurs des États-Unis, tandis qu’en Europe ils se manifestèrent comme le produit tardif d’une civilisation qui possédait sa dynamique propre, orientée par des traditions vives qui en avaient tracé la trame de fond, génératrice de structures politiques et sociales éprouvées par les siècles. Là encore, il s’agit donc d’un paradigme ancré dans le temps, et qui, justement parce que les Américains ont pu se délester du poids de l’héritage civilisationnel européen, a trouvé son expression dans des formes tout à fait différentes de part et d’autre de l’Atlantique.
Ainsi, le rapprochement institutionnel de l’Amérique du Nord et de l’Europe sur fond d’adhésion commune aux valeurs de la démocratie libérale doit précisément être compris comme le symptôme d’une asymétrie des rapports de dépendance, voire de domination. Il s’est réalisé au profit de la « colonie », au détriment des nations européennes d’origine. Au cours des Trente Glorieuses et la Guerre froide, profitant de l’affaiblissement des puissances européennes dans le cataclysme des guerres mondiales, c’est bien le Soft power des États-Unis qui a permis à la puissance américaine de se prémunir contre une potentielle récession de son influence en consolidant sa domination culturelle, idéologique, économique et militaire sur l’ensemble du territoire européen dit « occidental ». En d’autres termes, si l’Amérique du Nord n’a jamais été pensée par ses fondateurs comme une colonie européenne, c’est l’Europe qui aujourd’hui, sous de nombreux aspects, est bel et bien spirituellement colonisée par les États-Unis, dont la stratégie d’expansion impériale porte de fait le nom d’Occident.
Les nations et les peuples européens se voient aujourd’hui plongés dans une grande recomposition des équilibres géopolitiques. Ce contexte risqué pour les États d’Europe, à plus forte raison après l’élection de Donald Trump en novembre 2024, confronte désormais ses dirigeants au défi considérable du retour à la puissance. Et ce défi ne pourra être relevé qu’au prix d’une désoccidentalisation de l’intérieur, d’un dépassement d’un ordre orienté par l’idéal illusoire des démocraties libérales. C’est dans sa tradition politique la plus pérenne qu’elle trouvera les ressources nécessaires pour insuffler une dynamique nouvelle à son destin civilisationnel, à la hauteur des enjeux à venir.
Walter Aubrig et Olivier Eichenlaub (Institut Iliade, 6 janvier 2025)