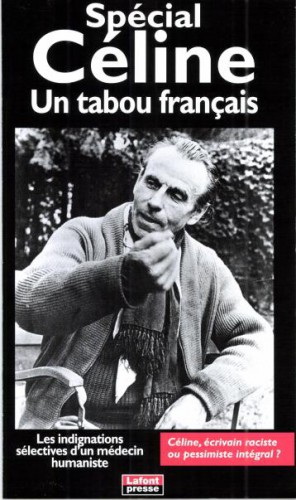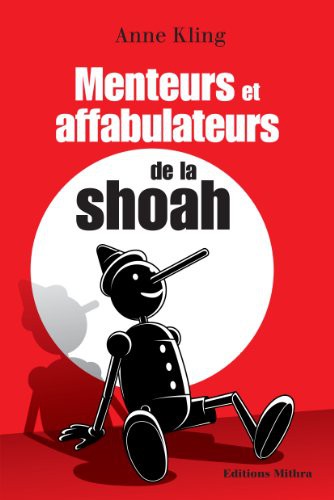Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Alain de Benoist à Nicolas Gauthier et publié sur Boulevard Voltaire. Alain de Benoist y évoque la solidarité, les valeurs et le totalitarisme...

Solidarité sans solidarités ? Celle dont tous les médias parlent, mais qui autorise aussi à attendre deux mois avant de s’apercevoir que la voisine d’à côté est en train de pourrir sur son lit…
C’est que le terme a changé de sens. Les solidarités anciennes étaient des solidarités organiques, qui s’exerçaient avant tout dans un cadre familial et communautaire élargi. Elles se fondaient donc sur la proximité, et aussi sur la réciprocité. Elles relevaient de la logique traditionnelle du don et du contre-don, dont on sait depuis Marcel Mauss que la règle tenait dans un triple impératif de donner, de recevoir et de rendre. La montée de l’individualisme libéral, liée à l’ascension d’une philosophie des Lumières désireuse de faire du passé table rase (en fonction du principe traditions = superstitions), a entraîné la désagrégation progressive des solidarités organiques. C’est ce qui explique la mise en place de l’État-providence, seule structure capable de limiter les dégâts.
Parallèlement, l’échange marchand s’est substitué au système du don. La « solidarité » est désormais affaire d’opérations relevant du spectacle, comme le Téléthon, ou d’une propagande pour des causes lointaines, c’est-à-dire d’un discours où la langue est mise à disposition sur un mode tout à la fois instrumental et lacrymal. La réciprocité, enfin, tend d’autant plus à s’effacer qu’elle implique entre les auteurs et les bénéficiaires d’un acte de solidarité la claire perception d’une ressemblance, d’une parenté fondée sur des valeurs partagées, qui tend elle-même à disparaître. Pour l’automobiliste, l’autre homme, pris comme passant, n’est qu’un obstacle à la circulation. Pour la forme-capital, les cultures ne sont qu’un obstacle à l’expansion perpétuelle du marché.
Valeurs sans valeurs ? Comment vilipender en même temps l’« ordre moral » et invoquer les « valeurs morales » à toutes occasions, tel Michel Noir, qui écrivait dans Le Monde qu’« il préférait perdre les élections plutôt que son âme » ?
Cela nous a au moins appris qu’il avait une âme (ou qu’il croyait en avoir une), ce qui n’était pas évident. Les « valeurs morales » dont on nous rebat les oreilles sont à la mesure des « autorités morales » que sont censés être, par exemple, les membres des comités de réflexion en matière de bio-éthique. Leur autorité est en réalité parfaitement nulle, non seulement parce que la recherche scientifique se développe selon une logique intrinsèque qui rend sa « moralisation » aussi improbable que celle du marché, mais parce que leurs opinions n’ont jamais que la valeur de la philosophie, de l’idéologie ou de la religion dont ils se réclament, auxquelles nul n’est évidemment tenu d’adhérer.
Ce qui est plus intéressant, c’est de constater comment le moralisme (Nietzsche aurait dit la « moraline ») a remplacé la morale. On pensait autrefois que la société se portait d’autant mieux que les individus s’y comportaient bien. Aujourd’hui, la permissivité gouverne les comportements individuels, mais on ne cesse de répéter que la société doit être toujours plus juste. De ce point de vue, on pourrait également dire que la morale a remplacé l’éthique. Le grand débat qui, en matière de philosophie politique, s’est instauré à partir de 1980 autour des thèses de John Rawls, le plus célèbre sans doute des refondateurs de la social-démocratie contemporaine, opposait ceux qui, comme Rawls lui-même, soutenaient la priorité du « juste » sur le « bien », et ceux qui défendaient au contraire la priorité du « bien » sur le « juste ». Ces deux perspectives sont incompatibles. La première renvoie à Kant, la seconde à Aristote. Ceux qui se réfèrent aux « valeurs morales » dont vous parlez sont des kantiens, conscients ou inconscients. C’est ce qui explique la vogue de l’idéologie des droits de l’homme, par opposition à la pensée du bien commun.
Totalitarisme sans objet ? Pour un Bernard Antony, l’islam serait un nouveau « totalitarisme ». Pour un Alain Finkielkraut, c’est l’antiracisme qui serait lui aussi un nouveau « totalitarisme ». À force de mettre ce mot à toutes les sauces, la soupe n’aurait-elle pas tendance à devenir de plus en plus fade ?
C’est un risque, en effet. À voir du « totalitarisme » partout, on risque de banaliser le concept, et donc de ne plus très bien savoir ce que c’est. La plupart des politologues qui, à partir des travaux fondateurs de Waldemar Gurian, Carl Joachim Friedrich et Hannah Arendt, ont étudié les deux grands systèmes totalitaires du XXe siècle, le national-socialisme hitlérien et le système soviétique, ont en général défini le totalitarisme par son recours à un certain nombre de moyens : parti unique, mobilisation des foules, contrôle absolu des médias, déportations et massacres de masse, élimination physique des opposants, monopole idéologique, invasion de la vie privée, etc. Cette définition a permis de distinguer les régimes totalitaires des régimes autoritaires ou simplement dictatoriaux, distinction qu’a très bien explorée le politologue espagnol Juan Linz.
Mais cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi ces régimes ont recouru à de tels moyens, et surtout dans quel but. Or, si l’on définit le totalitarisme, non par ses moyens, mais par ses buts, on constate vite que ceux-ci se résument à un désir de faire disparaître toute diversité politique et sociale, de façon à faire émerger un type d’homme « conforme » qui soit partout le même. Le fond de la pulsion totalitaire, c’est une aspiration à l’homogène – à l’Unique. De ce point de vue, il ne me paraît pas excessif de parler de « tendance totalitaire » pour décrire la façon dont se met en place aujourd’hui, par des moyens évidemment tout différents, une société de surveillance totale régie par la pensée unique. George Orwell est sans doute l’un des premiers à avoir compris qu’il est désormais possible de parvenir en douceur à des buts qu’on ne pouvait atteindre que par la violence autrefois…
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 9 août 2013)