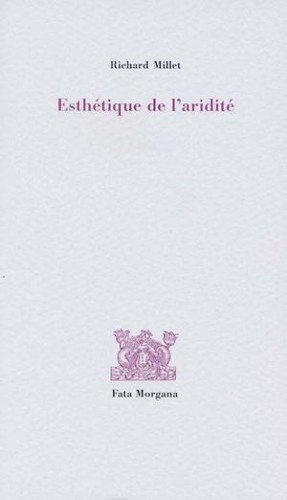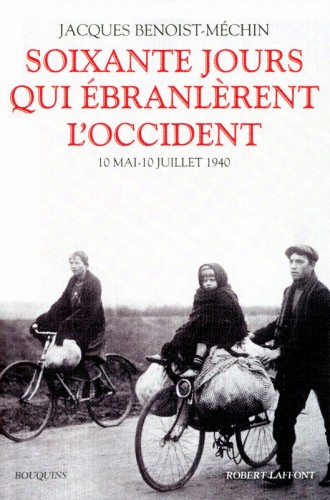De la droite introuvable à la droite inavouable
La publication, le 16 octobre, d’un sondage BVA nous apprenait que 66% des sympathisants de l’UMP souhaitaient voir François Fillon diriger l’UMP contre 33% qui lui préféreraient Jean-François Copé. La belle affaire ! Cette fausse querelle entre deux apparatchiks interchangeables accuse la vacuité des idées d’une droite qui ne veut pas s’avouer comme telle, parce qu’elle ne s’est tout simplement jamais trouvée.
Historiquement, la droite doit davantage son existence au camp d’en face. Plus exactement, la droite occupe tragiquement la place laissée vacante par la mort du roi en 1793, la gauche préemptant la cause du peuple. Force est d’admettre que le clivage droite/gauche constitue la référence réflexe qui conditionne le positionnement des individus/électeurs dans la cité. Ce fait sociologique et psychologique condamne d’emblée le « ni droite/ni gauche », défendu, notamment, par le Front national, tout en demeurant, paradoxalement, le grand malentendu de la droite.
Son caractère introuvable aujourd’hui est probablement dû à son absence d’épine dorsale. Au XIXe siècle, entre 1871 et 1938, celle-ci pouvait s’adosser aux deux piliers primordiaux de la société, l’Église et l’Armée, rendant ainsi inutile toute édification d’un corpus doctrinal. La droite s’est bâtie a posteriori, sur un certain nombre d’attitudes face à ces deux institutions qui lui ont conféré sa substance, mais aussi en récupérant des thématiques laissées en déshérence par la gauche, condamnant la droite à « finir les restes », à se comporter comme une poubelle de table idéologique.
La condamnation pontificale du quotidien de L’Action française, en 1926, laissera des traces profondes dans le code génétique de la droite hexagonale. Si, pour la première fois, depuis Joseph de Maistre (providentialisme) et Maurice Barrès (culte du Moi), un courant de la droite se dotait d’un corpus doctrinal d’envergure — grâce à Charles Maurras —, son soutien historique lui faisait défaut ou, à tout le moins, n’était plus aussi inconditionnel qu’auparavant (déjà, en août 1910, les thèses du Sillon, organe d’un catholicisme social, feront l’objet d’une désapprobation du Pape Pie X).
Entamant son chemin de Damas, au lendemain de la Libération, la droite sera, dès lors, en butte à la propagande « résistantialo-gaullo-communiste » qui achèvera de la discréditer, en en faisant l’exutoire commode et opportun des pires turpitudes et infamies d’une gauche largement compromise dans la Collaboration (même s’il y eut d’authentiques collaborationnistes au sein de la droite littéraire). Même la parenthèse gaullienne échouera à redonner ses lettres de noblesse à une droite de plus en plus nostalgique qui s’épuisait, vaillamment mais tragiquement, dans la défense d’un Empire français sénescent. En outre, la judéophobie récupérée à la gauche durant l’Affaire Dreyfus constituera une encombrante tunique de Nessus pour la droite.
Ayant lu Gramsci, la gauche culturelle préparera l’avènement de la gauche électorale. Démonétisée doctrinalement, la gauche mettra de côté ses pères fondateurs (Leroux, Owen, Blanc, Sorel, Berth, Proudhon, Fourier, Bakounine), adaptera ses concepts (à commencer par celui de « socialisme » qui verra son glissement sémantique vers la « gauche ») et manifestera un attachement dogmatique, quasi-biblique, à la métaphysique du Progrès. La droite, en perdition idéologique, se fera peu à peu mithridatiser par le progressisme de la gauche, cœur atomique de l’individualisme libéral des Lumières, comme l’a brillamment montré Jean-Claude Michéa. Les deux versants culturels et économiques du libéralisme ont été respectivement investis par la gauche et la droite, au point, observe Michéa, que « le clivage droite/gauche (…), clé politique ultime des progrès constants de l’ordre capitaliste, permet (…) de placer en permanence les classes populaires devant une alternative impossible » (L’empire du moindre mal, Flammarion 2010). Dans sa crainte d’être prise en flagrant délit de « ringardisme » par une gauche convaincue de sa supériorité morale, la droite se lancera dans une surenchère permanente sur des sujets tels que le « mariage » homosexuel, le fédéralisme européen, l’antiracisme (tout à la fois « diversitaire » et métissé, l’oxymore, comme le ridicule en ce domaine, ne tuant plus), etc.
Mais pour ne pas perdre pied politiquement, la droite se verra contrainte de faire écho aux angoisses et inquiétudes existentielles légitimes de son électorat en pillant éhontément le programme d’un FN qu’elle s’échine, nonobstant, à diaboliser tout en en blanchissant les idées sous le harnais d’un républicanisme vertueux. Las. Car, derrière une telle fébrilité de circonstance, pas l’once d’une idée, c’est-à-dire d’une critique ou d’une analyse radicale et métapolitique de la société.
Quand la droite osera-t-elle, enfin, le solidarisme, l’antilibéralisme, le subsidiarisme, l’ethno-différencialisme, la décroissance, l’anti-égalitarisme, l’anti-technicisme, etc. ? A coup sûr, cela supposerait qu’elle rompe avec l’anti-intellectualisme lequel, a-t-elle toujours pensé à tort, la démarquait de la gauche. Avant de conquérir le pouvoir politique, la droite doit nécessairement conquérir les esprits, non plus avec Jacques Séguéla et Thierry Saussez, mais avec Jacques Ellul, Jean-Claude Michéa, Christopher Lasch, Antonio Gramsci, Aristote, Carl Schmitt, Michel Villey, Karl Marx, Rousseau, Althusius, Charles Maurras, Emmanuel Todd, Jules Monnerot, Alain de Benoist, et d’autres non moins innombrables et précieux, non pour les copier mais pour les éprouver dans une praxis.
Aristide Leucate (Boulevard Voltaire, 23 octobre 2012)