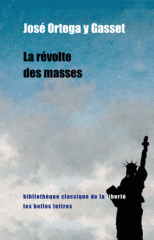Nous reproduisons ci-dessous un extrait d'un long texte d'Arnaud Imatz, "Charles De Gaulle, mythifié mais trahi", publié sur le site du Cercle Aristote à l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de l'Appel du 18 juin et du cinquantième anniversaire de la mort de son auteur. Fonctionnaire international à l’O.C.D.E. puis administrateur d’entreprise, spécialiste de l'Espagne, Arnaud Imatz a notamment publié La Guerre d’Espagne revisitée (Economica, 1993), Par delà droite et gauche (Godefroy de Bouillon, 1996), José Antonio et la Phalange Espagnole (Godefroy de Bouillon, 2000) et Droite - Gauche : pour sortir de l'équivoque (Pierre-Guillaume de Roux, 2016).

Quelques réflexions sur la pensée gaullienne
Au centre de la pensée gaullienne, il y a la volonté de réconcilier l’idée nationale et la justice sociale. De Gaulle sait qu’on ne peut assurer la liberté, la justice sociale et le bien public sans défendre simultanément la souveraineté et l’indépendance nationale (politique, économique et culturelle). Passion pour la grandeur de la nation, aspiration à l’unité nationale, éloge de l’héritage de l’Europe chrétienne, revendication de l’Europe de Brest à Vladivostok, résistance contre toute domination étrangère (américaine ou soviétique), non-alignement sur le plan international, démocratie directe (suffrage universel et référendum populaire), antiparlementarisme, troisième voie ni capitaliste, ni collectiviste, planification indicative, « ordolibéralisme », association capital-travail ou participation, immigration sélective et préférence nationale, sont les grandes lignes de force du gaullisme.
Les nombreux liens que de Gaulle a noués au cours des années trente avec divers milieux politico-intellectuels ont contribué à la formation du tercérisme gaulliste. De par ses racines familiales, de Gaulle a très tôt reçu l’empreinte du double catholicisme social (celui des traditionalistes, tels Armand de Melun, Albert de Mun, René de la Tour du Pin et celui des libéraux, tels Ozanam et Lammenais). Il a également lu Maurras dans les années 1910, comme bon nombre d’officiers de sa génération ; son père était d’ailleurs abonné à l’Action Française. Mais s’il se reconnait dans la primauté de la politique étrangère, la vision traditionnelle de la lutte des États, l’indifférence aux idéologies qui passent alors que les nations demeurent, l’antiparlementarisme, l’État fort et l’exaltation de l’indépendance nationale, que le « maître de Martigues » proclame, de Gaulle récuse le nationalisme intégral et notamment l’antisémitisme d’État, lui préférant la philosophie de Bergson, la mystique de l’idée républicaine de Péguy et le nationalisme de Barrès (l’auteur de Les diverses familles spirituelles de la France). Comme Barrès, il défend l’idée d’une histoire nationale unitaire qui inclut l’Ancien régime et la Révolution de 1789, dans laquelle la République est un fait acquis. Abonné aux Cahiers de la Quinzaine, avant le premier conflit mondial, de Gaulle revendique expressément Péguy au nombre des ses maîtres. N’oublions pas non plus l’un de ses auteurs de prédilection Châteaubriant, qu’il lira et relira durant toute sa vie.
Dans les années 1930, de Gaulle fréquente le salon littéraire de Daniel Halévy, historien et essayiste, grand connaisseur de Proudhon (anarchiste), Sorel (syndicaliste-révolutionnaire) et Péguy (catholique nationaliste). Il participe également aux réunions du cercle d’un vieux militaire à la retraite, dreyfusard et anticonformiste, le colonel Émile Mayer. Proche de la gauche socialiste, Mayer lui fait rencontrer, outre son futur ami l’avocat Jean Auburtin, plusieurs hommes politiques, tels Paul Reynaud, Joseph Paul-Boncour, Marcel Déat, Édouard Frédéric-Dupont, Camille Chautemps, Alexandre Millerand ou Léon Blum. C’est grâce au colonel Mayer qu’il entre en contact avec Daniel-Rops (Henry Petiot). Ces nouvelles connaissances lui permettront de donner davantage d’écho à ses écrits militaires.
De Gaulle participe aussi aux réunions et aux colloques de la Ligue de la Jeune République, résurgence politique, après sa condamnation par Pie IX, du Sillon, le mouvement catholique progressiste de Marc Sangnier. En 1933, il contribue aux débats organisés par L’Aube, journal proche de la CFTC, qui sera dirigé un peu plus tard par Georges Bidault. En 1934, il s’abonne à la revue Sept, créée par les dominicains, puis, en 1937, à l’hebdomadaire qui lui succède Temps présent en même temps qu’il adhère aux Amis de Temps présent. Ouvertement catholiques, ces deux revues et ce cercle se situent politiquement au centre gauche. Enfin, et surtout, facteur décisif dans la formation du Général, sans doute bien plus important que ses contacts avec les représentants de la démocratie chrétienne, Charles de Gaulle fréquente les membres d’Ordre Nouveau. Il participe régulièrement aux réunions de l’O.N. groupe de réflexion personnaliste qui, avec la Jeune droite et la revue Esprit, constitue l’un des trois grands courants des « non-conformistes des années trente ».
Créé par Alexandre Marc-Lipiansky, Arnaud Dandieu et Robert Aron, l’Ordre Nouveau publie, de mai 1933 à septembre 1938, une revue éponyme, qui se réclame d’une troisième voie sociale, qui se veut anti-individualiste et anti-collectiviste, anticapitaliste et anticommuniste, antiparlementaire et antifasciste, anti-belliciste et anti-pacifiste, patriote mais non nationaliste, traditionaliste mais non conservatrice, réaliste mais non opportuniste, socialiste mais non matérialiste, personnaliste mais non anarchiste, enfin, humaine mais non humanitariste [1]. Dans le domaine économique, il s’agit de subordonner la production à la consommation. L’économie telle qu’elle est conçue par les rédacteurs de la revue Ordre Nouveau doit comprendre à la fois un secteur libre et un secteur soumis à la planification. « Le travail n’est pas une fin en soi ». La démarche « ni de droite, ni de gauche » de la revue et du groupe se fixe comme objectif de mettre les institutions au service de la personnalité, de subordonner à l’homme un État fort et limité, moderne et technicien.
On retrouve dans ce « non-conformisme des années trente », comme dans la pensée sociale chrétienne, trois thèmes fondamentaux chers à de Gaulle : le primat de l’homme, le refus de l’uniformisation, et le souci du respect de l’individualité dans la collectivité ; ce qui sous-entend, bien sûr, une place importante faite au principe de subsidiarité. Dans un intéressant article du Figaro « De Gaulle à la lumière de l’Histoire » (4-5 septembre 1982), l’historien gaulliste et protestant, Pierre Chaunu, avait attiré mon attention, pour la première fois, sur les similitudes et les convergences qui existent entre la pensée du Général de Gaulle et celles tout à la fois des personnalistes non-conformistes français, du national-syndicaliste espagnol José Antonio Primo de Rivera [2] et de divers auteurs de la Révolution conservatrice allemande. Ce parallélisme frappant se retrouve également dans le cas de la pensée du fondateur de la République démocratique irlandaise, dirigeant du Fianna Fáil, Eamon de Valera. Mais encore faut-il un minimum d’ouverture d’esprit pour l’admettre sans sombrer pour autant dans la caricature et la propagande.
En fait, ces aspirations politiques, qui ont pour toile de fond les thèmes de « civilisation des masses » et de « société technicienne » (traités en particulier par Ortega y Gasset) se retrouvent chez de très nombreux intellectuels européens des années trente qui ne sont pas réactionnaires, mais qui cherchent une synthèse, une réconciliation en forme de dépassement dialectique [« Être de gauche ou être de droite, c’est choisir une des innombrables manières qui s’offrent à l’homme d’être un imbécile ; toutes deux, en effet, sont des formes d’hémiplégie morale », écrit José Ortega y Gasset dans sa Préface pour le lecteur français à La Révolte des masses (1937)].Comme tous ces penseurs, de Gaulle n’est en rien un conservateur réactionnaire. Il admet la civilisation des masses et la technique ; il n’y a chez lui aucune nostalgie pastorale. Le gaullisme et le personnalisme des non-conformistes des années trente ne divergent vraiment que dans la conception de la nation : la défense gaullienne de l’unité, de l’indépendance et de la souveraineté de la nation s’oppose au fédéralisme européen des personnalistes. Il n’en reste pas moins que de Gaulle souhaitera toujours défendre une doctrine politique qui va dans le même sens que celle des personnalistes, marquée par la volonté de dépasser la droite et la gauche.
Toute sa vie durant, de Gaulle cherchera à trouver un système nouveau, une « troisième voie » entre le capitalisme et le communisme. En 1966, époque où il semble intéressé par l’ordo-libéralisme de Walter Eucken et Wilhelm Röpke, il écrit à Marcel Loichot : « Peut-être savez-vous que depuis toujours, je cherche, un peu à tâtons, la façon pratique de déterminer le changement, non point du niveau de vie, mais bien de la condition de l’ouvrier. Dans notre société industrielle, ce doit être le recommencement de tout, comme l’accès à la propriété le fut dans notre ancienne société agricole ». Toute sa vie il se refusera à se positionner sur l’axe droite/gauche. Pour lui, la droite ou la gauche ne sont que des références politiciennes qui lui sont parfaitement étrangères : « être gaulliste, dit-il en 1965, c’est n’être ni à gauche, ni à droite, c’est être au-dessus, c’est être pour la France ». Et encore « La France, c’est tout à la fois, c’est tous les Français. Ce n’est pas la gauche, la France ! Ce n’est pas la droite, la France !… maintenant comme toujours, je ne suis pas d’un côté, je ne suis pas de l’autre, je suis pour la France » (15/12/1965).
Dans les années trente, de Gaulle ne considère pas la question sociale comme primordiale. Un officier supérieur doit s’attacher d’abord et avant tout à la mise en œuvre des meilleurs moyens de l’indépendance de la nation. Dans une lettre du 13 novembre 1937 à son ami Jean Auburtin, il s’en explique : « Pour moi, je suis dans les chars jusqu’au cou ». Dans cet immédiat avant-guerre, tout semble se ramener pour lui à des phénomènes psychologiques de jalousie et d’envie, d’un côté, d’orgueil et d’égoïsme, de l’autre. Avant d’être un penseur social, le général de Gaulle sera toujours un philosophe de la souveraineté, de l’indépendance et de la liberté. Mais sa pensée sociale va émerger à Londres, pendant les années de guerre, après le long silence des années vingt et trente. Le premier discours du général de Gaulle où apparaît la question sociale est celui de l’Albert Hall, le 15 novembre 1941, un mois et demi après la Charte du Travail promulguée par le régime de Vichy, le 4 octobre 1941. Le discours d’Oxford, du 25 novembre 1941, est aussi essentiel pour comprendre la pensée du Général car il y évoque le rôle de la machine, l’avènement des masses et le conformisme collectif qui battent en brèche les libertés individuelles. L’économie est certes importante, mais elle n’est qu’un moyen au service de fins plus hautes. Dès lors, tout système où l’économie est une fin en soi, qu’il s’agisse du capitalisme sauvage ou du collectivisme totalitaire se trouve écarté. Le gaullisme pose comme postulat la primauté de l’homme sur l’économique, sur le technologique et sur tout système doctrinaire.
S’il admet les partis, les syndicats et les notables, leur concédant la gestion de la politique au jour le jour, de Gaulle dénie à quiconque le droit de remettre en cause les grandes options de sa politique nationale et internationale. Contempteur de « la classe papoteuse, ragotante et jacassantes », critique sévère de l’inconsistance, de l’inefficacité et de l’esprit d’abandon de la gauche, le Général dénonce impitoyablement la bêtise et l’immobilisme de la droite. Ses critiques les plus acerbes s’adressent aux classes privilégiées, à la bourgeoisie d’argent et du savoir, qu’ils jugent trop souvent blasée, malsaine et gangrenée, et à ses porte-paroles de la faune journalistique. « Le populo a des réflexes sains. Le populo sent ou est l’intérêt du pays. Il ne s’y trompe pas souvent. En réalité, il y a deux bourgeoisies. La bourgeoisie d’argent, celle qui lit Le Figaro, et la bourgeoisie intellectuelle, qui lit Le Monde. Les deux font la paire. Elles s’entendent pour se partager le pouvoir. Cela m’est complètement égal que vos journalistes soient contre moi. Cela m’ennuierait même qu’ils ne le soient pas. J’en serais navré, vous m’entendez ! Le jour où Le Figaro et L’Immonde me soutiendraient, je considérerais que c’est une catastrophe nationale ».
Fermement attaché à la tradition colbertiste, pour lui, rien d’important ne peut se faire en France, si ce n’est pas l’État qui en prend l’initiative. L’État a des moyens, il faut qu’il en use. « Le but n’est pas de tarir les sources de capitaux étrangers, déclare le Général, mais d’empêcher l’industrie française de tomber entre des mains étrangères. Il faut empêcher les directions étrangères de s’emparer de nos industries. Nous ne pouvons pas nous en remettre à l’abnégation ou au patriotisme de messieurs les PDG et de leurs familles, n’est-ce pas ? Il est trop commode pour les capitaux étrangers de les acheter, de payer en bon dollars les fils et les gendres… ». « Je me fous de BP, de Shell et des Anglo-Saxons et de leurs multinationales ! […] Ce n’est qu’un des nombreux cas où la puissance des soi-disant multinationales, qui sont en réalité d’énormes machines anglo-saxonnes, nous a écrasés, nous autres Français en particulier, et les Européens en général […] Si l’État ne prend pas les choses en mains, nous nous faisons couillonner. »
Au XXe siècle, l’État a le devoir de stimuler l’économie concertée et d’instaurer la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise. Pour éviter la situation d’antagonisme permanent entre patrons et ouvriers, l’association capital-travail, la participation, thème particulièrement cher au Général, doit être mise en œuvre à trois niveaux. C’est d’abord l’intéressement au bénéfice de l’entreprise. C’est ensuite la participation à la plus-value du capital pour faire des ouvriers des copropriétaires. C’est enfin l’association des cadres et de l’ensemble du personnel à la gestion des entreprises. Le salariat, autrement dit l’emploi d’un homme par un autre, « ne doit pas être la base définitive de l’économie française, ni de la société française, affirme de Gaulle, et cela pour deux raisons : d’abord des raisons humaines, des raisons de justice sociale ; et des raisons économiques, ce système ne permet plus de donner à ceux qui produisent la passion et la volonté de produire et de créer ». Il est dès lors bien évident que ce type de relations ne peut s’inscrire ni dans le libéralisme, ni dans le marxisme. Ainsi, il apparaît clairement que la position gaullienne, dès lors qu’elle répudie d’une part, le totalitarisme collectiviste, d’autre part, le laisser-faire et la loi de la jungle, ne peut se fonder que sur les principes de l’économie concertée.
Le Général n’est pas un antieuropéen comme le disent ses adversaires inféodés aux États-Unis et à l’OTAN. Il veut l’Europe mais pas n’importe laquelle. Il a même la plus profonde conscience de ce qu’elle représente : les liens historiques entre les peuples, par-delà leurs discordes, leurs conflits, les extraordinaires contributions que chacun d’entre eux a apportées au patrimoine mondial de la pensée, de la science et de l’art. Dans ses Mémoires, il n’hésite pas à souligner « l’origine chrétienne » et le caractère exceptionnel de l’héritage des européens. Son idée de l’Europe et des États-nations diffère radicalement de celle de ses adversaires sociaux-démocrates ou démocrates-chrétiens, comme Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Robert Schuman ou Jean Monnet. Alors qu’ils rêvent d’une fédération, lui souhaite une confédération. Alors qu’ils ont comme perspective l’absorption de l’Europe dans une communauté plus ample, dans la communauté atlantique, lui veut un ensemble continental, indépendant et souverain. « […] chaque peuple est différent des autres, incomparable, inaltérable, affirme de Gaulle. Il doit rester lui-même, tel que son histoire et sa culture l’ont fait, avec ses souvenirs, ses croyances, ses légendes, sa foi, sa volonté de bâtir son avenir. Si vous voulez que des nations s’unissent, ne cherchez pas à les intégrer comment on intègre des marrons dans une purée de marrons. Il faut respecter la personnalité. Il faut les rapprocher, leur apprendre à vivre ensemble, amener leurs gouvernants légitimes à se concerter, et un jour, à se confédérer, c’est-à-dire à mettre en commun certaines compétences, tout en restant indépendants pour tout le reste. C’est comme ça qu’on fera l’Europe. On ne la fera pas autrement ».
L’idée d’une « Europe de l’Atlantique à l’Oural », d’une Europe libérée du condominium américano-soviétique, d’un « nouvel ordre européen », d’une indépendance réelle de toute l’Europe face au monde extérieur, est fondamentale dans la vision gaullienne du futur monde multipolaire. Sans l’obsession d’émanciper l’Europe de sa situation de satellite des États-Unis on ne peut pas comprendre la politique étrangère du général de Gaulle, ni sa sortie du système de l’OTAN, « simple instrument du commandement américain », ni son hostilité « au privilège exorbitant » du dollar jouant le rôle de réserve internationale, ni son refus réitéré d’admettre la candidature de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, ni sa lutte obstinée en faveur du tarif extérieur commun et de la préférence communautaire. « Si les Occidentaux de l’Ancien Monde demeurent subordonnés au Nouveau, disait le Général, jamais l’Europe ne sera européenne et jamais non plus elle ne pourra rassembler ses deux moitiés »
« Notre politique, confie-t-il à son ministre et porte-parole, Alain Peyrefitte, je vous demande de bien le faire ressortir : c’est de réaliser l’union de l’Europe. Si j’ai tenu à réconcilier la France et l’Allemagne, c’est pour une raison toute pratique, c’est parce que la réconciliation est le fondement de toute politique européenne. Mais quelle Europe ? Il faut qu’elle soit véritablement européenne. Si elle n’est pas l’Europe des peuples, si elle est confiée à quelques organismes technocratiques plus ou moins intégrés, elle sera une histoire pour professionnels, limitée et sans avenir. Et ce sont les Américains qui en profiteront pour imposer leur hégémonie. L’Europe doit être in-dé-pen-dante ». Pour le Général, il est clair que l’Europe de l’Ouest doit avoir de solides alliés pour faire face aux dangers du communisme. Mais à ses yeux, il existe aussi une seconde menace, aussi redoutable, l’hégémonisme américain.La construction de l’Europe doit donc se faire sans rompre avec les Américains mais indépendamment d’eux. Précisant encore sa pensée, de Gaulle ajoute : « On ne peut faire l’Europe que s’il existe une ambition européenne, si les Européens veulent exister par eux-mêmes. De même, une nation, pour exister en tant que nation, doit d’abord prendre conscience de ce qui la différencie des autres et doit pouvoir assumer son destin. Le sentiment national s’est toujours affirmé en face d’autres nations : un sentiment national européen ne pourra s’affirmer que face aux Russes et aux Américains. » Ce qu’il reproche aux Anglo-Saxons, c’est de vouloir aménager une Europe sans frontières, un Europe des multinationales, placée sous la tutelle définitive de l’Amérique, une Europe où chaque pays perdrait son âme. Réaliste, il poursuit : « l’Amérique, qu’elle le veuille ou pas, est devenue aujourd’hui une entreprise d’hégémonie mondiale […] L’expansion des Américains, depuis la Seconde guerre est devenue irrésistible. C’est justement pour ça qu’il faut y résister ». Et encore : « Les Européens n’auront pas retrouvé leur dignité tant qu’ils continueront à se ruer à Washington pour y prendre leurs ordres. Nous pouvons vivre comme un satellite, comme un instrument, comme un prolongement de l’Amérique. Il y a une école qui ne rêve que de ça. Ça simplifierait beaucoup les choses. Ça dégagerait des responsabilités nationales ceux qui ne sont pas capables de les porter… ». « C’est une conception. Ce n’est pas la mienne. Ce n’est pas celle de la France […]. Il nous faut mener une politique qui soit celle de la France […]. Notre devoir est de ne pas disparaître. Il est arrivé que nous ayons été momentanément effacés ; nous ne nous y sommes jamais résignés […]». « La politique de l’Union soviétique et celle des États-Unis aboutiront toutes les deux à des échecs. Le monde européen, si médiocre qu’il ait été, n’est pas prêt à accepter indéfiniment l’occupation soviétique, d’un côté, l’hégémonie américaine, de l’autre. Ça ne peut pas durer toujours. L’avenir est à la réapparition des nations. »
Attaché à la nation française, quelles que soient ses composantes, de Gaulle aurait été indigné contre ceux qui aujourd’hui ne donnent pas la préférence aux Français. « C’est dans le préambule de la Constitution de 1958, rappelait-t-il, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et au principe de la souveraineté nationale ». « Article 1 : l’égalité devant la loi est garantie à tous les citoyens ». On ne parle pas des autres. Donc il y a primauté du citoyen quelque soit la provenance ». Et encore : « N’est-ce pas à nous, anciens colons, qui avons permis aux anciens colonisés de donner la préférence à la population d’exiger aujourd’hui que la préférence soit donnée aux Français dans leur propre pays ? Refuser provoque le racisme. »
On aime de Gaulle ou ont le hait, mais à l’aune du Général on ne peut ressentir que dégoût et mépris pour ses successeurs-imposteurs qui l’ont mythifié pour mieux le trahir.
Arnaud Imatz (Cercle Aristote, 1er juin 2020)
Notes :
[1] Sur la troisième voie, voir A. Imatz, Droite – Gauche, pour sortir de l’équivoque, Paris, P.G.D.R., 2016 et Los partidos contra las personas. Izquerda y derecha : dos etiquetas, Madrid, Áltera, 2008.
[2] En novembre 1935, alors qu’il avait pris ses distances avec le fascisme mussolinien, José Antonio Primo de Rivera (dont la pensée sera récupérée et manipulée par l’Espagne franquiste, comme l’a été celle de De Gaulle en France) déclarait : « Dans la révolution russe, dans l’invasion des barbares à laquelle nous assistons, il y a les germes d’un ordre futur et meilleur bien qu’ils soient encore occultés et jusqu’ici niés. Il nous faut sauver ces germes et nous voulons les sauver. C’est le véritable travail qui revient à l’Espagne et à notre génération : passer de la rive où nous sommes, celle d’un ordre économico-social qui s’écroule, à la rive fraiche et prometteuse du nouvel ordre que l’on devine ; il nous faut sauter d’une rive à l’autre par l’effort de notre volonté, de notre vivacité et de notre clairvoyance ; il nous faut sauter d’une rive à l’autre sans que le torrent de l’invasion des barbares ne nous entraine ». Et en janvier 1936, il écrit dans la même veine qu’Ortega y Gasset : « Être de droite ou être de gauche, c’est toujours exclure de l’âme la moitié de ce qu’elle doit ressentir. C’est même parfois exclure le tout pour lui substituer une caricature de moitié ».