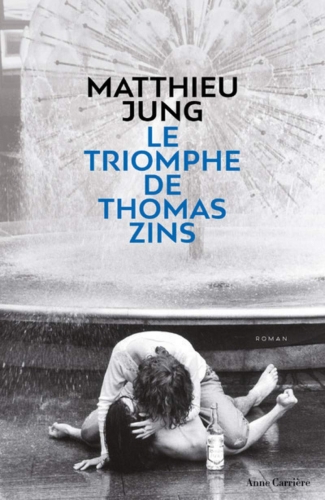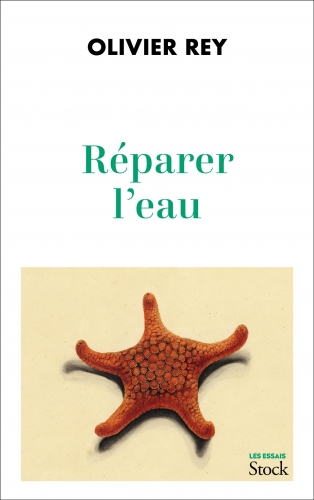Le triomphe de Thomas Zins : anatomie d'un consentement
La publication du roman de Matthieu Jung, Le triomphe de Thomas Zins, n'a suscité que de rares échos bienveillants dans la presse et il s'est trouvé aussi quelques culs-bénis de gauche ou de droite, jetant de part et d'autre des anathèmes bien imbéciles, tel petit fonctionnaire du bien-penser brandissant le sempiternel « soupçon d'homophobie », tel excité du goupillon, campant sur la rive opposée du marigot idéologique français, affirmant au contraire que le roman se vautre « dans la fange sodomite ». Quand les abrutis des deux camps se mettent d'accord pour vilipender un texte, on sait en général que celui-ci risque d'être bon. Avec Matthieu Jung, on est bien au-delà et plus d'un lecteur aura réalisé en achevant le Triomphe qu'il tenait là un très grand texte, certainement d'ailleurs l'un des rares grands textes que la fin du XXè et le début du XXIè, peu prodigues en la matière, nous auront laissé.
Dans le Triomphe de Thomas Zins, Matthieu Jung évoque une adolescence vécue dans les années 80 entre Nancy et Paris, évitant tout à la fois la mièvrerie et cette insupportable pseudo-connivence du vintage ou du kitsch, qui est le plus insupportable des maniérismes auxquels nous a habitué une époque obsédée par la mode du « revival ». Pas d'idéalisation, ni de regard attendri ou de second degré lourdingue dans l'évocation que livre Jung d'une adolescence vécue en 1985. Pour décrire le quotidien de Thomas Zins, les filles, les fantasmes, les frustrations et les tics de langage qui peuplent l'univers du nancéen de quinze ans entrant en classe de Seconde, Matthieu Jung fait mouche quasiment à tous les coups. De fait, Le Triomphe est l'une des évocations les plus justes, et, conséquemment, les plus cruelles, qui soient de cette France des années 80 qui vécut « l'illusion lyrique » mitterrandienne avant de voir peu à peu le rêve égalitaire et libérateur s'achever avec le « tournant libéral » fabiusien pour finalement sombrer dans la mascarade du PS à l'heure d'Harlem Désir et de Touche pas à mon pote. C'est aussi dans ce laps de temps d'une dizaine d'années que l'on observe également le triomphe et la ruine de Thomas Zins, jeune homme brillant mais influençable, obnubilé par ses rêves de succès érotiques et littéraires.
Thomas triomphe, certes, au début du roman, mais ce triomphe, on le comprend, l'aveugle et en fait la victime idéale d'un prédateur croisant son chemin et suffisamment roué pour tirer parti de l'orgueil et des doutes du jeune homme. L'époque que décrit le Triomphe de Thomas Zins, est aussi celle qui célèbre encore, quinze après mai 68, l'impératif de jouissance, jusqu'à donner licence à la perversité la plus manipulatrice. En ce temps-là, on voyait Tony Duvert plastronner dans les colonnes de Libération en déclarant : « Je connais un enfant et si la mère est opposée aux relations que j'ai avec lui, ce n'est pas du tout pour des histoires de bite, c'est avant tout parce que je le lui prends. Pour des histoires de pouvoir, oui. »1 C'est l'époque où une certaine intelligentsia pouvait encore trouver très subversif de voir le même Duvert proclamer : « Je n'ai jamais fait l'amour avec un garçon de moins de six ans et ce défaut d'expérience, s'il me navre, ne me frustre pas vraiment. Par contre, à six ans, le fruit me paraît mur : c'est un homme et il n'y manque rien. Cela devrait être l'âge de la majorité civile. On y viendra. »2 Le journal Libération avait fini par faire son mea culpa en 2001 sous la plume de Sorj Chalandon et s'est cru récemment obligé de rappeler cet aggiornamento tardif alors que la tempête déclenchée par le scandale des pratiques pédophiles au sein de l'Eglise catholique risquait d'atteindre les rivages encore tranquilles de la gauche transgressive, Eglise médiatique autrement plus puissante.
De ces années 80 là, le roman restait à faire puisqu'un silence gêné a succédé dans nombre de milieux à l'hagiographie littéraire. Les exemples, plus ou moins prestigieux, de Duvert à Matzneff, ne manquaient certes pas pour inspirer dans le Triomphe de Thomas Zins, le personnage de Jean-Philippe Candelier, pédéraste3 sordide se vantant auprès de sa jeune victime de nauséabonds exploits, enjolivés et justifiés au nom de cette esthétique frelatée dont nous sommes habitués à avoir les oreilles rebattues, avec ses thuriféraires, ses grands noms et ses grands prêtres, l'inusable trio Bataille, Genet, Sade, croquemitaines en carton-pâte du théâtre de Guignol de la pseudo-transgression, agités et brandis à tout propos, pour tout justifier, du grotesque au répugnant. A coup sûr avec Candelier, Matthieu Jung a créé un intéressant monstre littéraire, dont l'humanité n'est pourtant que trop bien restituée dans ces travers les plus révoltants.
Petit à petit, le prédateur tisse sa toile autour de Thomas, usant du chantage ou de la menace, instillant le doute comme un poison dans le psychisme adolescent pour neutraliser chez sa victime tous les mécanismes de défense, réussissant même pour finir à lui voler jusqu'à la parole pour réduire la victime au silence. Ce que le roman de Jung réussit aussi parfaitement, c'est à laisser la figure de Candelier relativement à l'arrière-plan. Hormis une ou deux scènes cruciales qui montrent simplement de quelle manière l'influence délétère du jouisseur sans entrave peut démolir le psychisme d'un gamin de quinze ans, ce qui intéresse le romancier est de narrer le combat livré par Thomas contre lui-même pour tenter de retrouver, à travers l'inextricable labyrinthe érigé par son vrai-faux « ami », et par la vie elle-même, qui est vraiment Thomas Zins. Au cours de cette lente dérive s'abîment l'adolescence, les premières amours, les amitiés et les ambitions d'un jeune homme trop arrogant et trop naïf qui se rêve romancier à succès et se figure avec candeur que la malhonnêteté et le cynisme de Candelier sont seulement une forme de transgression mondaine qui doit nécessairement accompagner la carrière de tout écrivain brillant et subversif. Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused...
A travers les tribulations de Thomas, le roman de Matthieu Jung parle de l'absence destructrice des pères, du renoncement des aînés, d'un traumatisme spécifiquement français, qui renvoie bien au-delà des années 80 ou de mai 68, à la Seconde Guerre mondiale et aux guerres de décolonisation qui jettent dans le livre de Jung une ombre funeste sur les parents, les aînés, se débattant dans leur histoire familiale et leurs existences de plus en plus vides, au point de n'être plus capables de venir au secours de leur propres enfants. En écrivant sur de tels sujets, Matthieu Jung aurait pu aussi tomber dans le pamphlet, le réquisitoire ou le roman à thèse. C'est un écueil qu'il évite complètement en livrant au lecteur un roman d'une lumineuse noirceur.
Des idiots (Idiocratie, 24 avril 2024)
Notes :
1 « Non à l'enfant poupée », propos recueillis par Guy Hocquenghem et Marc Voline, Libération, 10 avril 1979
2 Tony Duvert, L'Enfant au masculin, éditions de Minuit, 1980, pages 18 et 21
3 Si d'aventure, il se trouve un lecteur tenté de hurler à l'homophobie en lisant ce passage, je lui conseillerais d'aller tout de suite consulter un dictionnaire pour être bien au clair sur le sens du terme « pédéraste ». Les confusions malveillantes étant de nos jours malheureusement fort commodément entretenues.