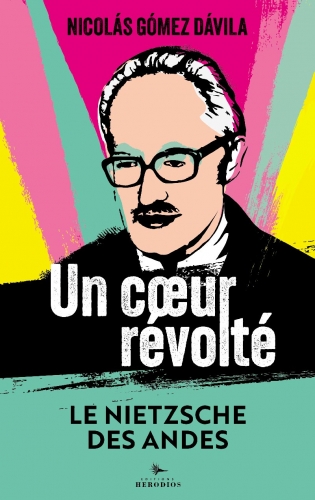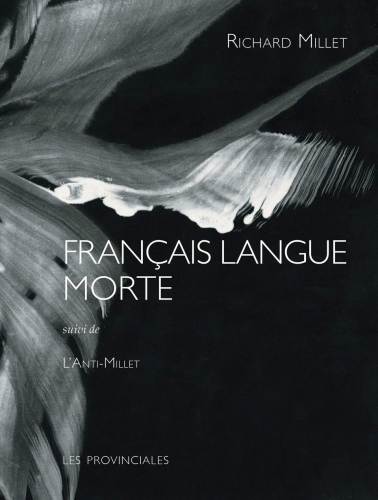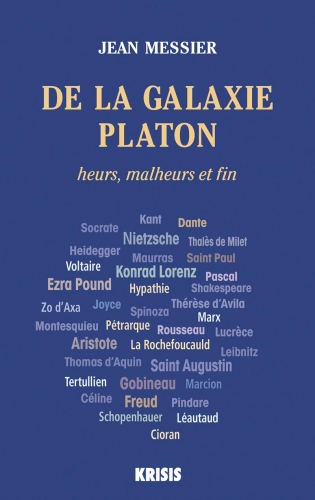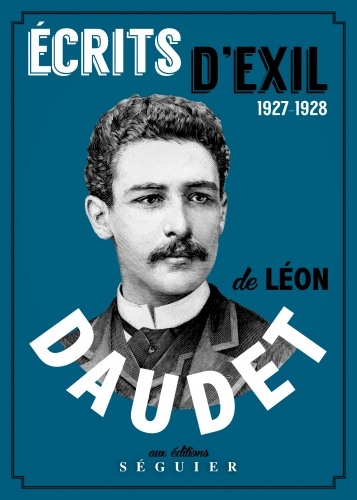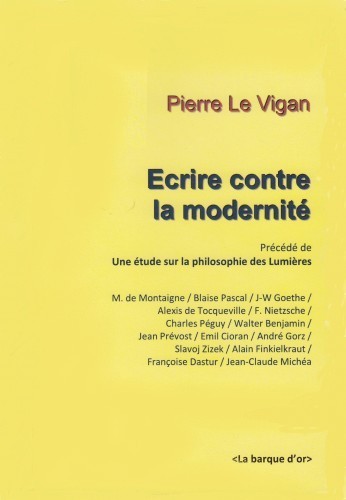Maître ou esclave ?
« La vie vaut ce que nous sommes capables de risquer pour elle ».
La parabole du Maître et de l’esclave figure dans la « Phénoménologie de l’Esprit », l’une des œuvres maîtresses du philosophe allemand Hegel. Son enseignement est brutal ; ceux qui mettent leur vie en jeu sont les maîtres, ceux qui attendent leur protection d’un autre sont les esclaves.
La parabole d’Hegel retrouve une cruelle actualité en cette période de COVID19. Il faut y penser et y repenser sans cesse. Car elle interroge le paradigme dominant de l’Europe et de quelques autres sociétés avec elle. Vers quel avenir nous conduit la préférence sans limites pour la vie qui tient tout gouvernement, toute autorité, responsable de la vie longue, sans maladie, sans accident et sans handicap pour tous ? Et, de manière plus large, et donc indécidable ; vers quel modèle de vie nous conduit l’obsession de la précaution, du risque zéro, du « care » permanent — vers quel modèle de confort douillet ou de cauchemar ?
Trois faits obligent à poser la question
D’abord, les données connues sur la réalité de la pandémie de COVID19. Dans leur immense majorité, les cas graves et les victimes sont des personnes âgées de plus de 80 ans, souffrant d’un ou plusieurs facteurs de comorbidité, tels que le diabète, l’insuffisance cardiaque et respiratoire ou l’obésité, et donc l’espérance de vie était inférieure à une année sans le COVID. Plus de 90 % des cas de personnes plus jeunes présentent de tels facteurs de comorbidité, au point que les personnes jeunes ou adultes en parfaite santé victimes du COVID sont l’exception. Les assureurs pourraient le dire ; les quelque 50 000 décès attribués au COVID en France ne représentent qu’un nombre dérisoire d’années de travail perdues, et un nombre très faible d’années de vie en bonne santé et en toute autonomie perdues.
Ensuite, les données inconnues à ce jour — ou non diffusées. Par exemple, sur les traitements par lesquels des médecins ont aidé leurs clients à surmonter les premières atteintes de la pandémie. Beaucoup ont traversé l’épreuve sans suites, et à moindres frais, bien aidés par leur médecin de famille, bien avant l’arrivée de vaccins supposés être la panacée, et qui semblent se révéler décevants (notamment en Israël). Par exemple aussi, sur les modes de contamination réels, qui semblent rendre accessoires et le port du masque et les distances sociales si inégalement observées — allez prendre le métro à Paris ou Bruxelles aux heures de pointe !
Enfin, l’extraordinaire censure qui pèse sur toute opinion, toute information, tout conseil non conforme aux objectifs des « Big Pharma « et de l’industrie de la santé. Le renforcement des contrôles sur les médecins libéraux, la restriction de leur liberté de prescription sous l’égide du Conseil de l’ordre, leur mise à l’écart spectaculaire du processus de vaccination, le terrorisme corporatiste dont différents médecins ou experts ont été victimes, traduit une prise de pouvoir des industriels sur les indépendants, et une volonté d’étouffer toute contestation de l’ordre de la médecine numérique et des ‘Big pharma’ qui nous fait entrer dans un nouvel âge du ‘soigner-guérir’.
Un goût perdu pour la liberté ?
En un mot, l’homme devient une machine comme les autres, le corps est un ensemble de pièces mécaniques comme les autres, l’Intelligence artificielle indifférente au cadre familial, au contexte social, à l’origine et au mode de vie, doit en finir avec la médecine libérale et le ‘médecin de famille’ — en existe-t-il encore de ceux dont la seule arrivée valait déjà réconfort ? — pour que la maladie devienne la ressource illimitée des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants d’algorithmes, des petites mains qui établissent les diagnostics — et de ceux dont elle finance les campagnes électorales.
Ces constats d’une sujétion sanitaire établie renvoient à Hegel. Avec une soumission avérée, les populations européennes préfèrent : ‘une minute monsieur le Bourreau’ à leur liberté. Il leur est affirmé qu’ils vivront plus longtemps à la condition d’abdiquer toute autonomie individuelle. Ils l’acceptent. Mais quelle est cette vie sous le masque, quelle est cette vie confinée, quelle est cette vie sans les autres, les rencontres, les échanges, la découverte, le spectacle et la fête ? Tout au long de ce stupéfiant épisode de fabrique de l’obéissance, ce sera la dignité des philosophes que d’avoir posé la question ; que vaut une vie privée de la culture, de la rencontre, de l’amitié, une vie végétative, une vie réduite à la survie ?
Il faut d’ailleurs signaler que bien peu de politiques et aussi de religieux, ont su poser les questions qui comptent, et qui vont bien au-delà de la critique, justifiée ou non, de l’intendance gouvernementale et de la logistique sanitaire. Où sont ces élus qui n’avaient que le mot ‘culture’ à la bouche ? Ceux qui répétaient ‘libertés publiques, libertés individuelles’ comme des perroquets ? Au nom de quoi tolérer l’entassement du métro et du RER, mais fermer les restaurants ? Au nom de quoi accepter les files d’attente aux portes des magasins ou au comptoir des ‘fast food’ qui prospèrent sur la crise, mais refuser que les cinémas ou les théâtres acceptent, par exemple, que leurs sièges soient occupés au quart de leur capacité, et détruire le spectacle vivant ? Au nom de quoi enfin interdire la libre circulation dans tout ce que la France compte d’espaces vides, de chemins de randonnée et de forêts ? Et sans masques !
Soir après soir, ceux qui croient qu’ils gouvernent exposent une joie malsaine à imposer des restrictions, à détailler de nouvelles contraintes, à agiter les sanctions prévues contre les contrevenants. Et sans doute agissent-ils avec la double crainte, d’un côté d’être accusés de trop en faire, et d’achever de ruiner une économie et des professions au bord du gouffre, de l’autre, d’être poursuivis, de voir leur responsabilité pénale engagée, et de passer le reste de leur vie à se défendre — la menace n’est pas théorique, et il faudra bien un jour délivrer la décision et l’action politique de la menace paralysante du droit. Mais ils participent à la tentative de ‘nouvel ordre social’, de ce ‘Great Reset’ qui voit l’hypercapitalisme inventer une société de l’obéissance et de la conformité, et les libertés économiques, en particulier celles de constituer des monopoles mondiaux, rêver d’en finir avec les libertés politiques — notamment celle de mal voter.
La question posée par la pandémie de COVID19 n’a en réalité que bien peu à voir avec chiffres, statistiques et origine du virus. Elle porte sur la conception de la vie. Qu’est-ce qu’une vie ? Qu’est-ce qui fait qu’une vie vaut d’être vécue ? Est-ce qu’une vie sans rencontres, sans concerts publics, sans cinémas, sans expositions, sans théâtres, une vie sans restaurants, sans manifestations culturelles, reste une vie ? Qu’est-ce qui fait une bonne vie ? La séparation physique d’avec les autres, la distanciation sociale, l’enfermement à domicile, devant son écran, valent-ils les quelques mois, quelques années de vie qu’ils sont prétendus aider à gagner ?
La question fait partie des trous noirs des sociétés développées, libérales, modernes. Il n’est pas permis d’interroger ce qu’est une vie bonne, encore moins d’en proposer des modèles. C’est du moins ce que l’individualisme radical répond au travail millénaire des penseurs, des savants et des politiques qui se sont attachés à définir, dans des sociétés particulières, à des moments particuliers de leur histoire, ce qui faisait une vie bonne. Sénèque, Montaigne, Rabelais sont loin. Et le Décalogue. Nous payons ce manque. Car ceux qui n’ont pas appris qu’une vie bonne a pour première condition la liberté d’être sont promis à l’esclavage que leur promet le seul attachement à la durée d’une vie dans laquelle plus rien ne reste de vivant.
Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 30 janvier 2021)