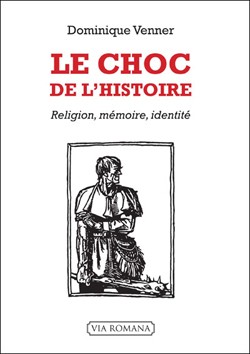"L’autonomie, il faut le souligner, est quelque chose de tout à fait différent de l’indépendance. L’autonomie n’est pas plus une indépendance « inachevée » que l’indépendance n’est le point d’aboutissement logique de la marche vers l’autonomie. L’indépendance suppose la capacité d’un individu ou d’une collectivité, d’un « je » ou d’un « nous », à vivre de manière totalement autosuffisante, sans rien devoir aux autres. C’est ici que l’on retrouve l’idéal libéral de l’individu « séparé ». L’autonomie, au contraire, organise le rapport aux autres d’une manière plus souple, plus organique. On pourrait dire qu’elle n’appelle pas l’indépendance, mais plutôt l’interdépendance." Alain de Benoist (2003)
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Javier R. Portella, cueilli sur Polémia et consacré aux élections en Catalalogne, qui pourraient déboucher à terme sur un référendum sur l'indépendance de cette région. Javier R. Portella, qui est l'auteur de l'essai intitulé Les esclaves heureux de la liberté (David Reinharc, 2012), nous rappelle que la solutions des problèmes de l'Europe ne passe sans doute pas par la multiplication des micro-nationalismes mais plutôt par la capacité des Européens à construire une identité forte articulée sur trois niveaux de réalité : celui des patries charnelles, celui des états-nations et celui de la civilisation commune...

La sécession en Catalogne ou les maux du nationalisme chauvin
J’écris ces lignes le soir même du dimanche 25 novembre, jour des élections en Catalogne qui étaient censées produire un raz-de-marée sécessionniste en faveur de l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne. Le raz-de-marée ne s’est pourtant pas produit, les électeurs s’étant bornés à préférer « l’original », Esquerra Republicana, le parti le plus radicalement sécessionniste, qui est passé de 10 à 21 sièges, à « la copie », le CiU, parti qui avait convoqué les élections, qui est tombé de 62 à 50 sièges. Bref, un simple transfert de voix au sein des sécessionnistes qui, ensemble, représentent toujours 64% des électeurs, face à 36% pour les forces non séparatistes.
Le désastre du nationalisme chauvin
Mais oublions la petite cuisine électorale. Essayons de cerner les questions qui vraiment importent. Que se passe-t-il, que se joue-t-il en Catalogne (et il faudrait ajouter : et dans le Pays basque) ? La question est d’autant plus importante que la mouvance identitaire (du moins en France), portée sans doute par le rejet on ne peut plus légitime du jacobinisme, fait preuve souvent d’une grande incompréhension du phénomène national en Espagne, en même temps qu’elle manifeste des sympathies à l’égard de forces dont la victoire nous mènerait tout simplement à la catastrophe : au désastre du nationalisme chauvin que l’Europe a déjà suffisamment souffert jadis dans ses chairs.
Ne nous trompons pas. L’enjeu, aujourd’hui en Catalogne (il faudrait préciser : en Catalogne espagnole, car il y a aussi une Catalogne française), ce n’est nullement la défense d’un petit peuple à la langue, à la culture, à l’identité et aux droits politiques brimés par l’oppression d’un autre peuple ou d’un quelconque pouvoir central. Si brimades il y a eu, elles ont plus que disparu depuis plus de trente ans, l’Espagne s’étant constituée en fait dans une sorte d’Etat fédéral dont les parties constitutives, appelées « Communautés autonomes », jouissent même de plus de droits que bien des Etats fédéraux.
Le catalan, l’anglais et l’espagnol
Soyons clairs. Si une langue, une culture, une histoire est aujourd’hui brimée et vilipendée en Catalogne, cette langue, cette culture, cette histoire n’est nullement celle de la Catalogne : c’est celle de l’Espagne, dont la langue – un exemple parmi mille – tient dans l’enseignement une place plus réduite que celle accordée à l’anglais. La fin du discours que pour clôturer la campagne électorale Artur Mas, président de la Catalogne, a prononcé en… anglais en constitue d’ailleurs la preuve éclatante et symbolique. Puisque le catalan est une langue minoritaire, était-il signifié, et puisqu’il nous faut bien une langue universelle dans ce monde heureusement globalisé que nous aimons tellement… alors, que cette langue soit donc l’anglais plutôt que l’espagnol que nous exécrons mais dont nous ne savons pas quoi faire pour nous en passer !
La négation d’un passé millénaire
C’est là toute la question. Lorsque la haine nationale, ou, si l’on préfère un mot moins fort, lorsque l’animadversion chauvine déverse son fiel dans le cœur d’un peuple (comme elle le déversa jadis dans le cœur, par exemple, des Français et des Allemands), toutes les autres questions deviennent parfaitement secondaires. Posons celle qui est sans doute la plus importante : Faut-il en finir avec « l’Etat-nation » pour créer, au sein de l’Europe, un autre modèle d’organisation politique de nos peuples ? Sans doute. C’est même tout à fait légitime de le revendiquer ou, tout au moins, de poser la question. Or, toute revendication devient illégitime, toute question devient là-dessus nulle et non avenue dès lors que le mouvement premier qui porte un tel élan consiste dans la négation de l’Autre : dans la négation, en l’occurrence, d’un passé millénaire où la langue, les institutions, la culture, l’être même de la Catalogne ont été indissociables – avec autant de particularités que l’on voudra – de la langue, des institutions, de la culture, de l’être même de l’Espagne.
La vraie question de l’identité collective de nos peuples
Il faut, certes, poser et défendre, face à l’individualisme qui nous accable, la question de l’identité collective de nos peuples. C’est là, il faut bien le reconnaître (*), le grand (et seul) mérite des mouvements nationalistes catalan et basque (tout le problème est qu’ils prétendent que leur identité est une, alors qu’elle est double !). Le phénomène est d’autant plus paradoxal que, face à ce grand élan identitaire, il s’étale, dans le reste de l’Espagne, une sorte de néant d’identité où l’individualisme le plus forcené, ayant écarté toute mémoire, tout enracinement, toute tradition, a gagné la partie.
Il faut poser, disais-je, la question de l’identité collective de nos peuples. Mais il est absurde (outre ce qui vient d’être dit) de poser une telle question dans les termes de ces nationalistes catalans (et basques) qui, tout en ayant constamment le mot « identité » à la bouche, s’empressent d’accueillir, les bras grands ouverts, les masses extra-européennes dont l’immigration de peuplement met en danger notre identité à nous tous, à commencer par la leur.
Javier R. Portella (Polémia, 25 novembre 2012)
(*) Je l’ai explicitement reconnu et développé, par exemple, dans mon livre España no es una cáscara [L’Espagne n’est pas une coquille], Áltera, Barcelone, 2000.