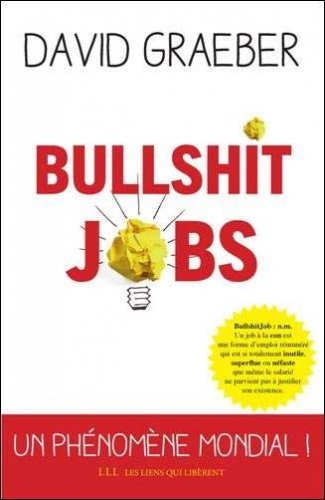Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de François Bousquet, cueilli sur le site de la revue Eléments et consacré à la remise en lumière, provoquée par la crise sanitaire, des métiers essentiels à la survie de la société. Journaliste et essayiste, rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet a notamment publié Putain de saint Foucauld - Archéologie d'un fétiche (Pierre-Guillaume de Roux, 2015), La droite buissonnière (Rocher, 2017) et Courage ! - Manuel de guérilla culturelle (La Nouvelle Librairie, 2019).

Biopolitique du coronavirus (7). Gilets jaunes et blouses blanches : des «métiers de merde» ?
Est-ce que je fais un « bullshit job », un boulot à la con, ou pas ? That is the question. De ce point de vue, le confinement a agi un peu comme un sérum de vérité : si je suis confiné, si je télétravaille, ne serait-ce pas parce que j’exerce un de ces boulots à la con ? Aïe, aïe, aïe ! Cette question a été posée pour la première fois par David Graeber dans un article qui a défrayé la chronique altermondialiste en 2013, avant de devenir cinq ans plus tard un livre à succès, passionnant et foutraque, au ton joyeusement persifleur, Bullshit jobs (2018). Lisez-le. Le coronavirus lui a donné une actualité nouvelle et brûlante (merci à Dominique Méda de nous avoir récemment rappelé son existence).
David Graeber ressemble à son livre : il est aussi anarchiste que son bouquin est anarchique. Méthodologiquement parlant, il a même un côté professeur Didier Raoult. Ses sources sont parfois fantaisistes, il glane ses exemples au fil des discussions sur les réseaux sociaux. Bref, il est contre les échantillons représentatifs là où il n’y a pas de raison de les convoquer. C’est ce qui rend ses intuitions si stimulantes. Même s’il ne l’avouera pas, le slogan d’Occupy Wall Street : « Nous sommes les 99 % », c’est lui. Il faut dire qu’il les connaît bien, ces 1 % restants puisque dans son domaine d’élection, l’enseignement de l’anthropologie à la London School of Economics, l’une des écoles les plus sélectes au monde, il appartient à cette élite, académique en l’occurrence, et que partout ailleurs son gauchisme débraillé lui confère le capital culturel légitime pour faire l’intéressant sur les ondes de la BBC et de Radio France. À part cela, c’est un type très attachant.
Nomenclature des jobs à la con
Marx distinguait deux classes sociales antagonistes, Graeber s’en tient à deux types de boulots qui recoupent sur un mode désopilant la vieille rivalité marxiste : les « bullshit jobs », les boulots à la con, qui n’apportent rien à la communauté, mais rapportent beaucoup d’argent à ceux qui les exercent ; et les « shit jobs », les métiers de merde, qui apportent beaucoup à la communauté, mais qui ne rapportent rien à ceux qui les exercent.
À dire vrai, Graeber est surtout intarissable sur les « bullshit jobs », peut-être parce que, comme activiste d’extrême gauche, il n’a jamais eu accès qu’à des gars qui en faisaient partie. Mais je l’ai dit, c’est un garçon sympathique et drôle. De toutes les catégories de jobs à la con qu’il recense, ma préférée demeure « cocheur de cases », qui rappelle ce chef-d’œuvre absolu de critique sociale (et métaphysique) qu’est « Le journal d’un fou » de Nicolas Gogol dans ses Nouvelles pétersbourgeoises, avec son petit fonctionnaire qui taille des crayons et consigne dans son journal une folie grandissante de plus en plus inaccessible.
À part ça, Graeber passe en revue tout ce que les « bullshit jobs » comptent d’analystes financiers, d’agents immobiliers, de personnel administratif (il y a autant de « bullshit jobs » dans le privé que le public, mais ce dernier a déjà donné lieu à une littérature surabondante, inutile de s’y attarder), d’avocats d’affaires, de forçats du télémarketing qui vous appellent depuis Madagascar, de responsables des ressources humaines, de vendeurs de joujoux connectés débiles, d’organisateurs de séminaire, d’utilisateurs de Power Point, de coiffeurs pour chien, d’animateurs de réunion et, last but not least, tous ces types qui pondent des rapports d’activité aussi volumétriques que des piles de containers métalliques, le « reporting », comme disent les néomongoliens quand ils sont en mode « corporate » – la maladie verbomotrice du capitalisme terminal.
La soviétisation du néolibéralisme
C’est ce qui pousse Graeber à comparer le néolibéralisme à la bureaucratie soviétique, deux armées de parasites en miroir. En régime capitaliste avancé, le travail inutile gagne du terrain partout. Ainsi selon Graeber, jusqu’à la moitié du travail utile – les métiers socialement utiles donc – est perdue en travail inutile (rédaction de rapports chronophage, perte de temps en réunions interminables et autres stages de formation superflus, etc.).
Mais le problème est plus vaste. Songez au temps fou gâché à remplir des formulaires, à renseigner des demandes d’inscription numériques, à noter des identifiants qu’on perd et des mots de passe qu’on ne retrouve pas. Ou encore à télécharger des séries addictives au lieu de bosser, à se gratter le nez au lieu de réfléchir à ce qu’on fera à Macron après le déconfinement ou à faire défiler des applications sur son smartphone pour écrire des informations aussi capitales que : « Tu as bien fermé la porte du frigo ? » ou « Qu’est-ce qu’elle est cruche, Cindy ! Non, mais allô quoi ! »
Où sont passés les analystes financiers ?
En résumé, le néocapitalisme est un mélange de productivisme et de parasitisme. Comment est-ce possible ? Il suffit de lire les travaux d’Ivan Illich sur la contreproductivité. Passé un certain stade, tout gain se transforme en perte. Les cercles vertueux dégénèrent en cercles vicieux. C’est vrai plus encore des institutions en situation de monopole, sans autre prédateur qu’elles-mêmes, ce qu’est le système capitaliste, qui multiplient les activités inutiles chargées d’encadrer d’autres activités qui finissent par devenir à leur tour inutiles. Si inutiles qu’elles pourraient disparaître sans que personne ne s’en aperçoive. La preuve par le Covid-19. Qui a remarqué la disparition des promoteurs immobiliers et des analystes financiers ?
On en arrive ainsi, de job foireux en boulot oiseux, à un tiers de personnes, aux États-Unis, au Royaume-Uni et sûrement en France, qui pensent que leur boulot n’a pas plus de sens qu’il n’a d’utilité sociale. Cela a même donné lieu à un nouveau syndrome : le « brown-out », littéralement la baisse de courant ou chute de tension. Une sorte de neurasthénie molle et ouateuse, sensation plus houllebecquienne que kafkaïenne, qui s’incarne ou se désincarne dans la figure du déprimé déprimant.
Les nouveaux galériens
Voilà pour les « bullshit jobs », venons-en aux « shit jobs », les métiers de merde, socialement dévalorisés, mais indiscutablement utiles. Si jamais ils venaient à disparaître, la société s’effondrerait sur elle-même. Sans eux, pas de pain, pas de soins dentaires, pas de pâtes alphabet pour les enfants, pas d’enlèvement des poubelles. Ceux qui les exercent sont les soutiers de la société de consommation et les galériens de la société de service : ils en assurent le « back office », selon les termes de Denis Maillard dans Une colère française (2019). On admettra volontiers qu’aucun d’entre eux ne peut bosser en télétravail.
Macron les a gazés, éborgnés, matraqués, poursuivis. Sans pitié. Aujourd’hui, il les félicite. Subitement, les zéros sont devenus des héros, les derniers de cordée des premiers de tranchée et les Gilets jaunes sont passés sans transition des gardes à vue aux nuits de garde. Ça ne les a pas beaucoup changés, me direz-vous. Le gouvernement qui n’a jamais été avare en LBD et grenades lacrymogène (la notion de stock stratégique trouve ici tout son sens) n’a pas cru bon de leur fournir des masques !
Jérôme Fourquet et Chloé Morin ont comparé la sociologie des professions jugées de première nécessité, sinon vitales, en période de pandémie, et celle des Gilets jaunes : le moins qu’on puisse est qu’elles présentent nombre de points communs. On y trouve pêle-mêle des caissières, des chauffeurs routiers, des aides-soignantes, des livreurs, des facteurs, des éboueurs, des magasiniers, les fameux « caristes ». C’est un prolétariat sans gloire et sans mythe mobilisateur. La maison du peuple, c’est désormais l’entrepôt. Chez les hommes, l’entrepôt a désavantageusement remplacé l’usine. Chez les femmes, c’est l’aide à la personne – et elle n’a pas avantageusement remplacé le personnel des maisons bourgeoises d’antan.
L’inégalité devant le risque
Une des thèses centrales d’Ulrich Beck, l’auteur de La Société du risque (1986), livre central pour comprendre notre temps, c’est que, à l’heure de la globalisation, les risques sont de plus en plus indiscriminés, singulièrement dans les sociétés dominées par ce qu’il appelle la « subpolitique technologique » : plus le risque se mondialise, plus il est socialement indifférencié – bref il se « démocratise ». Ainsi les particules fines ou le réchauffement ne font-elles pas le tri entre le cadre supérieur et l’ouvrier. C’est vrai. Mais il faut néanmoins des décontamineurs à Fukushima ou à Tchernobyl, et, sauf erreur, ce ne sont pas des militantes d’Osez le féminisme qui sont les premières à se porter volontaires. Pas plus que ce ne sont des suffragettes ou des cadres supérieurs qui achètent des pavillons pourris avec vue sur la centrale de Flamanville ou de Fessenheim en espérant faire une plus-value immobilière avant leur cancer de la thyroïde. Aussi convient-il de nuancer cette sociorépartition du risque et son exposition, hier aux coups de grisou, aujourd’hui aux virus ou autres.
Cette inégalité devant la mort s’observe plus chez les hommes. Les ouvriers vivent six ans de moins que les cadres (pas les ouvrières), chiffre jusqu’ici incompressible. Une réserve, mais de taille, dans ce tableau aussi implacable qu’une tragédie grecque : l’inégalité par temps de guerre. Si de tout temps c’est l’infanterie qui a été l’arme la plus exposée, la plus sacrifiée, celle où on dénombre le plus de morts, il est faux d’imaginer que cette saignée n’affecte que le prolétariat troupier. Aujourd’hui, les médecins sont en première ligne, les pharmaciens aussi, sans parler des élus locaux, des commerçants-artisans et dans une moindre mesure des enseignants. Et pour mémoire, ce furent les officiers inférieurs, en 1914-1918, qui subirent les plus lourdes pertes. Pour un fantassin sur quatre massacré dans les tranchées, un officier d’infanterie sur trois, dont son lot de saint-cyriens certes, mais aussi de profs – depuis le normalien jusqu’à l’instit (au statut autrement supérieur qu’aujourd’hui), la profession proportionnellement la plus touchée.
Compter les sous ou compter les morts
Le gouvernement français n’est pas pressé de donner le bilan des personnels de santé infectés par le Covid-19. En Italie, on sait qu’il y a déjà eu une centaine de médecins décédés. En France ? Circulez, y’a rien à voir. Il serait pourtant très simple de réunir les données des agences régionales de santé. Mais Macron en a peur, Olivier Véran ne sait pas qu’elles existent et Jérôme Solomon s’embrouille tout le temps dans ses tables de multiplication. Ces Messieurs savent pourtant compter, mais les sous, pas les morts (le prémonitoire « Vous comptez les sous, on comptera les morts ! » scandé à l’automne dernier par des blouses blanches en grève).
Alors bien sûr, on ne va pas ajouter sa voix au concert de louanges quotidiennes douteuses adressées aux soignants – trop attendues et trop entendues pour être crues sur parole. Mais une fois de plus on vérifie que la société abrite des trésors de dévouement en dépit du laminage constant de la philosophie utilitariste qui postule la recherche de l’intérêt individuel, seule unité de mesure des peines et des plaisirs. Cette philosophie, qui au cœur du néolibéralisme, ne résiste pas un instant à l’analyse. Son contraire non plus du reste. Nous sommes ainsi faits que nous recherchons le gain et la sympathie, nous nous débattant en permanence entre la sociabilité naturelle de notre espèce et un quant à soi non moins naturel, la recherche de l’intérêt et le désintéressement, la confiance et la défiance, l’ami et l’ennemi. Ni ange ni bête, comme dit Pascal, qui, pourtant en bon janséniste, voyait le mal partout.
Rendons grâce au virus. Il a rappelé à une certaine médecine dorée et dévoyée ses missions hippocratiques essentielles, qu’elle avait eu parfois tendance à négliger. Un peu comme dans le sketch que les Inconnus avaient consacré aux hôpitaux publics, avec un chef de service aussi crâneur que branleur qui arrive en retard, traverse négligemment les couloirs, visite en dilettante les malades, avant de s’éclipser prématurément en confiant à son assistant : « Bon, je file, j’ai un cours. »
– À la Sorbonne ?
– Non, à Roland-Garros !
De toute évidence, on n’en est plus là.
L’hôpital ne se fout plus de la charité
Sans le coronavirus, l’hôpital public français était programmé pour finir à l’institut médico-légal. Vingt ans qu’on le démolit, lit après lit, bâtiment après bâtiment, service d’urgence après maternité. Vingt ans de coupes budgétaires avec pour conséquence une centaine de milliers de lits perdus. En dix ans, près de 12 milliards d’économie (tout cumulé). Dès avant 2008, on a choisi de sauver « nos » banques, pas notre hôpital. Pour un banquier sauvé, combien de lits sacrifiés ? Ici comme ailleurs, le service de la dette est devenu une servitude insupportable. Avec la tarification à l’activité, qui a généralisé l’abattage médical et son illusoire culture du résultat, on a instauré un hôpital d’entreprise mis au régime forcé du management automobile, suivant la logique du « lean management » (to lean, « dégraisser, mincir »). L’administration hospitalière cherche partout des gains de productivité.
Enfin pas partout ni pour tout le monde : ce régime décharné ne vaut que pour le patient français, pas pour l’immigré clandestin. Car étonnamment, les syndicats qui braillent à raison leur mécontentement ne pointent jamais le coût délirant de l’AME, l’Aide médicale de l’État, près d’1 milliard par an, pour des pseudo-migrants qui viennent faire soigner gratuitement – tant qu’à faire – de lourdes et très coûteuses pathologies. Savez-vous que la Sécurité sociale engage en moyenne chaque année plus de dépenses de soin pour un « sans-papiers », qui n’a jamais cotisé, que pour un Français, qui a cotisé toute sa vie ?
Ni bonnes ni nonnes
L’hôpital, c’est aujourd’hui trente infirmiers agressés chaque jour, une douzaine d’infirmiers depuis 2016 suicidés sur leur lieu de travail, des patients de moins en moins patients, 30 % d’infirmiers qui abandonnent leur métier dans les cinq ans qui suivent l’obtention du diplôme d’infirmier et plus des deux tiers des effectifs qui travaillent en horaires décalés. Eh bien, nonobstant cela, nonobstant ce gâchis, nonobstant ces cadences infernales, l’hôpital a tenu, singulièrement les femmes surreprésentées. Ni bonnes ni nonnes, hurlaient hystériquement les féministes dans les convulsions de 1968. Oui-da, Mesdames ! Mais enfin, il n’y a rien de déshonorant à servir les malades. Il suffit de relire un des plus grands témoignages sur que soigner veut dire pour s’en assurer, je veux parler du prodigieux Un Souvenir de Solferino (1862) du futur fondateur de la Croix rouge, Henry Dunant. À lire et à relire. Avec les vieilles chroniques par temps de peste où les plus beaux témoignages, les plus déchirants, à tous les coups, sont ceux adressés aux religieuses – vos ancêtres. On naît femme, on ne le devient pas.
François Bousquet (Éléments, 28 avril 2020)