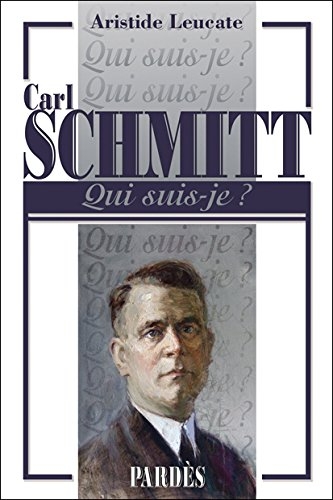Raymond Aron, penseur machiavélien
A l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de Raymond Aron (1905-1983) les éloges pompeux, grandiloquents, voire dithyrambiques, n’ont pas manqué. « Modèle d’intégrité intellectuelle », « héros d’intelligence », « immense talent », « figure majeure de la pensée française du XXe siècle », tels sont les qualificatifs flatteurs qu’on a pu lire sous les plumes des nombreux « spécialistes » et disciples patentés du célèbre philosophe, sociologue et journaliste. Cette emphase, digne des intellectuels des régimes totalitaires (et donc fort peu aronienne), prête à sourire lorsqu’on sait que l’auteur de « L’Opium des intellectuels » se voyait affublé, il n’y a pas si longtemps, des épithètes les plus insultantes. On se souvient de ces légions d’intellectuels dogmatiques (parfois les mêmes), qui imposaient avec fruition l’adage : « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Mais oublions la désagréable compagnie de ces courtisans et opportunistes et félicitons-nous de ces éloges somme toute sans barguigner. Raymond Aron mérite d’être honoré à double titre : d’une part, parce qu’il nous a offert une interprétation magistrale de son époque et cela en pleine période de terrorisme intellectuel et d’intoxication freudo-marxiste et, d’autre part, parce qu’il nous a légué une méthode de recherche et d’analyse de la réalité historique particulièrement utile pour comprendre notre époque.
On déplorera cependant qu’une grande partie de la bibliographie aronienne soit aujourd’hui tombée dans une vision consensuelle, adaptative, neutraliste et finalement déformatrice de sa pensée. L’objectif de la manœuvre est évidemment clair : présenter un Raymond Aron parfaitement lisse, « politiquement correct », une image acceptable par tous, ou presque, du héraut de la communauté spirituelle internationale de la pensée libérale et sociale-démocrate
Réalisme machiavélien versus machiavélisme :
Anticommuniste « sans remords », atlantiste « résolu », Aron est à l’évidence un continuateur de la tradition libérale, minoritaire en France, qui va de Montesquieu à Elie Halévy en passant par Tocqueville. Il se disait même social-démocrate, ou plus exactement keynésien en matière économique. Il acceptait l’économie mixte et une certaine dose d’interventionnisme de l’Etat. Mais son libéralisme politique ne doit pas pour autant se confondre, comme le prétendent certains, avec le réductionnisme économique de l’Ecole autrichienne (von Mises, Hayek), ni avec l’anarcho-capitalisme des libertariens (Rothbard, Hoppe), ni avec le social-libéralisme de Bouglé, ni avec le néo-social démocratisme d’Habermas. Aron se sépare de tous ces auteurs et de leurs écoles de pensée en raison de leur incapacité à comprendre l’autonomie et la légitimité du politique dans l’histoire.
Le réalisme politique de Raymond Aron, aspect le moins célébré et le moins étudié de ses écrits (trente-cinq livres, plus de deux cents articles scientifiques et d’innombrables articles de journaux), est capital pour ceux qui veulent vraiment comprendre et apprécier l’originalité et la portée de son œuvre. La dimension tragique et pessimiste, clairement assumée, n’est pas chez lui accidentelle ou contingente ; elle est fondamentale voire essentielle. Aron s’est intéressé à Machiavel et au machiavélisme, très tôt, dès le printemps 1937 (1). Avec Montesquieu, Clausewitz, Tocqueville, Pareto, Marx et Weber, Machiavel fut l’un de ses principaux interlocuteurs. Les affinités pour la pensée du Florentin furent chez lui d’abord répulsives en raison de sa formation socialiste, mais bien vite elles se transformèrent en affinités électives. La conversion au machiavélisme politique, face à l’idéalisme ingénu de ses adversaires, date très exactement de la « drôle de guerre ». C’est alors qu’Aron comprend que pour survivre les régimes démocratiques doivent être capables des mêmes vertus politiques que les régimes totalitaires (notamment en matière de politiques sociales et démographiques et de lutte contre le chômage). La nécessité d’un minimum de foi et de volonté commune relève pour lui de l’évidence. Il préconise dès lors de remédier aux défaillances de la démocratie libérale en lui insufflant une dose de décisionnisme. Les valeurs d’une saine religion civile doivent animer impérativement les démocraties libérales. Elles seules sont capables, selon lui, de galvaniser l’esprit public dans une situation de survie nationale.
L’Espagnol Jerónimo Molina Cano (2), un des plus grands connaisseurs du réalisme politique, souligne que le libéral Aron figure en bonne place dans toutes les généalogies des penseurs machiavéliens. Il écrit justement à ce propos : « On peut extraire des pages des livres que sont Polémiques, L’Homme contre les tyrans, Les guerres en chaîne, Démocratie et totalitarisme ou encore Machiavel et les tyrannies modernes, des affirmations convaincantes sur la primauté du politique, l’impossibilité du choix inconditionnel des moyens de l’action politique, la condition oligarchique de tout régime, l’accidentalité des formes de gouvernement, la corruption inéluctable de tout pouvoir politique, etc ».
Mais qu’entend-on exactement par réalisme politique ou tradition de pensée machiavélienne (non-machiavélique) de la politique ? Il ne s’agit pas d’une école homogène, ni d’une famille intellectuelle unitaire. C’est seulement un habitus mental, une disposition intellectuelle et un point de vue d’étude ou de recherche qui vise à éclairer les règles que suit la politique. Il suffit de jeter un rapide coup œil sur l’imposante liste des auteurs étudiés par les divers participants au Congrès international, Il realismo politico: temi, figura e prospettive di ricerca (octobre 2013), organisé par Alessandro Campi et la revue de La Società Italiana di Scienza Politica, pour se convaincre de la diversité et de l’importance de cette tradition de pensée (3)
Le réalisme politique ne se réduit pas à la défense du statu quo ou à la défense de l’ordre établi comme le prétendent ses adversaires. Il n’est pas la doctrine qui justifie la situation des hommes au pouvoir. Il est une méthode d’analyse et de critique de tout pouvoir constitué. Le machiavélisme vulgaire et caricatural n’est au fond que le cynisme des amoureux de la justice abstraite. Le véritable réalisme politique part de l’évidence des faits, mais ne se rend pas devant eux. Il ne se désintéresse pas des fins dernières et se distingue en cela du pseudo-réalisme de type cynique. Le réaliste politique peut être un idéaliste ou tout au moins un homme avec des principes, une morale, une profonde conscience des devoirs et des responsabilités de l’action politique. L’œuvre de Baltazar Gracian, pour ne citer qu’elle, montre que la prudence, la sagesse, l’équilibre, le sens de la responsabilité et la fermeté de caractère sont les clefs du réalisme.
Raymond Aron s’est toujours démarqué de l’image du machiavéliste cynique, qui réduit la politique à la seule volonté de puissance, au règne et au culte de la force à l’état pur. Il refuse ce machiavélisme vulgaire et caricatural : la conception darwinienne de l’homme, la simple technique de conquête du pouvoir, l’instrument de manipulation du peuple, la manière totalement amorale ou immorale de comprendre la lutte politique.
Julien Freund, autre penseur machiavélien majeur de langue française de l’après deuxième guerre mondiale, auteur du magistral L’Essence du politique (1965), souligne lui aussi, tout à la fois, l’importance de la finalité propre à la politique, le bien commun (la politique au service de l’homme, la politique dont la mission n’est pas de changer l’homme ou de le rendre meilleur, mais d’organiser les conditions de la coexistence humaine, de mettre en forme la collectivité, d’assurer la concorde intérieure et la sécurité extérieure) et la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur, la justice).
A dire vrai, le juif-agnostique et libéral classique, Raymond Aron, rédacteur de La France libre à Londres et le catholique, conservateur-libéral, ancien résistant, Julien Freund, se retrouvent sur un bon nombre de points. Il en est ainsi de l’attachement aux libertés individuelles et au partage du pouvoir, de l’affirmation de la nécessité de l’autorité de l’Etat, de la confiance dans la politique pour maintenir l’ordre social, du refus du dépérissement utopique du politique et du rejet du « Tout est politique » ou du « Tout est idéologie », chemin inévitable du totalitarisme. Pour les deux politologues, l’ordre politique, avec ses nécessités et ses valeurs, ne constitue pas la totalité de l’existence humaine. Scientifiquement, il est impossible de prononcer un jugement catégorique sur la convenance de l’un ou l’autre des régimes en place. Il n’y a pas de régime optimal ou parfait. A leurs yeux la société libérale est une société de conflits, et ces conflits doivent être canalisés, réglementés, institutionnalisés. Ils doivent être résolus autant que possible sans violence. Le conservateur-libéral, Freund, ne se sépare vraiment du libéral politique, Aron, que dans sa critique plus musclée de l’altération du libéralisme : son évolution vers la défiance à l’égard de la politique comme de l’Etat, sa transformation du principe de tolérance en principe de permissivité, son scepticisme à l’égard de l’idée du progrès (alors qu’Aron, sensible aux désillusions du progrès, veut néanmoins encore y croire), sa méfiance des excès de l’individualisme, son incapacité à penser suffisamment l’existence des relations extérieures communautaires et la diversité et l’identité des collectivités humaines. Le manque de vertu civique, d’indépendance et de responsabilité personnelle et la trahison ou la dépolitisation des élites constituent, selon Freund, le problème majeur des démocraties parlementaires modernes.
Il convient de rappeler ici le fameux dialogue entre le philosophe hégélien, socialiste et pacifiste Jean Hyppolite et Julien Freund. C’était le jour de la soutenance de thèse de Freund (le 26 juin 1965) (4), et le futur professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg articulait sa réflexion autour de trois principes qu’il jugeait constitutifs de la politique : souveraineté/obéissance, public/privé et ami/ennemi. Raymond Aron, directeur de thèse, présidait le jury composé de cinq membres.
Hyppolite, heurté au plus profond de sa sensibilité et de ses convictions, dit à Freund : « Sur la question de la catégorie de l’ami-ennemi [catégorie que l’on sait tirée des travaux de Carl Schmitt, qui insiste sur le fait que l’essence de la politique n’est pas l’inimitié mais la distinction entre ami et ennemi et qui exclue l’élimination absolue de l’ennemi (nda)] si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu’à aller cultiver mon jardin. »
Freund réplique : « Ecoutez, Monsieur Hyppolite, vous avez dit […] que vous aviez commis une erreur à propos de Kelsen. Je crois que vous êtes en train de commettre une autre erreur, car vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en aurons pas, raisonnez-vous. Or c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitiés. Du moment qu’il veut que vous soyez son ennemi, vous l’êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin ».
Hyppolite, agacé, répond alors de façon pathétique : « Dans ce cas, il ne me reste plus qu’à me suicider. »
Et Raymond Aron de conclure: « Votre position est dramatique et typique de nombreux professeurs. Vous préférez vous anéantir plutôt que de reconnaître que la politique réelle obéit à des règles qui ne correspondent pas à vos normes idéales ».
Ces mots résument assez bien le thème de cet article. Mais pour être mieux compris, encore faut-il tenter de dresser le catalogue des points qui relient Aron à la tradition machiavélienne.
Aron et les principales idées de la tradition machiavélienne :
Sept repères peuvent être indiqués :
1. L’idée de l’existence d’une nature humaine. L’étude de la politique ne peut pas faire l’économie d’une vision de l’homme. « L’homme est dans l’histoire. L’homme est historique. L’homme est histoire », nous dit Aron. La nature humaine demeure inaltérable dans le temps. Les pulsions humaines expliquent en partie le caractère instable des institutions politiques et le caractère conflictuel de la politique. Il peut y avoir des phases exceptionnelles d’équilibre relativement satisfaisant de l’ordre politique, mais la stabilité définitive, la fin de l’Histoire, relève du rêve, de l’utopie, de la mystification ou de la manipulation idéologique.
2. L’affirmation de l’autonomie du politique voire de la relative suprématie de la politique sur les autres sphères de l’activité humaine (économie, culture, morale, religion). Aron ne prétend pas substituer un déterminisme par un autre, mais reconnaître que la politique est plus importante que les autres activités parce qu’elle affecte directement le sens de l’existence. Elle est la caractéristique fondamentale d’une collectivité, la condition essentielle de la coopération entre les hommes. Aron proclame, en outre, la primauté de la politique extérieure sur la politique intérieure. Il ne s’agit pas chez lui de préférer le bien commun à la puissance ou la gloire, mais de comprendre que la puissance est la condition du bien commun.
3. Le caractère inévitable de la classe politique, de l’oligarchie et de la division gouvernants-gouvernés. Aron, comme toute une pléiade d’auteurs aux sensibilités très différentes, tels Carlyle, Ostrogorsky, Spengler, Schmitt, Weber, Madariaga, Vegas Latapie, Evola, Duguit, De Man ou Laski, sait les limites et le caractère nettement oligarchique de la démocratie parlementaire. Pareto, Mosca, Michels ont souligné l’existence d’une véritable loi d’airain de l’oligarchie. De manière tout aussi explicite, le philosophe politique Gonzalo Fernández de la Mora parle de « démocratie résiduelle », se résumant, selon lui, à l’opportunité que les oligarchies partitocratiques offrent aux gouvernés de se prononcer sur une option, généralement limitée, après avoir procédé à une opération d’ « information » de l’opinion publique (5)
5. La reconnaissance de la nature intrinsèquement conflictuelle de la politique. La vie sera toujours le théâtre de conflits et de différences. Les passions, la multiplicité des fins, le choix des moyens disponibles, etc., sont le fondement d’une perpétuelle dialectique universelle. Imaginer un monde politique sans adversaires, sans tensions, sans conflits, c’est comme se représenter une morale sans la présence du mal ou une esthétique sans laideur. La politique au sens traditionnel est la grande « neutralisatrice » des conflits. Voilà pourquoi la résistance systématique à toute forme de pouvoir peut constituer une excellente méthode pour accélérer la corruption du pouvoir et entraîner sa substitution par d’autres formes de pouvoir beaucoup plus problématiques et despotiques. Enfin, ce n’est pas parce qu’un peuple perd la force ou la volonté de survivre ou de s’affirmer dans la sphère politique que la politique va disparaître du monde. Qui peut croire qu’à défaut de la persistance des anciennes nations de nouveaux groupes de peuples ne se formeront pas et ne tendront pas à s’exclure réciproquement ? Le mondialisme, débilité intellectuelle, est le propre des ignorants du passé de l’humanité. L’histoire n’est pas tendre… malheur au fort qui devient faible !
6. Le rejet de toute interprétation mono-causale de la politique comme partiale et arbitraire. Les explications mono-causales « en dernière instance » par l’économie, par la politique, par la culture, par la morale, etc., n’ont aucun sens. Aron refuse sans la moindre ambiguïté de subordonner la politique à l’économie. Selon lui, la politique n’est jamais réductible à l’économie, bien que la lutte pour la possession du pouvoir soit liée de multiples manières au mode de production et à la répartition des richesses. La surestimation de l’économie est l’erreur radicale, la mystification majeure d’Auguste Comte, de Karl Marx et de tant de philosophes et économistes modernes. Aron nie que les régimes d’économie dirigée soient la cause des tyrannies politiques. La planification et la tyrannie ont souvent une origine commune, mais la semi-planification ou la planification indicative ne conduisent pas nécessairement à la planification totale et à la tyrannie comme le prétendent Hayek et les ultralibéraux de l’Ecole autrichienne. L’expérience de l’histoire (Espagne de Franco, Chili de Pinochet, République populaire de Chine actuelle, etc.) montre qu’il n’existe pas de lien causal nécessaire entre un type d’économie et un régime politique déterminé.
7. Le scepticisme en matière de formes de gouvernement. Aron s’affirme libéral politique, mais il reconnaît la pluralité des régimes politiques, chacun conçu comme une solution contingente et singulière, comme une réponse transitoire à l’éternel problème du politique. Tous les régimes sont par ailleurs également soumis à l’usure du temps et à la corruption. Aron est enfin plutôt indifférent, sinon hostile, au clivage gauche-droite. Dans la Préface à L’Opium des intellectuels, il écrit : « On n’apportera quelque clarté dans la confusion des querelles françaises qu’en rejetant ces concepts équivoques [de droite et de gauche] ». On sait d’ailleurs qu’Aron appréciait La Révolte des masses, de José Ortega y Gasset, et faisait grand cas de son célèbre aphorisme : « Être de gauche ou être de droite c’est choisir une des innombrables manières qui s’offrent à l’homme d’être un imbécile ; toutes deux, en effet, sont des formes d’hémiplégie morale ».
Arrivé à ce point de la démonstration, il n’est peut être pas inutile d’esquisser une seconde comparaison, un second rapprochement, plus inattendu, mais tout aussi valable, celui du libéral politique Aron et du national-libéral, conservateur résolu, que fut Jules Monnerot. Monnerot, le grand censuré, honni et exclus de l’Université française, l’auteur génial de Sociologie du communisme (1949) et de Sociologie de la Révolution (1969), le résistant, l’activiste de la deuxième guerre mondiale, le premier franc-tireur intellectuel important contre la politique eschatologique, contre les religions totalitaires du salut collectif, Monnerot, l’esprit libre et indépendant, qui fut du petit nombre de ceux qui représentèrent dignement la philosophie et la sociologie politique de langue française dans les années 1945-1960, Monnerot, la bête noire « fasciste » des marxistes, crypto-marxistes et gauchistes, parce qu’il dénonça trop tôt l’essence religieuse du communisme et fut ensuite un précurseur de la dissidence contre « la pensée unique » et le multiculturalisme de la fin du XXe siècle. Comparer Aron et Monnerot, alors que le premier, professeur à la Sorbonne et au Collège de France, s’est toujours gardé de citer le second, conscient qu’il était de n’avoir pas la force de briser le terrible cordon sanitaire dressé autour de son collègue (?), comparer deux figures aussi inégales en réputation académique et médiatique (?), voilà de quoi offusquer les mandarins et autres gardiens du temple. Et pourtant, Monnerot, victime de la censure mais bon prince et surtout bien plus tolérant que ses censeurs, ne déclarait-il pas encore quelques années avant de mourir : « La pensée occidentale n’admet pas ce qui doit entraîner la suppression intellectuelle, voire physique, du réfractaire à la vérité… la pensée occidentale admet une sorte de pluralisme et de perspectivisme – c’est d’ailleurs la lignée intellectuelle à laquelle on peut me rattacher (6) » ?
Les atteintes à la liberté d’expression, la censure, sont à l’évidence de tous les lieux et de toutes les époques. Au sein de l’Université française, la fréquentation affichée de certains auteurs a toujours attiré les foudres, le reproche moraliste et finalement l’ostracisme actif du coupable. Mais les universitaires qui avaient vingt ans en 1968 et qui n’étaient pas aveuglés par l’idéologie savent combien les intellectuels non conformistes, ouvertement opposés à la doxa freudo-marxiste, devaient alors savoir faire preuve de détermination et de courage (7)
On comprend d’autant mieux la bienveillance et le respect que professent les esprits indépendants de ma génération pour les maîtres d’hygiène intellectuelle que sont les réalistes politiques (machiavéliens, antimachiavéliques) Raymond Aron, Julien Freund et Jules Monnerot. Aron, pour ne citer ici que lui, nous donna deux dernières leçons de rigueur et de probité à la veille de sa disparition. A l’occasion de la publication de L’Idéologie française, de Bernard-Henri Lévy, il n’hésita pas à écrire que l’auteur « viole toutes les règles de l’interprétation honnête et de la méthode historique » (Express, février 1981). Deux ans plus tard, le 17 octobre 1983, il témoigna en faveur de son ami Bertrand de Jouvenel contre l’historien israélien Zeev Sternhell qui prétendait que l’auteur de Du Pouvoir avait manifesté des sympathies pro-nazies en tant que théoricien majeur du fascisme français. A la barre, il dénonça de sa voix ferme « l’amalgame au nom de la vérité historique ». Puis, sortant du Palais de justice de Paris, il prononça ces derniers mots : « Je crois que je suis arrivé à dire l’essentiel », avant de s’éteindre terrassé par une crise cardiaque. Ces déclarations ne sauraient s’oublier !
Pour Jerónimo Molina Cano, spécialiste du machiavélisme aronien, le réalisme politique du fondateur de la revue Commentaire constitue la voie de connaissance la plus adéquate pour explorer la « verita effetuale della cosa ». Ajoutons, pour notre part, que Raymond Aron, ex-président de l’Académie des sciences morales et politiques de France, n’était pas seulement un brillant intellectuel, mais d’abord et avant tout un homme, tout un Homme, « todo un caballero », comme disent les Espagnols.
Arnaud Imatz (Polémia, 16 janvier 2014)
Notes :
1) Par une curieuse coïncidence, l’année 2013 a été marquée à la fois par la célébration du 500eanniversaire du Prince de Nicolas Machiavel (avec une exposition Il Principe di Machiavello e il suo tempo 1513-2013 (Rome, avril-juin 2013) et par le 30e anniversaire de la mort de l’un de ses lecteurs et commentateurs majeurs, Raymond Aron (célébré le 17 octobre 2013)
2) Jerónimo Molina Cano, Raymond Aron, realista político. Del maquiavelismo a la crítica de las religiones seculares, Madrid, Ediciones Sequitur, 2013. Professeur de sociologie et de politique sociale à l’Université de Murcie, directeur de la revue Empresas Políticas, Molina Cano est un disciple du politologue Dalmacio Negro Pavón, professeur à l’Université Complutense et à l’Université CEU San Pablo de Madrid.
3) Les précurseurs de cette école de pensée sont Han Fei Zi, Thucydide, Aristote, Kautilya (Chânakya), Ibn Khaldoun, Nicolas Machiavel, Gabriel Naudé, Hobbes, Tocqueville. Parmi ses figures contemporaines ou modernes les plus représentatives on peut citer : Raymond Aron, Gaston Bouthoul, Jacob Burckhardt, James Burnham, Filippo Burzio, Federico Chabod, Benedetto Croce, Gonzalo Fernández de la Mora, Julien Freund, Paul Gottfried, Bertrand de Jouvenel, Günter Maschke, H. J. Mackinder, John Mearsheimer, Robert Michels, Gianfranco Miglio, Jules Monnerot, Gaetano Mosca, Dalmacio Negro Pavón, Reinhold Niebuhr, Michael Oakeshott, Vilfredo Pareto, Paul Piccone, Giuseppe Rensi, Giovanni Sartori, Carl Schmitt, Nicholas J. Spykman, Leo Strauss, Piet Tommissen, Gioacchino Volpe, Eric Voegelin, Max Weber et Simone Weil.
4) Ce dialogue est cité dans les livres de Jerónimo Molina, Julien Freund, lo político y la política, Madrid, Sequitur, 2000, Sébastien de la Touanne, Julien Freund, penseur « machiavélien » de la politique, Paris, L’Harmattan, 2005 et P.-A. Taguieff, Julien Freund. Au cœur du politique, Paris, La Table Ronde, 2008.
5) Gonzalo Fernández de la Mora, La partitocracia (La particratie), Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1977.
6) Entretien de Jules Monnerot avec Jean-José Marchand pour Les archives du XXe siècle de la Télévision française, 1988.
7) Par curiosité, j’ai exhumé les vieilles éditions des manuels d’Histoire des idées politiques de Touchard et de Prélot, que j’utilisais à la veille de ma soutenance de thèse de doctorat d’Etat, en 1975. Il n’y est fait mention ni de Monnerot, ni de Freund !