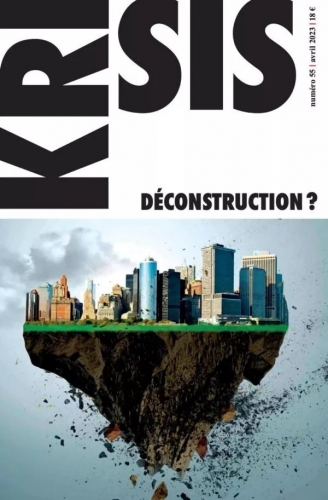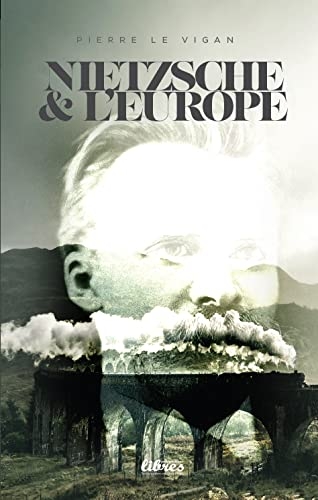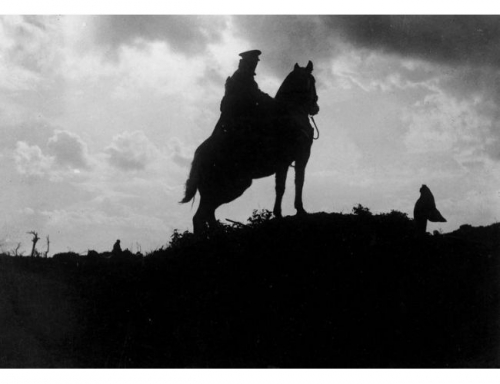Comprendre le fatum pour surmonter le nihilisme
L’homme est un animal réflexif. Il vit et se regarde en train de vivre. Il en est de même des peuples. Ils font leur histoire, mais ils ne savent que rarement l’histoire qu’ils font. Mais ils se regardent faire l’histoire. Celle-ci leur apparait comme destin. Ce qui est destin est ce qui a eu lieu. Ce n’est aucunement l’inéluctable. Mais ce n’est pas non plus un hasard. C’est pourquoi il nous faut toujours regarder notre destin comme quelque chose qui nous était échu. Il nous enseigne sur ce que nous fûmes et sur ce que nous sommes.
Le fatum, le destin, c’est l’acceptation de la vie comme porteuse de sens. Accepter le fatum, ce n’est pas être fataliste sur notre situation personnelle ou notre situation historique. Ce n’est pas être téléologique, et penser que les choses ne pouvaient pas être autrement. C’est être conscient qu’il y a un sens dans ce qu’elles ont été, peut-être une grandeur dans le malheur, et un malheur dans la grandeur (le fait que la Russie s’est trouvée amenée à dominer l’Europe de l’est durant plus de 40 ans, de 1945 à 1989 en est un bon exemple). C’est surtout savoir que si nous avons une liberté, cette liberté n’est pas sans limites, ni sans responsabilités. Voir et accepter les limites de notre propre liberté, c’est une force, car toute lucidité est une force. C’est pourquoi acquérir le sens du fatum n’est pas un renoncement à vivre et à agir. Le sens du fatum n’exclut pas de vouloir changer le cours des choses, le cours de nos vies, le cours de l’histoire.
Le fatum est d’abord le sentiment de l’unité du monde. Diogène Laerce (3ème s. av. JC) dit : « Dieu, l'Intellect, le Destin et Zeus ne font qu'un » (Vies et doctrines des philosophes illustres, VII, 135, Livre de poche / Classique, 1999). Il est ensuite, avec les stoïciens, le sentiment des causalités nécessaires pour que les choses adviennent, de l’interaction de toutes choses (ou encore principe de sympathie universelle), et du principe de non-contradiction qui régit le réel : une chose ne peut être et ne pas être. « Le destin est la somme de toutes les causes », résume Marc-Aurèle en une formule qui est celle du stoïcisme tardif, de plus en plus causaliste. Le fatum c’est l’acceptation que la volonté, et le caractère de chacun, puissent ne pas suffire à changer les choses et soi-même. Ce n’est pas le renoncement à essayer de forger son destin, à avoir des ambitions pour soi et les autres. Le sentiment du fatum n’est pas le nihilisme.
Qu’est-ce que le nihilisme ? C’est l’idée que rien ne vaut la peine de vouloir. Nietzsche distingue le nihilisme passif, qui constate que toutes les valeurs établies sont ruinées par leur propre imposture, et le nihilisme actif, qui veut sur cette table rase refonder par la seule volonté de nouvelles valeurs. « Je suis aussi une fatalité », écrit Nietzsche (Ecce Homo). Il écrit aussi dans une lettre à Georg Brandes, le 20 novembre 1888, à propos de l’Antéchrist : « - Mon "Inversion de toutes les valeurs", dont le titre principal est l'Antéchrist, est terminée ». C’est-à-dire qu’à la piété, Nietzsche a opposé la volonté, à la charité, il oppose la générosité, à la complaisance pour la faiblesse, il oppose l’admiration de la force. En d’autres termes, rien ne peut empêcher la volonté de l’homme, et certainement pas une autorité supra-humaine, de donner du sens au monde. Mais pour Nietzsche, toutes les donations de sens ne sont pas équivalentes. « Le mal suprême fait partie du bien suprême, mais le bien suprême, c'est le bien créateur. » (Ecce Homo, « Pourquoi je suis une fatalité »). Un mal aussi incontestable et profond que la guerre n’a t-il pas pu être vu comme « une revanche de l’enthousiasme orgiaque » par Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1988) ? La violence peut être nihiliste, mais, comme l’ont vu Michel Maffesoli et René Girard, elle peut aussi être fondatrice.
C’est assez signifier la question de l’ambiguïté de la volonté : la volonté peut tourner sur elle-même. Elle peut être pure « volonté de volonté » c’est-à-dire nihilisme actif, non au sens de Nietzsche (qui détruit pour reconstruire), mais au sens d’un nihilisme destructeur. De son coté, Léo Strauss avait bien montré que l’énergie nihiliste pouvait trouver l’un de ses aboutissements dans le nazisme (Nihilisme et politique, Rivages, 2000), en tant que ce dernier est héritier du positivisme (croyance scientiste au progrès) et de l’historicisme (croyance mystique en un âge d’or et millénarisme). Positivisme et historicisme millénariste : un cocktail explosif.
Après ce que Jan Patocka a justement appelé la « traversée de la mort » (Essais hérétiques, op. cit.), représentée par les heurs et malheurs, drames inouïes et désillusions du XXème siècle, se pose la question des fondements de la volonté. Vouloir, mais pour quoi faire ? L’énergie est un bien, mais il faut aussi l’appliquer à un bien. Le bilan de la traversée du XXème siècle est double. 1/ le nihilisme acharné, destructeur et radicalisé, le nihilisme qui dit que « puisque certaines choses sont fichues, que tout soit fichu ». 2/ le nihilisme « mou » qu’est la fatigue.
La « bonne fatigue » d’après le travail, celle qu’évoque Peter Handke (Essai sur la fatigue, Gallimard, 1991) doit, en effet, ici être opposée à une fatigue structurelle qui est une sorte de découragement, d’« à quoi-bon », d’acédie, selon Evagre et Cassien, et s. Thomas d’Aquin, qui précède même toute action, comme le dit Jean-Louis Chrétien (La fatigue, Minuit, 1996). C’est alors une grande fatigue de la volonté. Le découragement ou ce que Jacques Arènes et Nathalie Sarthou-Lajus appellent justement « La défaite de la volonté » (éponyme, Seuil, 2005), trouvent leur origine dans deux distorsions modernes du fatum, c’est-à-dire du destin.
La première distorsion est celle qui dit que le destin moderne est que tout est possible et que tout ce qui sera possible sera réalisé. A l’échelle des subjectivités individuelles, à qui il est requis d’être « inventif », « créatif » et même « récréatif », on conçoit qu’un gouffre d’angoisse et d’incertitude s’ouvre. Quelle place subsiste pour la volonté personnelle si un mouvement anonyme et irréversible – la technique – rend tout possible et toute possibilité inéluctable ?
La deuxième distorsion qui affecte la volonté et incline au découragement est la vision désenchantée et déterministe de la société. Si la reproduction sociale et culturelle est si fortement déterminée que le disent les sociologues tels Pierre Bourdieu, et si, en même temps, le destin est tout entier social, fait de conformité à la norme et d’intégration, quelle place y a t-il encore pour l’exercice de la volonté ?
L’illusion de la toute-puissance et l’illusion de l’impuissance se rejoignent ainsi pour décourager l’exercice de la volonté. La négation du manque comme constitutif de la vie des hommes remplace toute énergie pour chercher à combler une incomplétude. Soit on remplit un manque par un produit ou par une pratique – et c’est l’addiction – ou bien on s’enlise dans l’ennui. La recherche d’excitations et d’excitants aboutit à la perte de la présence à soi et de la présence aux autres, à l’incapacité de faire des expériences dans la durée, donc à avoir une réelle expérience de la vie. Nous sommes ici à l’opposé du précepte de James Joyce : « Ô vie, je vais pour la millionième fois à la rencontre de la réalité de l’expérience » (Dedalus).
L’hyperémotivité contemporaine et l’hypersensibilité nourrissent le narcissisme qui demande lui-même en retour des réassurances hyper-protectrices (cellules de soutien psychologique, etc). La volonté opiniâtre de continuer son chemin, quel qu’il soit, défaille. La société valorise la repentance plutôt que l’orgueil et la persévérance. On assiste ainsi à une déstabilisation des fondements de la volonté d’une part par le discours du bougisme, par un lent travail de sape de la longue durée de l’autre. L’instrument de ce dernier ? L’ennui. Or, l’ennui est le contraire de l’activation de la volonté, comme le montre Lars Fr. H. Svendsen (Petite philosophie de l’ennui, Fayard, 2003). C’est pourquoi entre le chagrin et le néant, ou entre le chagrin et l’ennui, certains - le mélancolique en l’occurrence – choisissent le chagrin (inguérissable de préférence).
Mais si la volonté du mélancolique est une vraie volonté, c’est une volonté triste. C’est une des passions tristes dont parle Spinoza. Une volonté sereine suppose un fatum sans fatalisme ni culpabilité. Selon Job (Livre de Job, 9, 28 : « Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent »), nul n’est innocent de ses maux. A défaut de trouver le responsable en soi-même, on peut toujours passer sa vie à chercher un coupable ailleurs. Il faut balayer ces âneries. Chercher un coupable, c’est justement là qu’est l’erreur. C’est là qu’est l’impasse. C’est le chemin du ressentiment, et c’est aussi le principe de nombre de pathologies.
Michel Houellebecq résume les temps modernes en indiquant en substance que nous avons gardé du christianisme la honte mais enlevé le salut, ou encore, gardé le péché mais enlevé la grâce (Les particules élémentaires). D’où le désarroi contemporain. Voire. La honte et le péché ne sont pas la même chose. La honte renvoie à l’honneur, le péché renvoie à la culpabilité, à la faute morale. Ne cherchons pas la morale dans un monde supralunaire. Nous n’avons nul besoin d’un salut éternel. Nous devons remplacer le sentiment du péché par celui de la honte, qui, quand elle survient, n’est autre que le sentiment de l’honneur perdu.
« Chacun est responsable de son choix, la divinité est hors de cause », écrit Platon (La République, livre X, 617, « le mythe d’Er le Pamphylien», Gallimard, 1993). Le choix (hairesis) de vie s’apparente toujours pour Platon à une partie de l’âme qui est la volonté. « Déclaration de la vierge Lachésis, fille de Nécessité. Âmes éphémères ! C'est le début pour une race mortelle d'un autre cycle porteur de mort. Ce n'est pas un "démon" qui vous tirera au sort, mais vous allez vous choisir vous-mêmes un "démon" (le démon des Grecs n’a pas un sens négatif mais désigne une semi-divinité entre le monde des dieux et celui des hommes- PLV). Que le premier que le sort désigne se choisisse le premier une vie à laquelle il sera uni par nécessité. Mais l'excellence n'a pas de maître ; selon qu'il lui accordera du prix ou ne lui en accordera pas, chacun en aura beaucoup ou peu. Celui qui choisit est seul en cause ; dieu est hors de cause. » (Platon, ibid.).
Toutefois, entre les choix et les conséquences des choix se glisse le hasard. C’est le clinamen d’Epicure. C’est une déviation dans la chute des atomes qui fait qu’ils ne tombent pas exactement où on les attend et que la vie nait de cette déviation, de cet écart entre l’attendu et l’inattendu. Le tragique du fatum, c’est cela, c’est l’incertitude du destin. Elle a de quoi faire peur. « La pensée du hasard est une pensée d’épouvante », indique Clément Rosset (Logique du pire, PUF, 1971). Mais l’homme est celui qui détermine, non pas le triomphe du Bien, mais sa forme, non pas le triomphe du Beau, mais encore sa forme.
L’homme ne détermine pas son destin, mais il donne à son destin un style. Si le fatum des Antiques est « ce qu’a annoncé l’oracle », l’histoire d’une vie est toujours celle d’une liberté. L’homme a toujours des libertés. L’amor fati est ainsi l’amour du monde compris comme liberté souterraine toujours cheminant sous les apparentes contraintes, comme liberté de s’ouvrir aux événements, au kaïros – au moment opportun. Le kaïros ne dépend pas de nous, mais le saisir ou pas dépend de nous.
Ainsi, avec Nietzsche, l’amor fati – l’amour du destin - constitue la voie même de la sortie du nihilisme, faisant d’Apollon « l’éminence grise » de Dionysos, comme dit Mathieu Kessler (L'esthétique de Nietzsche, P.U.F, 1998). « On ne soigne pas le destin », disait Cioran (La tentation d’exister). Il voulait dire : « On n’en guérit pas ». Mais il est toujours temps de lui donner un style et de se réveiller de toute servitude.
Pierre Le Vigan
Pour aller plus loin :
- Achever le nihilisme, de Pierre Le Vigan, Sigest, 2019.
- Face à l’addiction, de Pierre Le Vigan, La barque d’or, 2019.