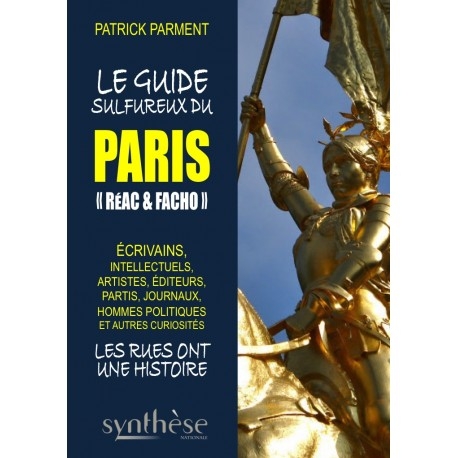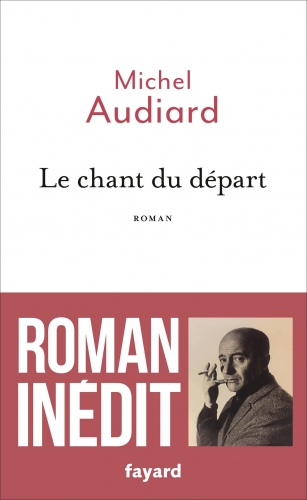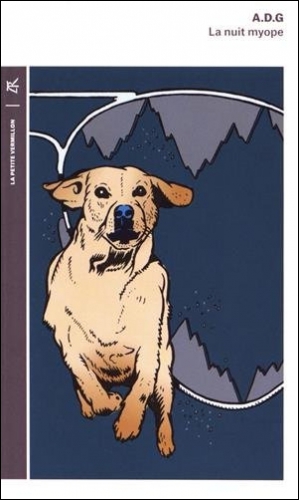Rue Ernest-Hemingway
Ouverte dans un quartier « rénové », la rue Ernest-Hemingway, dans le 15e arrondissement de Paris, est une de ces artères que l’ancienne langue française dirait « sans âme ». Le mot âme a disparu du vocabulaire courant, tout comme la connaissance de la langue française, sans laquelle il semble pourtant non seulement impossible d’écrire mais aussi de vivre, surtout dans une société qui se veut animée de l’idéal démocratique – la déchéance de la langue en la plupart de ses pavloviens locuteurs (y compris une grande partie des « élites ») étant donc le signe que la démocratie n’est qu’un fantasme ou une illusion dangereuse. La rue Ernest-Hemingway, que je longeais pour me rendre à l’hôpital Pompidou, lequel fait face aux bâtiments de la propagande étatique de France Télévisions, a été baptisée (je devrais plutôt dire nommée, pour ne point heurter nos « frères » mahométans) en l’honneur de l’écrivain qui a intitulé un de ses livres Paris est une fête.
Il y a longtemps que Paris n’est plus une fête ; que c’est même une des villes les plus sinistres du monde, ici figée dans la muséification et la prostitution touristique, là colonisée par des Africains et des musulmans, là encore livrée à la promotion immobilière la plus active, sans les audaces architecturales de Londres ; bref une ville mesquine, peuplée de gens souvent agressifs, incultes, hantés par le néant… On me dit que le titre de Hemingway est devenu une sorte de best-seller, en édition de poche, à la suite des attentats du 13 novembre, des bobos l’ayant élu pour viatique contre le fanatisme meurtrier de l’Etat islamique. La condition de best-seller ne signifie pas que le livre ait été lu : on reste, là, dans la contre-propagande, ou dans le vœu pieux, et ce livre n’a qu’une dimension symbolique, et non culturelle (au sens où Hemingway a, par exemple, pu avoir quelque influence sur les écrivains de ma génération, qui le découvraient à l’âge de 15 ans).
Le titre tentait de dresser un songe contre une réalité qu’on persiste à ignorer grandement, et qui n’est pas seulement le cancer multiculturaliste ni la guerre de cent ans que l’islam a engagée contre l’Occident, mais aussi la défaite de la lecture, acte majeur de la culture, pensais-je en gagnant le service de chirurgie thoracique, et songeant particulièrement à l’individu que je venais de croiser : un jeune type de race blanche, maigre, hâve, encapuchonnée, monté sur un vélo de louage probablement volé, faisant courir près de lui un pittbull sans laisse ni muselière, et vérifiant le truisme « tel maître tel chien » : mêmes regards vides dans des yeux écartés, mentons triangulaires de quasi sauriens, le chien et le maître aussi dégénérés l’un que l’autre, et me rappelant qu’un de ces animaux venait de tuer un enfant, en Alsace, je crois. La presse nationale tout entière a signalé que l’animal avait été euthanasié comme elle eût annoncé l’exécution d’un criminel dans une prison du Texas.
Un non-événement, sans doute destiné à produire un semblant de transcendance dans un système pénal enclin à la punition, non au châtiment. Ce que devient le maître du pittbull, on l’ignore, quoiqu’on se fût réjoui qu’il eût été euthanasié en même temps que l’animal. Le relativisme qui croît entre l’humain et l’animal, depuis que l’ « âme » n’existe plus, ne permet pas encore d’inverser les choses et de réclamer le même traitement pour l’homme et pour l’animal. Je viens d’un village où ce genre d’affaire se serait naturellement réglé à coups de fusil. Entre les deux positions, il y a donc l’euthanasie, pour les clebs comme pour les humains « en fin de vie ». Notre époque nous montre aussi que ces chiens hideux et malfaisants que sont les pittbulls, comme presque tous les canins, font à ce point partie de l’ « humanité » que les mœurs politiques et littéraires s’y modèlent. Le dégénéré qui promenait son chien à vélo est-il différent de tel politicard priapique ou de ce roquet universitaire qui m’englobe dans les « salauds » ? Non, et Paris n’est pas une fête, puisque presque personne n’a plus le goût de lire ; nous n’aimons pas d’ailleurs pas la fête telle que l’époque la vend et qui n’est qu’un instrument de propagande ; quant à la rue Hemingway, elle ressemblait, ce jour-là, non pas à ce Paris perdu évoqué par l’auteur de Pour qui sonne le glas, mais à un couloir de la mort : celle d’une ville et d’une nation dont les politicards et les djihadistes ne font qu’accélérer le processus de décomposition…
Richard Millet (Site officiel de Richard Millet, 14 mai 2016)

Une vue de la rue Ernest-Hemingway...