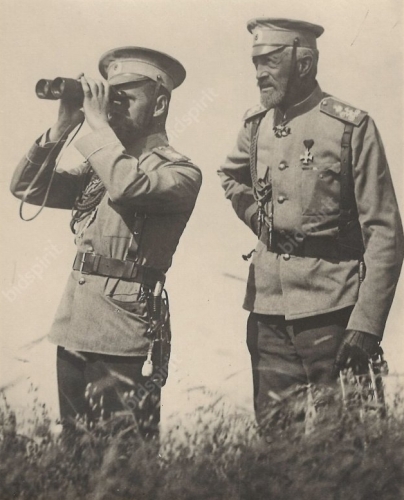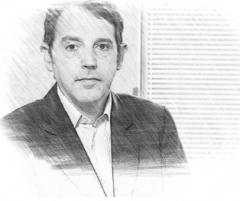Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Paul-Élie Aengler cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré aux sécessions adolescentes au sein du système éducatif de l'archipel français...

Sécessions adolescentes. Les nouveaux mutins de Panurge
S’il est un lieu où chacun peut observer les nombreuses et diverses sécessions qui traversent la France, c’est bien l’école. Tout professeur en a conscience : l’école n’est plus le moule civique et culturel qui « fabriquait » des Français. Bien au contraire, c’est désormais à l’institution scolaire et au savoir académique de s’adapter à « l’archipel français », pour reprendre l’expression de Jérôme Fourquet.
Dans toutes les salles de classe, les nouveaux clivages culturels et ethniques apparaissent aujourd’hui de manière évidente. Certes, cela fait longtemps que les sociologues analysent les différentes tribus adolescentes qui peuplent depuis Mai 68 les cours de récréations des collèges et des lycées : « gothiques », « geeks », « racailles », « rockeurs », autant d’affiliations possibles pour adolescents en quête d’une identité à la fois grégaire et rebelle. Ces clans formaient jadis un ensemble de contre-cultures opposées à la culture officielle condamnée depuis Bourdieu comme « bourgeoise » par toute une partie du corps enseignant lui-même. Pourtant, la situation actuelle offre aux yeux du professeur attentif quelques traits inédits.
Cultures et contre-cultures scolaires
C’est la culture classique qui n’existe plus, du moins en tant que culture de référence, que ce soit parmi les élèves ou dans le contenu des enseignements. À l’exception de quelques grands lycées de centres-villes, la plupart des élèves n’ont pas la moindre idée de son importance. Leur propre civilisation leur est désormais essentiellement étrangère, puisqu’elle est assimilée à une simple collection de vieilleries dénuées de sens : à quoi bon Molière ou Descartes alors que leur compréhension nécessite un effort que la tyrannie de l’immédiateté a aboli ? Tout converge vers une simplification de la langue. Ce phénomène explique l’effondrement de la maîtrise de la langue française, mère de toutes les sécessions scolaires. À cet égard, on peut se reporter au précieux réquisitoire du professeur René Chiche dans La désinstruction nationale (2019, Ovadia). Celui-ci a le courage de parler de « quasi-illettrisme » pour désigner cette implosion de la langue commune constatée lors de la correction de centaines de copies du baccalauréat « écrites en un charabia qui emprunte vaguement au français comme à une langue étrangère ».
Quant aux professeurs, soit ils ne connaissent plus cette culture de référence, soit ils en ont honte ou sont forcés de s’avouer vaincus par l’esprit du temps : l’autocensure et la simplification du savoir triomphent, fût-ce au prix d’un énième renoncement. Certes, il y a encore quelques chaînes de transmission qui fonctionnent, quelques élèves attentifs à ce legs du passé, mais ces élèves ne font que survivre dans un univers désormais hostile à l’idée d’une hiérarchie culturelle. C’est la grande bascule : l’ancienne culture de référence est devenue une contre-culture minoritaire à l’école, un des nombreux ilots de l’archipel scolaire – et ce parmi les élèves et les professeurs. Voilà la première condition de la sécession, lorsque la norme devient l’exception et l’exception la norme.
Parmi toutes ces contre-cultures qui se font face, n’y en-a-t-il aucune qui ne tende alors à dominer les autres ? Il serait naïf de ne pas le croire, car la nature a horreur du vide. Dans la plupart des établissements, l’évolution démographique a tranché : c’est désormais l’Islam, même mal connu et parce que mal connu, ainsi que la culture rap qui dominent les mentalités. Concernant l’Islam, la plupart des élèves accordent à la religion musulmane le prestige que la catholique assumait jadis : dans les cours de biologie et de philosophie, la nouvelle norme du sacré est bien islamique. Combien de professeurs ont-ils affronté l’incrédulité généralisée concernant l’évolutionnisme ? Et parce qu’authentiquement sacrée aux yeux de la plupart des élèves, musulmans ou non, c’est une norme avec laquelle il faut nécessairement composer, en tant qu’élève dans la cour de récréation et en tant que professeur dans la salle de classe.
Sur le Coran, ma mère !
Le cours de philosophie sur la religion se résume souvent à un défi insurmontable. Impossible de rester dans le cadre théologique chrétien, pourtant parfaitement acclimaté à la rationalité grecque, puisque ces références sembleraient exclure les élèves de confession musulmane et que tous les élèves, non-musulmans compris, trouveraient à y redire. Impossible également de discuter des dogmes et textes musulmans, puisque le professeur oserait s’immiscer dans la sphère du sacré partagée par la plupart des élèves : la nouvelle bigoterie est d’origine coranique mais intériorisée par tous. Les « wallah » et « sur le Coran » constituent d’ailleurs la trame de fond des récréations comme des interclasses. Plus étonnant, les enseignants découvrent à quel point certains élèves chrétiens en minorité revendiquent avec fierté la pratique du carême, copiant inconsciemment celle d’un ramadan devenu prépondérant dans de nombreux établissements. C’est donc la déférence vis-à-vis de l’Islam qui sert de référence commune de remplacement.
Concernant la culture rap, qu’il est désormais absurde de qualifier de « contre » culture, son hégémonie est incontestable, y compris dans les lycées plus bourgeois où le survêtement et le rap ont depuis quelques années écrasé la concurrence. Les paroles et l’imaginaire de ce genre musical lui octroient désormais le monopole de la subversion, de la véhémence et de la virilité. La victoire est donc revenue à la tribu la plus agressive. Mais dans les lycées périphériques, exhiber cette obédience n’est pas seulement un signe de bon goût adolescent, c’est surtout un moyen d’intégration, voire de survie sociale. Pour les garçons, adopter les codes sociaux du groupe dominant laisse espérer une immunité contre le harcèlement. Les filles elles-mêmes ne s’y trompent pas : adopter les codes de la « rue » est un mécanisme de défense fort efficace pour se faire respecter.
La colonie de nos colonies
Évidemment, cette nouvelle culture dominante à mi-chemin entre la Mecque et les États-Unis a un même terreau : l’immigration massive des dernières décennies. « La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur », disait Horace (Épîtres, II) : par l’un de ces retournements dialectiques dont l’histoire a le secret, les descendants des populations anciennement colonisées imposent désormais consciemment et inconsciemment leur spiritualité et leur esthétique aux autochtones qui se doivent de faire allégeance. Le nomadisme identitaire a remplacé la culture sédentaire anciennement majoritaire, puisqu’il est désormais honteux de ne pas avoir d’origines : quand on est un « petit Blanc », on en vient à déterrer des aïeuls italiens ou polonais pour cultiver son extraterritorialité.
Ainsi, à l’école, les minorités devenues majoritaires sont maintenant capables de tyranniser la majorité devenue minoritaire. Cette matrice sécessionniste à laquelle tout le monde semble se résigner a de nombreuses répercussions, y compris pour les rares familles qui semblent encore y échapper : contournement de la carte scolaire, établissements privés, cours particuliers. C’est alors le tribalisme multilatéral qui surgit pour compenser la désaffiliation culturelle, ainsi que le notait déjà Michel Maffesoli dans Le temps des tribus (1988) : « Le tribalisme rappelle l’importance du sentiment d’appartenance à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel de toute vie sociale. » Et dans les lycées lambda, les tribus adolescentes sont en passe d’être submergées par la plus prosélyte et la plus féconde d’entre elles. Au monde de Michel Maffesoli, répond ainsi celui de Philippe Muray, matons et mutins de Panurge.
L’école et le monde de demain ne seront pas le paradis de l’intersectionnalité mais l’enfer de l’incommensurabilité : un espace conflictuel sans culture véritable, c’est-à-dire sans commune mesure capable de transcender les tribus particulières.
Paul-Élie Aengler (Site de la revue Éléments, 11 octobre 2022)