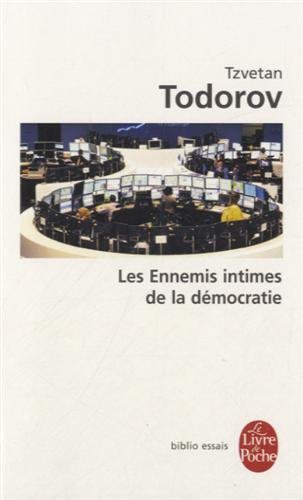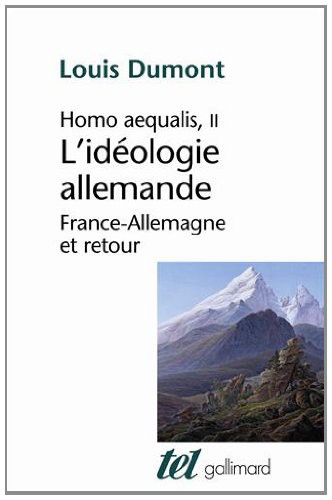Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Arnaud Imatz, cueilli sur le site du Cercle Aristote et consacré au rôle délétère de l'oligarchie et de son idéologie mondialiste...

L'oligarchie mondialiste, fléau de l'Amérique et de l'Europe
Lorsqu’on vit depuis des années à l’étranger un sujet régulier d’étonnement est le mélange de répulsion-fascination que suscitent les États-Unis dans les grands médias de l’Hexagone. Certes, il ne s’agit pas d’une nouveauté. La généalogie de l’américanophobie et de l’américanophilie est bien établie. Les historiens la font remonter au XVIIIe siècle. Mais l’ampleur du parti pris journalistique à l’heure de traiter l’information sur l’ami-ennemi américain, est proprement sidérante. Le matraquage « obamaniaque », à l’automne 2012, quelques jours avant les élections présidentielles, n’en est qu’un exemple criant. Le message était d’un simplicité enfantine : il y avait d’une part, Barack Obama, le « bon », le réformateur, le « créateur » du système de protection sociale, et, d’autre part, Mitt Romney, le « méchant », le réactionnaire-opportuniste, le mormon milliardaire, le capitaliste va-t-en-guerre. Oubliée la loi de protection de la santé adoptée par l’État du Massachusetts, en 2006, sous l’impulsion du gouverneur Romney. Oubliées les interventions répétées de l’armée américaine sous les ordres du président démocrate sortant, les attaques de drones qui violaient le droit international (10 fois plus nombreuses que sous Bush Jr.) en particulier au Pakistan et au Yemen, l’envoi de 33000 hommes en Afghanistan, l’intervention en Lybie… En démocratie, disait le théoricien des relations internationales, Hans Morgenthau, « la propagande est inévitable, elle est un instrument de la politique », et son contrôle ne peut être qu’un travail de Pénélope. On ne supprime pas la propagande, pas plus qu’on n’élimine la conflictivité, au mieux, on la minimise.
En attendant le prochain déferlement de passion, il n’est peut être pas inutile de s’interroger sereinement sur l’hyperpuissance mondiale, sur son oligarchie et son peuple. Que penser de « l’Amérique et des Américains » ? Vaste question ! J’entends déjà mes amis d’Amérique hispanique s’insurger avec raison : « Ne vivons-nous pas en Amérique ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, des Américains ? ». Mais passons. Faute d’espace, et à défaut d’analyses rigoureuses, voici quelques sentiments, opinions et pistes de réflexion.
Fonctionnaire international à l’OCDE, émanation du célèbre Plan Marshall, j’ai eu la chance de travailler dans l’entourage immédiat du Secrétaire général et de côtoyer moult ambassadeurs et hauts fonctionnaires d’Amérique du Nord et d’Europe. Par la suite, fondateur et administrateur d’entreprise, j’ai entretenu des relations suivies avec un bon nombre de cadres d’universités et d’hommes d’affaires des États-Unis et du Canada. Une expérience restreinte, limitée à la classe directoriale et aux milieux urbains (après plus de trente voyages je reste avec l’envie d’admirer un jour les grands espaces !), mais néanmoins une connaissance directe, tirée de situations vécues pendant trois décennies. Disons le tout de suite, l’image qui en ressort est nuancée, voire ambigüe. Un peuple jeune, dynamique, agressif, violent, sans racines, né de la fusion d’apports les plus divers, a-t-on coutume de répéter. Je dirai pour ma part que les Américains du Nord sont généralement des gens aimables, ouverts, spontanés, simples, sympathiques et très « professionnels ». Ils méritent en cela considération et respect. La cuistrerie, le pédantisme, la suffisance, l’arrogance, le ressentiment, l’esprit de caste et la manie de la hiérarchisation reposant sur les écoles, les titres et les diplômes, ces plaies sociales de notre vieux continent, omniprésentes dans la pseudo-élite française, qu’elle soit intellectuelle, politique ou économique, sont nettement moins répandus outre-Atlantique. À tout prendre, je préfère d’ailleurs l’amabilité commerciale, pourtant très artificielle, du diplômé de Yale, Harvard ou Stanford à la fatuité et la présomption de tant d’énarques, de polytechniciens voire de docteurs d’État de l’Hexagone.
J’admire sans réserves l’attachement, presque indéfectible, du peuple américain au premier amendement de sa Constitution : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ». Je sais bien sûr l’aptitude des juristes à réinterpréter un texte constitutionnel, parfois même dans un sens absolument contraire à l’esprit des pères fondateurs, afin de satisfaire les intérêts de la classe politique ou de répondre à ses injonctions. Je ne suis pas non plus naïf au point de croire que cette fidélité au Bill of Rights est appelée à perdurer éternellement sans aucune faille. Mais à ce jour, malgré les accrocs et les accusations répétées de violations, le principe et son application me semblent résister. Et ce n’est pas rien ! Il suffit de comparer la situation états-unienne avec celle de la France pour s’en convaincre. Une loi mémorielle, qui imposerait le point de vue officiel de l’État sur des faits historiques, est tout-à fait inconcevable aux États-Unis.
J’admire aussi évidemment les découvertes scientifiques et surtout techniques de cette grande nation. Il faudrait d’ailleurs être dépourvu de raison et de cœur pour les ignorer. Je fais en outre le plus grand cas de la littérature nord-américaine. Qui oserait prétendre qu’elle n’a pas souvent atteint les plus hauts sommets ? Même le cinéma hollywoodien ne me semble pas aussi médiocre qu’on le prétend. Quantitativement pitoyable, soit ! Mais il réalise chaque année de véritables chefs d’œuvres. Peut être 1 % de la production, qui a toujours rivalisé en nombre et en qualité avec le meilleur du cinéma européen et qui, depuis déjà près de trente ans et à l’exclusion de quelques rarissimes exceptions, distance ce dernier de très loin. Enfin, dans le domaine qui m’est le plus familier, l’histoire des faits et des idées et les sciences politiques, j’ai la ferme conviction qu’au tournant du XXIème siècle, les travaux d’auteurs aussi différents que Christopher Lasch, Paul Gottfried, Robert Nisbet, John Lukacs ou Paul Piconne, égalent, et parfois dépassent, ceux de n’importe quelle figure intellectuelle européenne.
Les codes de la nouvelle classe dirigeante américaine
Cela-dit, il y a plus d’une ombre au tableau. Après avoir longtemps structuré la nation nord-américaine, la pensée et le mode de vie des WASP (White Anglo-Saxon Protestant) ont fait long feu. Le puritain, animé par l’idéal abstrait de renoncement personnel et de perfectionnement de soi, l’homme pieux, pour qui la réussite personnelle est secondaire par rapport à l’œuvre sociale, relève du souvenir lointain. Mort !, l’individualiste farouche d’antan, le cow-boy tenté par l’aventure de la vie sauvage. Enterré !, le « self made man », l’archétype du vieux rêve américain, cet être loyal, solidaire, zélé au travail, autodiscipliné, modéré, épargnant, refusant de s’endetter. Il y a belle lurette que la majorité de la société américaine n’accorde plus d’intérêt à ces valeurs et idéaux.
En cinquante ans, les « codes » de l’élite politico-économico-médiatique « américaine » ont changé considérablement. Le style de vie de la classe directoriale est désormais marqué par l’anomie, le manque de racine, l’anxiété, le changement perpétuel, l’incertitude, le narcissisme, la hantise du « standing », l’obsession de la bonne santé physique, l’assujettissement à la consommation de la marchandise, la complaisance pour les hétérodoxies sexuelles, le mépris des traditions populaires jugées trop « réactionnaires », l’asservissement à la tyrannie de la mode, la fascination pour le marché capitaliste, l’admiration des formes de propriété anonyme, la recherche frénétique du profit, le culte passionné de l’accomplissement personnel, de la performance, du spectacle, de la réussite et de la célébrité.
Ostensiblement égalitaire, antiautoritaire, cosmopolite, communautarienne et multiculturaliste, la nouvelle classe dominante se distingue par ses revenus et son train de vie élevés. Elle tourne le dos à la question sociale et au peuple, mais fait le plus grand cas des questions de société telles que la lutte contre l’homophobie, le mariage gay, l’aide à la famille mononucléaire et monoparentale, le soutien de la pratique des mères porteuses, l’enseignement de l’idéologie du genre, la dépénalisation des drogues « douces », l’éloge de la discrimination positive en faveur des minorités ethno-religieuses, etc. Parmi ses membres, se recrutent les adeptes les plus fervents de la libre circulation des marchandises et des personnes. Ils sont les zélateurs du libre-échange et de l’immigration illimités. « Vivre pour soi-même et non pour ses ancêtres et sa postérité » ou « Avant moi le néant après moi le déluge » pourrait-être leur devise. Le conformisme « progressiste », la hantise des « valeurs périmées et dépassées », masque chez eux la diligence empressée à l’égard d’un nouvel ordre social banalisé, une domination reformulée, un contrôle social remodelé.
Si vous devez négocier avec le représentant d’une grande entreprise ou d’une quelconque bureaucratie publique ou privée, avec un « CEO » (PDG) ou un haut fonctionnaire fédéral et ses conseillers, attendez-vous à toutes les chausse-trapes. Mensonge, félonie, dol, boniment, duplicité, sont permis. La fin justifie les moyens. On me dira bien sûr que j’ai tort de mettre en cause l’ensemble de cette « élite » ou plutôt « pseudo-élite », qu’il est faux de laisser entendre que tout le milieu est à l’image de quelques uns, que c’est ignorer la complexité de la nature humaine, pire, que c’est faire le jeu du « populisme » démagogique. Je ne nie pas qu’il y ait des exceptions remarquables, mais malheureusement, après des décennies d’expérience, je reste dans l’expectative de les rencontrer. La réalité, évidemment contestée par les intéressés, est que la lâcheté, l’hypocrisie et l’opportunisme sont omniprésents parmi eux. Que pourrait-on d’ailleurs attendre d’autre de la part d’experts en communication, de spécialistes de la désinformation, de la manipulation, de la séduction et de l’impression produite sur les autres ? Exit donc l’idéal de la vieille culture américaine, celui du devoir et de la loyauté. La culture dominante des pseudo-élites modernes états-uniennes est résolument hédoniste, individualiste et permissive.
Un modèle vénéré par les « élites » européennes de droite comme de gauche
Je me refuse pour autant à reprocher à l’Amérique ou aux Américains du Nord les attitudes d’une caste interlope ou les défauts d’un modèle de société que la majorité de nos oligarques européens développe et vénère au quotidien. Dans le cœur et l’esprit de ces derniers, l’identité culturelle n’est-elle pas aussi ostensiblement remplacée par l’exaltation de la croissance du PNB, la glorification de l’accès massif à la consommation, la volonté d’étendre le mode de vie occidental au reste du monde, l’espoir fou que le développement des forces de production peut se perpétuer partout indéfiniment sans déclencher de terribles catastrophes écologiques ? Les « valeurs universelles », les « droits de l’homme » ne sont-ils pas sacralisés par la classe dirigeante européenne qui magnifie elle aussi la croisade démocratique mondiale et méprise souverainement les circonstances historico-culturelles données ? Le discours /récit des grands médias européens n’a-t-il pas lui aussi pour fonction de revêtir les aspirations et les intérêts matériels des nations « occidentales » sous l’apparence d’objectifs moraux universels ?
Nul n’en disconviendra, les États-Unis occupent une place exceptionnelle sur la scène internationale. Ils sont les détenteurs du leadership mondial. Ils sont la superpuissance, l’hyperpuissance ou l’Empire (terme le plus exact, bien qu’il soit généralement évité pour prévenir l’accusation d’antiaméricanisme). Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se voulaient le fer de lance de l’anticolonialisme, mais en réalité, leurs interventions dans le monde pour défendre leurs intérêts se comptent par milliers depuis le XIXe siècle. Pour le seul cas de l’Ibéro-Amérique, on n’en compte pas moins de 50 majeures et 700 mineures. L’application historique de la doctrine Monroe (1823) a montré que la devise « L’Amérique aux Américains » signifiait en réalité « L’Amérique aux Américains du Nord ».
Dans la phase actuelle de recomposition des pôles politico-économico-culturels mondiaux, l’Empire thalassocratique perd de l’influence, mais il n’en conserve pas moins une position hégémonique. Au tournant du XXIe siècle, aucune puissance émergente n’est en mesure de surpasser les États-Unis. Ils produisent un peu moins du quart de la richesse mondiale, peuvent exploiter de fabuleux gisements de gaz de schiste et disposent d’une force militaire écrasante. Leur décadence, leur déclin, est semble-t-il inéluctable, mais la chute peut être ralentie durablement.
L’hybris états-unienne, la démesure dictée par l’orgueil des pseudo-élites nord-américaines, constitue néanmoins un redoutable danger pour la stabilité de la planète. La guerre économique, dont ils sont un fauteur majeur depuis plusieurs décennies, est une réalité planétaire. La guerre du pétrole et du gaz n’en est qu’un des aspects les plus criants. Nier ou ignorer tout ce qui est en jeu : le contrôle des réserves énergétiques et agroalimentaires mondiales, la domination de l’information, des communications, de l’intelligence civile et militaire, est le signe de l’aveuglement, de l’incompétence ou de la trahison.
Mais cela dit, l’honnêteté intellectuelle impose de souligner la complicité active ou la collaboration bienveillante dont bénéficie la nouvelle classe dirigeante américaine en Europe, sans oublier le rôle très discutable et la marge d’action considérable des managers des multinationales. Patriotes ou nationalistes sans complexes, les présidents Américains, démocrates ou républicains, nous répètent à l’envi que le peuple des États-Unis est « élu et prédestiné », que « le destin de la nation américaine est inséparable du Progrès, de la Science, de l’intérêt de l’Humanité et de la volonté de Dieu », mais c’est bien l’hyperclasse mondiale dans son ensemble qui reprend à l’unisson : « L’histoire des États-Unis d’Amérique se confond avec celle de la liberté, de la prospérité, de la démocratie et de la civilisation ».
L’espoir d’une recomposition et d’une relève politique
Que les choses soient claires : « l’Amérique » ou les Américains du Nord ne sauraient être tenus pour l’adversaire principal. L’adversaire est en nous, il est chez nous. L’adversaire, c’est l’idéologie mortifère de la pseudo-élite de gauche comme de droite ; c’est celle des leaders et apparatchiks (non pas des militants et sympathisants) des principaux partis européens au pouvoir, néo-sociaux-démocrates et néolibéraux, si proches des sociaux-libéraux du parti démocrate et des néoconservateurs du parti républicain d’outre-Atlantique ; c’est celle des maîtres de la finance mondiale et de leurs affidés médiatiques gardiens jaloux du politiquement correct ; c’est celle des « intellectuels organiques », contempteurs inlassables du populisme démagogique. Ce populisme, qui, selon eux, mettrait en cause dangereusement la démocratie, alors que, malgré d’inévitables dérapages, il est le cri du peuple, la protestation contre un déficit de participation, l’appel angoissé à la résistance identitaire, à la restauration du lien social, à la convivialité ou à la sociabilité partagée. L’adversaire, c’est bien l’idéologie des néolibéraux et des néo-sociaux-démocrates, et celle de leurs « idiots utiles », les altermondialistes, qui, à leur manière, rêvent de parfaire la transnationalisation des personnes et l’homogénéisation des cultures.
Soulignons-le encore : le combat culturel ne se livre pas entre l’Europe et l’Amérique du Nord, mais entre deux traditions culturelles qui se déchirent au sein de la modernité. L’une, aujourd’hui minoritaire, est celle de l’humanisme civique ou de la République vertueuse, qui considère l’homme d’abord comme un citoyen qui a des devoirs envers la communauté, et qui conçoit la liberté comme positive ou participative. L’autre, majoritaire, est celle du droit naturel sécularisé, de la liberté strictement négative entendue comme le domaine dans lequel l’homme peut agir sans être gêné par les autres. L’une revendique le bien commun, la cohérence identitaire, l’enracinement historico-culturel (national, régional et grand continental), la souveraineté populaire, l’émancipation des peuples et la création d’un monde multipolaire ; l’autre célèbre l’humanisme individualiste, l’hédonisme matérialiste, l’indétermination, le changement, l’homogénéisation consumériste, l’État managérial et la « gouvernance » mondiale, sous la double bannière du multiculturalisme et du productivisme néo-capitaliste.
Pour les tenants du « Républicanisme » ou de l’humanisme civique, les néolibéraux, néo-sociaux-démocrates et altermondialistes sont incapables d’engendrer un attachement solide au bien commun. Ils savent que le principal danger de la démocratie vient d’une érosion de ses fondements spirituels, culturels et psychologiques. Avec Aristote, Montesquieu, Rousseau, Jefferson, et tant d’autres, ils reconnaissent que la démocratie est impossible sans un territoire limité et un degré élevé d’homogénéité ou de cohésion socioculturelle. Ils savent qu’il n’y a pas un seul modèle de libre marché, le capitalisme dérégulateur anglo-saxon, et que des légions de défenseurs du libre marché se sont opposés au système de laisser-faire et de marchandisation globale. Ils savent que depuis les pionniers de l’économie politique de l’École de Salamanque au XVIème siècle, jusqu’aux théoriciens de l’ordolibéralisme de l’après-Deuxième-Guerre mondiale, en passant par les non-conformistes des années 1930, de très nombreux et prestigieux économistes considèrent que le libre marché doit dépendre de la politique, de l’éthique et de la morale.
Les partisans d’une troisième voie moderne (laquelle ne se confond pas avec les versions décaféinées de Clinton, Blair ou Bayrou), défendent le principe de la petite et moyenne propriété (individuelle, familiale et syndicale) des moyens de production coexistant avec de plus grandes formes de propriété rigoureusement réglementées dans le cadre d’une économie régionale autocentrée. Ils se dressent contre le capitalisme monopolistique et financier, contre les processus de concentration du grand marché néolibéral, contre le collectivisme socialo-communiste, contre toutes les formes de bureaucratisations publiques et privées. Ils considèrent que le protectionnisme entre ensembles régionaux homogènes (non pas entre pays) aux niveaux de vie très différents, est non seulement justifié, mais nécessaire. Enfin, ils accordent une priorité absolue aux mesures de politique démographique et au contrôle de l’immigration qui sont d’une importance vitale pour la survie de l’identité culturelle, de la sécurité et du progrès économique et social.
Depuis près de 40 ans, à droite comme à gauche, le lobby immigrationniste occupe une position dominante. Pour ne pas être diabolisées, les rares voix discordantes des partis majoritaires ont été contraintes au silence ou à manier la litote. Après avoir défendu « la limitation de l’immigration » et plaidé pour « la réduction de l’immigration clandestine », elles ont fini par soutenir du bout des lèvres « l’immigration choisie ». Mais au fil du temps, malgré les efforts désespérés de l’oligarchie « discuteuse » en faveur d’une main-d’œuvre afro-maghrébine abondante et bon marché, une partie croissante de l’opinion a décroché. Les complaisances d’usage pour « l’islamisme pluriel et pacifique », des esprits affaiblis, tétanisés par la peur du conflit, ne font plus recette. Les arguties, les insultes et les réactions passionnées des Fukuyama, Morin, Lévy, Touraine, Habermas et autres gardiens jaloux du temple se révèlent de plus en plus inefficaces. L’influence sur l’opinion du discours politique de l’oligarchie dominante ne cesse de décroître. La bipolarisation droite-gauche, sacralisée par les élites politiques et leurs soutiens que sont les bobos des grandes villes, les fonctionnaires et les retraités, ne correspond plus à rien pour les classes populaires. Ouvriers, employés, petits agriculteurs et petits commerçants prennent conscience que les prétendues « valeurs républicaines ou démocratiques », réduites aux seuls droits de l’homme, signifient en réalité les valeurs du grand marché. Ils ne croient plus à la vieille rengaine : « la mondialisation bénéficie à tous », « l’immigration est une chance » ou « il n’y a pas trop d’immigrés ». Ils savent qu’ils sont au contraire et resteront irrémédiablement les exclus du mondialisme et du multiculturalisme. Par ailleurs, un bon nombre de jeunes se rebellent. Pour perdurer, l’oligarchie doit en tenir compte malgré les vœux et les cris d’Orphée que poussent encore ses membres les plus dogmatiques.
« Toute vérité franchit trois étapes, disait fort justement Arthur Schopenhauer. D’abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subitune forte opposition. Puis, elleest considéréecomme ayant toujours étéuneévidence ». C’est un honneur que d’aller contre les modes, les interdits, le « politiquement correct » de son temps ; que de refuser le chemin de la servitude, du totalitarisme de l’argent et du magma mondialiste. C’est un honneur que de s’inscrire dans la filiation des Charles Péguy, Miguel de Unamuno, Daniel-Rops, Georges Bernanos, Simone Weil, Wilhelm Röpke, Julien Freund, Jules Monnerot, Christopher Lasch, Maurice Allais et tant d’autres résistants au fléau de l’oligarchie mondialiste. Notre Europe n’a jamais été celle des disciples de Jean Monnet, celle des multinationales, sous la tutelle définitive des États-Unis d’Amérique, « l’Europe où, comme disait Charles de Gaulle, chaque pays perdrait son âme ». Notre Europe est celle du meilleur gaullisme, celle des peuples, celle de la « troisième force », celle de l’axe grand-continental ou grand-européen.
Arnaud Imatz (Cercle Aristote, 28 octobre 2013)