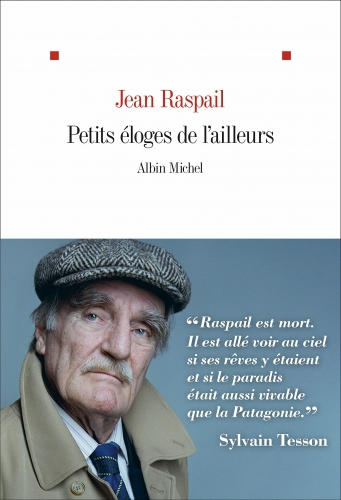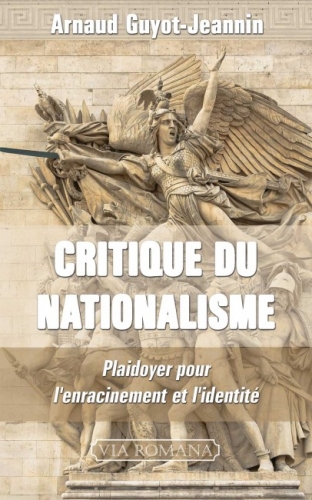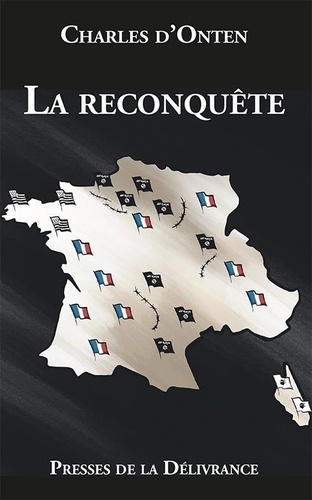Identité civique, identité ethnique
Jean-Yves Le Gallou évoque, dans l’Avant-Propos de votre livre L’identité, socle de la Cité, le « retour de balancier » qui viendrait contrecarrer la domination, fastidieuse et arrogante, des épigones de la démocratie libérale et mondialiste. Vous prônez l’organisation d’une avant-garde. Le stade de l’avant-garde n’est pas celui du retour de balancier : il y travaille, le prépare, sans avoir encore les moyens de restaurer l’équilibre. À quel moment nous trouvons-nous de la prise de conscience de la mutilation de nos identités, et par conséquent de notre vie sociale ?
Nous vivons une crise sans précédent, caractérisée par l’ébranlement des fondements anthropologiques de notre civilisation. L’histoire semble s’accélérer de manière vertigineuse, atteignant le point névralgique où se produit la « fin d’un monde », pour reprendre le titre du dernier livre de Patrick Buisson.
L’effondrement de la « maison commune » paraît imminent – phénomène qui surprend naturellement ceux qui persistent à s’aveugler sur le degré de solidité du vieil édifice. Pour les adeptes de la religion du progrès comme pour le « déclinistes », cette évolution s’inscrit dans le sens de l’histoire. Elle mène à l’instauration d’un nouveau monde qui ressemblera, pour le meilleur ou pour le pire, à celui qu’imaginent les sages de Davos. Telle n’est pas ma vision. Rien n’est écrit : ce nouveau monde sera ce que nous en ferons. C’est là qu’intervient la notion d’avant-garde, capable d’amorcer ce retour de balancier évoqué par Jean-Yves Le Gallou. Osons le dire : la question n’est plus celle des moyens nécessaires pour éviter une catastrophe dont le mécanisme se trouve déjà enclenché. Il s’agit en vérité de savoir comment nous traverserons cette épreuve, afin d’en sortir plus forts.
« L’âme d’une nation ne se conserve pas sans un collège chargé de la garder », nous dit Renan. Tel est le rôle de l’avant-garde que nous devons former, en nous engageant dans la voie d’une véritable « révolution conservatrice ». Le mot de révolution ne renvoie pas ici à une entreprise de destruction. D’autres, hélas, se sont chargés de cette sinistre besogne. J’emploie le terme révolution au sens premier, pour désigner le mouvement de retour à l’origine qui se produit nécessairement à la fin d’un cycle, avant toute renaissance. Cet élan est conservateur, dans la mesure où il préserve le principe même de notre civilisation. Celui-ci ne réside pas dans des formes figées et périmées, mais dans la force vitale, dans le feu sacré qui brûle encore dans nos âmes. Pour entretenir cette flamme, il importe de procéder à ce que Renan appelait une « réforme intellectuelle et morale ».
Le premier courage est celui de la lucidité. Sachons dresser un constat réaliste de l’état de la Cité. Le lien entre identité civique et identité ethnique est aujourd’hui rompu. Cette rupture s’est d’abord produite sur le plan symbolique et institutionnel, lors de la Révolution française, sans altérer d’emblée l’identité ethnoculturelle de la population. Un changement beaucoup plus radical s’est produit au cours de ces quarante dernières années, avec les vagues migratoires massives qui sont venu bouleverser nos équilibres démographiques plurimillénaires. Dans une certaine mesure, la première étape a préparé la seconde et l’a rendu possible. En coupant le lien qui unissait les institutions à la patrie charnelle, en instaurant une définition purement idéologique et contractuelle de la citoyenneté, le système républicain a directement contribué à briser nos défenses immunitaires. Il a créé une fragilité que nous avons longtemps pu ignorer, mais qui prend les proportions d’une faille béante lorsque survient le choc des grandes vagues migratoires. Confrontés à cette situation inédite, certains poursuivent désormais une sorte de fuite en avant. Ils continuent de chanter les louanges de la « diversité », ou de proclamer l’impérieuse nécessité du « vivre ensemble ». D’autres placent leur espoir dans l’hypothétique recours à une politique d’assimilation, sans doute possible au niveau individuel, mais parfaitement inopérante à l’échelle des millions d’êtres humains qui ont pénétré dans notre espace civilisationnel en l’espace de quelques décennies. Ces postures sont intenables, car elles conduisent à entériner une modification radicale de la substance des peuples européens, voués au déracinement sur leur propre terre.
Ne nous y trompons pas : cette situation n’est que la conséquence de notre déclin civilisationnel, elle n’en est pas la cause. Jamais l’Europe n’eut été submergée par de telles vagues migratoires, si le traumatisme des deux Guerres mondiales n’avait auparavant plongé les Européens dans un état de complète sidération et d’oubli d’eux-mêmes. Le triomphe du modèle occidental libéral, matérialiste et universaliste, a effacé la « longue mémoire » de nos peuples au profit d’une mémoire sélective, orientée vers ce qui les nie et détruit leur âme.
À l’instar de Renan, il ne faut pas se satisfaire du constat, mais proposer des remèdes. La seule issue possible est celle de la réaffirmation de notre identité. Ceci passe par une réflexion fondamentale sur « ce que nous sommes », réflexion que j’ai esquissée dans ce livre.
Ernest Renan et son incontournable conférence de 1882, « Qu’est qu’une Nation », ne pouvaient être absents de votre ouvrage. Vous rappelez la volonté française, après l’humiliante défaite de 1870, de contester la conception allemande de la Nation, telle que Fichte la développa au début XIXe siècle. Dans son ouvrage « De la France d’abord à la France seule ; l’Action Française face au national-socialisme et au troisième Reich », Michel Grunewald écrit ( p52) : « Jacques Bainville soulignait que le nationalisme d’outre-Rhin se distingue de tous les autres du fait d’une particularité qui le rendait dangereux pour le reste de l’Univers : “il déborde ses frontières parce qu’il ne les connait pas” ». Illimitation des prétentions universelles dans la conception française de la nation (quoique vous montriez que le discours de Renan est à la fois plus profond et plus subtil que cela), illimitation de l’expansion territoriale permise par la conception de la nation allemande héritée de Fichte, certes ici hâtivement résumée : n’est-ce-pas l’hybris, qui constitue le trait commun à ces deux approches, que l’on se plait si souvent à opposer ?
Il faut tout d’abord se garder des caricatures et des anachronismes. Il suffit de relire la « Réforme intellectuelle et morale » de Renan, ouvrage auquel je faisais précédemment allusion, pour saisir toute la dette intellectuelle de l’auteur à l’égard de la pensée allemande dont il était familier. Fichte, pour sa part, fut d’abord un admirateur de la Révolution française avant d’écrire son célèbre « Discours à la nation allemande ». Nietzsche admirait les moralistes français du Grand siècle, tout comme Carl Schmitt fut influencé par la lecture de Maurras, avant d’inspirer les constitutionnalistes de la Ve république.
Rappelons que Bainville et Maurras n’étaient nullement des monarchistes de tradition et de cœur, mais seulement de raison : c’est le sentiment de la faiblesse française face à la puissance de l’Empire allemand qui les a convertis à l’idée monarchique. Cette attitude est bien différente de celle des hommes qui se sont battus pour Dieu et le roi sous la Révolution. Parce qu’ils identifiaient la nation au souverain et concevait la patrie comme la « terre des pères », les chouans ou les soldats de Condé ne pouvaient reconnaitre aucune légitimité à la patrie idéologique des révolutionnaires. Ils ont donc logiquement préféré la marine anglaise et les canons prussiens au délire sanglant des sans-culottes. C’est une vision bien différente de celle qui légitime l’Union sacrée prônée par l’Action Française en 1914, comme l’a bien montré Jean de Viguerie dans son livre : « Les deux patries ». Sans doute le contexte de la première moitié du xxe siècle justifiait-il le « nationalisme intégral » de l’Action française. Mais peut-on encore se réclamer de la « France seule », devant le cataclysme qui menace aujourd’hui d’emporter toute notre civilisation ?
Soixante-seize ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cent-cinquante ans après la proclamation de l’Empire Allemand dans la galerie des glaces de Versailles, il est sans doute temps de dépasser certains antagonismes, et de percevoir ce qui unit les peuples d’Europe face aux mêmes périls existentiels, plutôt que ce qui peut continuer à les opposer pour le plus grand bonheur de leurs ennemis communs.
Il convient de dénoncer l’imposture intellectuelle que constitue la récupération de la conférence de Renan par les tenants d’une construction nationale principalement idéologique, fondée sur l’adhésion à des « valeurs universelles ». Le texte de Renan est pourtant sans ambiguïté : « On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet. Le chant spartiate : “Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes” est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie. » Nul doute que le Breton Renan, s’il revenait à nos côtés, se sentirait davantage d’affinités avec un Bavarois catholique, solidement enraciné dans sa terre et fidèle à ses traditions, qu’avec certaines militantes « indigénistes » françaises.
Comprendre cela, ce n’est pas vouloir abolir nos différences et nos spécificités nationales, pour nous fondre dans un « grand tout » européiste et néo-jacobin, aussi universaliste et destructeur de nos patries charnelles que la construction « républicaine ». Celle-ci n’a d’ailleurs plus grand-chose à voir avec la notion de république au sens où l’entend encore Jean Bodin au XVIe siècle, c’est-à-dire avec l’exercice de la souveraineté en vue du bien commun de la Cité.
Le siècle qui vient de s’écouler a surtout révélé les conséquences néfastes d’une forme hypertrophiée de nationalisme qui prend sa source dans l’hybris du patriotisme révolutionnaire, hérité de certains penseurs des Lumières. Dans cette perspective, l’histoire de l’occidentalisation du monde se confond, comme l’a bien vu Martin Heidegger, avec le déploiement d’une véritable « métaphysique de l’illimité ». La démesure propre au mythe du progrès linéaire et infini constitue le ressort ultime de la modernité. Face aux prétentions totalitaires de ce discours universaliste, c’est évidemment le retour à l’enracinement local qui permettra de ressouder le lien nécessaire entre la polis et l’ethnos.
Vous distinguez les notions de polis et d’ethnos sans les opposer, mais en montrant les réalités qu’elles recouvrent, ainsi que le nécessaire ordonnancement des critères qui les fondent et des conditions qui garantissent leur pérennité. Elles sont aujourd’hui en désordre, au point précisément d’animer un lancinant débat sur la priorité à établir entre promotion de la souveraineté et promotion de l’identité, ou sur la recherche du Bien Commun, par exemple chez Guilhem Golfin. En quoi le rappel des différences et des complémentarités entre les notions de polis et d’ethnos peut-il utilement contribuer à ce débat ?
Pour saisir le caractère fondamental de l’articulation entre ces deux notions, il faut revenir à une anthropologie réaliste, débarrassée de la vision libérale fondée sur une vision abstraite de la nature humaine. L’homme n’est pas un individu doté de droits universels protégés par un contrat social. Aristote nous rappelle que l’homme est un animal politique : il n’est pas citoyen du monde, mais membre d’une Cité, d’un espace politique clairement délimité. Par ailleurs, l’homme est un « être de culture par nature », comme l’a montré Arnold Gehlen. Cela signifie que la disparition des limites et des frontières mène à la disparition de toute forme de culture enracinée, c’est-à-dire à une dénaturation profonde de l’existence humaine. Car l’émergence d’une culture authentique suppose l’alliance d’un certain type d’homme et d’un territoire. La culture ne se réduit pas à un simple savoir, c’est-à-dire une donnée échangeable. Elle est un phénomène vivant, plongé dans le fleuve de l’histoire, et suppose l’existence d’une communauté humaine qui l’incarne. Elle s’exprime à travers un ethos spécifique, qui traduit le génie propre à un ethnos (les deux mots étant d’ailleurs étymologiquement apparentés).
La notion d’éthique renvoie, dans le sens premier du mot grec, à une « position dans le monde » : elle suppose un enracinement, la combinaison d’une hérédité et d’un milieu, l’attachement à un lieu, à un topos à partir duquel l’existence humaine se déploie. Tel des arbres majestueux, les hautes cultures peuvent couvrir de leur ramure un espace d’autant plus vaste que leurs racines sont profondes : elles possèdent à ce titre une dimension universelle, dans la mesure où elles enrichissent la polyphonie de la diversité humaine. Ce phénomène n’a rien à voir avec l’idéologie « universaliste », qui prétend regrouper l’humanité dans une catégorie unique. Fonder la Cité sur une démarche purement contractuelle, la transformer en un conglomérat d’individus sans passé commun, c’est ignorer à la fois les conditions de son existence et sa vocation ultime, qui est de permettre l’épanouissement d’un type humain et d’une culture.
Résolument détaché du réel, l’idéalisme des Lumières aboutit à deux excès contradictoires : réduire l’homme à une entité abstraite, ou à une « machine biologique ». Or, les hommes et les peuples sont porteurs d’un double héritage, culturel et génétique. Ces deux dimensions ne se confondent pas, mais ne sont pas non plus entièrement dissociables. Incapables de penser ensemble ces deux aspects de l’identité, nos contemporains souffrent aujourd’hui d’une véritable hémiplégie intellectuelle, qui provoque des débats stériles et sans fin sur le sexe des anges. Au lieu d’opposer l’identité civique et l’identité ethnique, il convient d’en saisir le nécessaire ordonnancement, fruit d’une très longue histoire. La rupture de cet équilibre rend illusoire l’exercice d’une souveraineté orientée vers la défense du bien commun, puisqu’elle entraine précisément la disparition de la notion même de « communauté ». Ce dernier terme n’est plus guère employé qu’en mauvaise part aujourd’hui, alors qu’il désigne la matrice de la philia, de l’affectio societatis qui constitue le socle de tout édifice politique.
Vous incitez dans votre ouvrage les Européens à reprendre conscience de leur longue mémoire, dans laquelle vous discernez précisément l’origine d’un destin commun (p. 51) : « À défaut d’unité politique, l’espace géographique de l’Europe coïncide de toute évidence avec l’existence d’un ensemble de peuples étroitement apparentés par l’origine, la culture et les mœurs. » Le constat est sans appel. Mais cette coïncidence des origines ne présage pas de la capacité des peuples européens à accomplir de grandes choses ensemble, du moins volontairement. Beaucoup des sommets du « génie européen » relevèrent davantage de la prédation (concrète ou symbolique), que de la circulation harmonieuse. Les peuples qui composent la France mirent quasiment un millénaire à se fondre dans l’espace national, jusqu’aux sinistres exacerbations républicaines. Alors que la France et l’Europe seraient en « dormition », quelle cause pourrait convaincre des peuples européens différents à conjuguer leur génie ? Cette conjugaison du génie de peuples différents a-t-elle la moindre chance d’exister mue par des volontés libres, et non par un pouvoir autoritaire ?
La prise de conscience d’un destin commun n’implique pas nécessairement la constitution immédiate d’une unité politique. En tant que civilisation, l’Europe n’existe qu’à travers le développement polyphonique d’identités spécifiques, dont les voix concordent parce qu’elles sont issues d’une matrice commune. À l’échelle du continent, le peuplement de l’Europe n’a connu aucun bouleversement majeur depuis l’arrivée des conquérants indo-européens issus des steppes pontiques, au quatrième millénaire avant notre ère. Ces derniers nous ont légué leur langue, qui se trouve à l’origine de la quasi-totalité des langues européennes connues, anciennes et modernes. L’héritage de leur vision du monde transparaît encore à travers l’aube grecque de la pensée et l’essor du génie politique romain. Le même héritage a également joué un rôle déterminant dans l’élaboration des cultures celtiques, germaniques et slaves. Combiné à l’apport nouveau du christianisme, l’imperium romain, dont le legs fut bientôt revendiqué par les royaumes barbares qui en avaient précipité la chute, a imprimé sa marque de manière plus ou moins directe sur l’ensemble continent, en particulier dans le domaine du droit et des institutions politiques.
Si la nostalgie de l’unité romaine a pu inspirer différentes tentatives de renovatio imperii depuis le Moyen Age, force et de constater que ces tentatives n’ont jamais abouti qu’à des constructions éphémères, en dehors du Saint Empire Romain germanique (dont les frontières n’ont cependant jamais coïncidé avec celle de l’Europe dans son ensemble). À plusieurs reprises pourtant, les nations chrétiennes ont su manifester leur solidarité face à un péril commun : ce fut notamment le cas sous les murs de Vienne, en 1683, face aux Ottomans.
On peut donc espérer que l’Europe sera capable une fois encore de se ressaisir au bord du gouffre, pour paraphraser Nietzsche. La situation présente est cependant bien différente de celle du dernier siège de Vienne : il ne s’agit plus de repousser les assauts d’une puissance étrangère installée sur une partie de l’Europe centrale et balkanique à la suite d’une conquête militaire, mais de sauver ce qui subsiste de nos vieilles patries, menacées dans leur être même par un véritable changement de substance ethnique, combiné à la destruction systématique des repères éthiques et anthropologiques fondamentaux. Ce péril est infiniment plus grand que le précédent. Il ne pourra être contré sans que les peuples européens, confrontés aux mêmes dangers mortels, n’unissent leurs efforts. Cette réaction ne passera pas nécessairement par un processus d’unification politique, mais plus surement par le rejet des institutions européennes actuelles, dont la vocation semble être de désarmer nos nations plus que de les défendre.
Société ouverte, dictature des droits individuels, empire accablant de l’état de droit sur le destin des Nations : bien des maux abiment jusqu’à l’âme des hommes qui habitent les Nations européennes. S’ils sont évidemment les héritiers d’un temps long, ils sont aussi les débiteurs, malheureux et involontaires, des inhumanités de la vie contemporaine. La flamme de la longue mémoire peut-elle brûler encore chez suffisamment d’entre eux, pour que votre appel à « fuir le laisser-aller et refuser l’abandon de soi-même » (p. 73) trouve un écho ?
Dans son livre La fin d’un monde, que j’évoquais au début de cet entretien, Patrick Buisson définit l’époque contemporaine comme une vertigineuse « montée du vide ». En d’autres termes, la société actuelle se caractérise par une longue éclipse du sacré, auquel se substitue la domination sans partage du matérialisme le plus trivial. Or, le poète allemand Hölderlin nous le rappelle : « Au cœur du danger, croît ce qui sauve ». Le désarroi dans lequel nous abandonnent les faux prophètes de l’heure nous force précisément à trouver en nous-même les ressources nécessaires pour faire face à la montée des périls. Cette situation nous contraint à l’excellence. Comme nous y invitait Dominique Venner dans Un samouraï d’Occident (pp. 296-297), il nous faut cultiver « chaque jour, comme une invocation inaugurale, une foi indestructible dans la permanence de la tradition européenne ». Le discours de nos adversaires, ou de tous ceux qui rabâchent les vielles antiennes « humanistes », apparait de moins en moins légitime. Il devient même tout simplement inaudible, parce qu’il se heurte au mur d’une réalité de plus en plus insupportable.
Face à cette situation, les « déclinologues » de talent ne manquent pas : ils savent parfaitement analyser les symptômes de notre déclin, mais plus rarement imaginer des remèdes nouveaux, à la hauteur du mal qui nous étreint. C’est pourquoi je demeure intimement persuadé de la venue du kairos, du moment propice et décisif, où notre voix entrera en résonance avec l’histoire. D’où la nécessité impérieuse de réveiller par tous les moyens la conscience de l’ethos européen au sein d’une véritable avant-garde : car il suffira comme toujours d’une minorité consciente et agissante pour saisir le destin à bras le corps, et emporter la décision à l’instant opportun. Il faudra d’ici-là faire preuve de courage et d’endurance, en s’appuyant sur les communautés naturelles, sociales et politiques, notamment à l’échelon local, où l’esprit du bien commun peut encore s’épanouir. Car les périls montent.
À cet égard, deux « remplacements » s’opèrent, qui saccagent profondément les mœurs des sociétés européennes : le premier par l’importation massive de populations aux racines absolument étrangères aux cultures européennes, l’autre au sein même de l’Europe, avec la promotion d’une série de constructions d’identités loufoques, fondées sur la souffrance identitaire post-coloniale et le plus petit commun dénominateur des inclinations sexuelles : au nom de « l’intersectionnalité des luttes », la famille traditionnelle semble vouée à la destruction, et toute piété devant le legs des Anciens devient proscrite. Ces deux remplacements, l’un altérant la culture du peuple français, l’autre le « divisant de l’intérieur », comme vous le soulignez, sont-ils à vos yeux d’une importance égale, ou hiérarchisez-vous leur dangerosité ?
Comment hiérarchiser deux périls mortels, qui procèdent l’un et l’autre d’une même vision « fluide » de l’identité, destinée à rompre tous les obstacles qui viennent encore freiner l’accélération frénétique du « doux commerce » mondial : familles, communautés enracinées et peuples ? À cet égard, l’instauration du « mariage pour tous » apparait comme l’une des étapes les plus subversives dans le processus de transgression et de déconstruction en cours depuis 1968 : sous le prétexte de garantir l’accès de « tous » à certains droits, elle vise en réalité à modifier la nature même de l’institution du mariage pour s’attaquer au modèle de la famille en tant que cellule sociale fondée sur la transmission héréditaire. Il s’agit d’un acte éminemment « politique », qui va de pair avec l’ouverture des frontières à tous les vents du grand remplacement démographique. Il n’est donc pas possible de défendre une certaine éthique sans défendre avec le même opiniâtreté notre identité dans toutes ses composantes ethnoculturelles. L’inverse est également vrai : ethos et ethnos vont de pair. Nos ennemis ne s’y trompent pas : derrière le ridicule des postures, « l’intersectionnalité des luttes » présente une réelle cohérence révolutionnaire, que les défenseurs de la « morale traditionnelle » n’ont pas toujours perçue.
Il est donc grand temps de refonder la Cité sur une compréhension authentique de « ce que nous sommes ». Pour le dire avec Julien Langella, il nous faut « refaire un peuple ».
Ce réveil d’une conception de la Nation réinvestie par des critères de sociabilité naturelle (proximités ethniques, linguistiques, religieuses) charmera nombre de nos lecteurs. Nous connaissons cependant la panique de nos contemporains, provoquée à grands coups de diabolisations historiques, devant toute remise en cause de la « nationalité républicaine ». Est-il encore possible de leur proposer une conception de la nationalité émancipée d’un pur idéalisme contractualiste ?
L’aveuglement idéologique et la crispation autoritaire du système sur des positions intenables évoquent la fin du monde soviétique : pour les peuples vivant à l’Est du rideau de fer, il ne semblait y avoir d’autres univers possibles que celui du collectivisme marxiste, jusqu’au moment où le régime s’est effondré comme un château de cartes. Du jour au lendemain, ce qui paraissait relever d’un dogme intouchable devint un objet de ridicule et de rejet. Il s’agit d’un précédent historique à méditer.
Rien ne garantit qu’il nous sera donné de vivre le moment où nos peuples retrouveront le chemin de la liberté et de la grandeur. Mais quoi qu’il advienne de nos destins personnels, puissions-nous n’avoir jamais à encourir de nos enfants le blâme qu’exprime la terrible phrase de Kipling : « Si l’on vous demande : pourquoi sommes-nous morts ? Répondez : parce que nos pères nous ont menti. »
Henri Levavasseur (Le Bien commun, juin 2021)