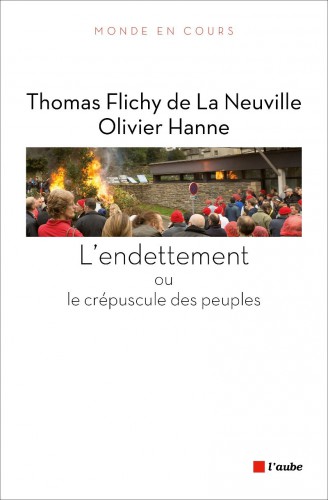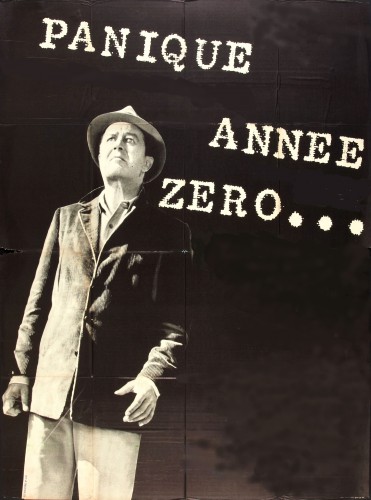Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la question de la dette...

« La dette ? Une machine devenue folle et proche de ruiner tous les États »
La dette… La dette… La dette ! Elle obsède tout le monde, et c’est sans doute à juste titre. Mais comment en est-on arrivé là ?
La possibilité offerte aux ménages d’emprunter pour couvrir leurs dépenses courantes ou acquérir un logement a été l’innovation financière majeure du capitalisme d’après-guerre. À partir de 1975, c’est ce qui a permis de compenser la baisse de la demande solvable résultant de la compression des salaires et de la précarité du travail. Le crédit a ainsi représenté pendant des décennies le véritable moteur de l’économie. Aux États-Unis, cette tendance a encore été encouragée dans les années 1990 par l’octroi de conditions de crédit de plus en plus favorables, sans aucune considération de la solvabilité des emprunteurs. Quand la crise financière de 2008 a éclaté, les États se sont encore endettés pour empêcher les banques de sombrer. La machine s’est alors emballée de façon telle que les États surendettés sont devenus prisonniers de leurs créanciers, ce qui a limité d’autant leur marge de manœuvre en matière sociale et politique. Aujourd’hui, ils se retrouvent pris dans un système usuraire, puisqu’ils n’ont d’autre alternative que de continuer à emprunter pour payer les intérêts de leur dette (la France emprunte, à cet effet, 50 milliards d’euros par an), ce qui augmente encore le montant de cette dette.
Résultat : le volume total de la dette mondiale atteint aujourd’hui le chiffre faramineux de 200.000 milliards de dollars, soit 286 % du PIB mondial, contre 142.000 milliards de dollars en 2007. Et encore ne tient-on pas compte des dettes contingentes comme la dette bancaire ou celle des retraites à servir !
La dette cumulée de tous les États atteint des niveaux stratosphériques. Les particuliers et les ménages savent bien pourtant que personne ne peut vivre perpétuellement à crédit…
Il semble, en effet, préférable de ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne. Mais le problème est qu’on ne peut assimiler le budget d’un État à celui d’un ménage. Un État est tenu de faire des investissements à long terme qui, ne pouvant être financés sur la base des seules recettes courantes, doivent obligatoirement l’être par l’emprunt. Les nations, en outre, ne sont pas des êtres mortels : un pays ne fait pas faillite à la façon d’une entreprise ou d’un particulier. Enfin, quand il emprunte, un État n’engage pas sa propre fortune, mais celle de ses citoyens (il gage une partie de l’épargne des plus aisés plutôt que de la prélever par le moyen de l’impôt). Ce faisant, il se soumet, en revanche, aux marchés financiers. Le montant de la dette indique le degré d’aliénation de l’État.
Tout le monde fait les gros yeux à la Grèce, en affirmant qu’elle « doit payer sa dette ». Michel Sapin dit même que, si elle ne la payait pas, cela coûterait 600 ou 700 euros à chaque Français. Mais que faire quand on ne peut pas payer ?
Rappelons d’abord que, contrairement à ce que prétend la vulgate médiatique, l’envolée de la dette grecque est due pour l’essentiel à des taux d’intérêt extravagants et à une baisse des recettes publiques provoquée par des amnisties fiscales qui ont surtout profité à l’oligarchie. Quant à Michel Sapin, il dit n’importe quoi. Les prêts que la France a consentis à la Grèce sont, en effet, déjà comptabilisés dans la dette publique française, que la France n’a pas plus que la Grèce l’intention (ni les moyens) de payer. Il n’y a, en fait, aucun avenir pour la Grèce à l’intérieur d’une Union européenne qui cherche à constitutionnaliser les politiques d’austérité afin de museler la souveraineté populaire : comme l’a dit sans fard Jean-Claude Juncker, porte-parole des étrangleurs libéraux et subsidiairement président de la Commission européenne, « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » (sic). La Grèce n’a d’autre choix que de passer sous la table ou de la renverser, c’est-à-dire de faire défaut sur sa dette et de sortir de l’euro.
Ceux qui font les gros yeux à la Grèce devraient essayer de comprendre que, si la morale est de mise en matière de dette privée (cf. l’allemand Schuld, « dette », et schuldig, « coupable »), elle ne l’est pas en matière de dette publique. Quand un État emprunte, il ne s’engage pas moralement, mais conclut un simple accord financier. La valeur de cet accord est subordonnée à des exigences politiques, en ce sens qu’aucun État ne peut saigner à mort son peuple au seul motif que les accords signés doivent toujours être respectés (pacta sunt servanda). L’économie de la servitude n’est, en effet, pas supportable : on ne saurait exiger d’un peuple qu’il rembourse une dette contractée dans le passé à ses dépens. Au demeurant, les exemples ne manquent pas qui montrent que l’obligation de rembourser une dette publique n’a jamais été considérée comme absolue. La dette de l’Équateur a été supprimée en 2008, celle de l’Islande en 2011. En Pologne, dès l’arrivée au pouvoir de Lech Wałęsa, en 1990, les créanciers de ce pays ont réduit sa dette de 50 %. Quand ils ont envahi l’Irak en 2003, les États-Unis ont épongé la dette irakienne pour assurer la solvabilité du pouvoir qu’ils venaient de mettre en place à Bagdad. Quant à l’Allemagne, elle ferait bien de ne pas oublier qu’après la guerre, le « miracle économique » allemand n’a été rendu possible que grâce à l’accord de Londres du 27 février 1953, qui a d’un trait de plume supprimé plus de la moitié de sa dette extérieure. C’est la meilleure preuve que, lorsqu’une dette devient insupportable, il n’y a pas d’autre solution que de l’annuler ou de la restructurer.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 28 mars 2015)