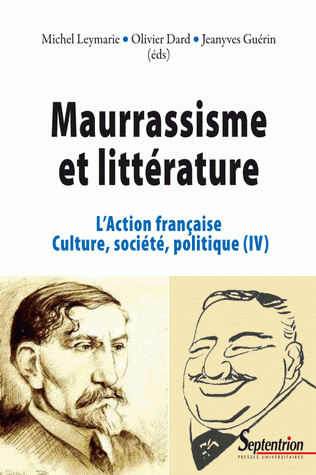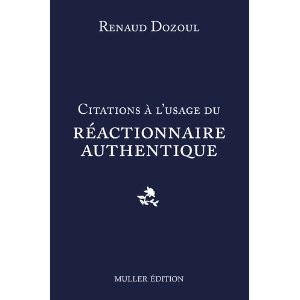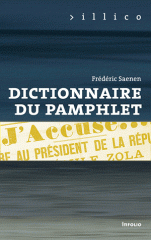Nous reproduisons ici un beau texte du romancier
Jérôme Leroy, mis en ligne sur son site
Feu sur le quartier général et consacré aux figures de
George Orwell et de
Georges Bernanos.
A noter pour ceux qui avaient apprécié Le déclenchement muet des opérations cannibales que notre auteur sortira en février, aux éditions de La Table Ronde, un deuxième recueil de poèmes intitulé Dernier verre en Atlantide.
La guerre des deux George(s)
Orwell (1903-1950) et Bernanos (1888-1948) : ces hommes sont des contemporains qui ne se sont jamais croisés. Ce n’est pas très grave, l’un comme l’autre n’étaient pas de leur temps et partageaient malgré tout le seul point commun qui vaille pour les écrivains qui dureront : une allergie métaphysique à leur époque. Ce point commun conditionne tout le reste : les désespoirs, les colères, les refus, une certaine façon d’être au monde pour témoigner de l’horreur de vivre et de l’honneur de vivre, au siècle de la mort massifiée.
A ma gauche non stalinienne, George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, rejeton d’une famille anglo-indienne, déclassé comme toute une génération d’intellectuels de cette époque encore ossifiée par les castes victoriennes. On pourra lire le trop méconnu Tels, tels étaient nos plaisirs pour comprendre la charge d’humiliation que peut représenter d’être l’enfant le moins riche dans une prep school au début du siècle dernier.

A ma droite non fasciste, Georges Bernanos, élève des jésuites, né à Paris, mais enfant du Pas de Calais, ce
middle of nowhere propice aux angoisses pour le curé de campagne et au suicide pour les Mouchette, ces lolitas de la déréliction.Quand George Orwell aurait voulu quitter l’Angleterre étouffante de Et vive l’aspidistra ou pré apocalyptique d’Un peu d’air frais, George Bernanos crevait de rage et de tristesse dans la France timorée de la Troisième République, celle de La grande peur des bien pensants, du radical opportunisme et de l’amnésie d’une Histoire de France à qui plus personne ne veut se rallier. Quand Orwell aura été policier en Birmanie dans sa jeunesse, Bernanos, lui aura eu plus souvent qu’à son tour à faire avec les forces de l’ordre : bagarres contre les prêtres ralliés, complots pour restaurer la monarchie au Portugal, coup de poing avec ses copains les Camelots du Roy. « Pour tout dire, j’aimais le bruit ». On ne saurait mieux dire.
Pourtant, Bernanos et Orwell ont aussi eu en partage des allures d’hommes terriblement quotidiens, des postures de héros simenoniens. Il y a dans leurs œuvres respectives des odeurs de garnis, des mélancolies de meublés, des tables d’hôte à la lumière chiche. Ils ont vécu la vie moderne, celle d’après 1918, la vie d’une terre qui commence à se couvrir de non-lieux dirait Marc Augé(1), quartiers sans âme, campagnes quadrillées par le remembrement agricole, hall de gare, de banques.

Bernanos, inspecteur d’assurance, dans les trains entre Fressin et Bar le Duc :
« 27 juin 1924. Je vous écris dans un ignoble café de Rethel. Il n’y a d’humain ici qu’une souillon qui va de table en table et répète :Un bock, M’sieu ? ». Orwell, même époque, qui transpose son quotidien mal éclairé d’employé de librairie dans Et vive l’Aspidistra : « Gordon sortit sa clé et tâtonna avec dans le trou de la serrure- dans ce genre de maison la clé ne va jamais parfaitement bien dans la serrure. » Le sordide de l’inadéquation, le post-naturalisme du désastre mais malgré tout la foi chevillée au corps : Dieu pour Bernanos, le Socialisme pour Orwell, et l’urgence d’une œuvre pour les deux.
Retrouver la figure du monde devient un impératif catégorique. Orwell verra la Birmanie, certes, mais il ira beaucoup plus loin à la rencontre de l’homme nu. Pas besoin d’Afrique, d’horreurs coloniales.
Le quai de Wigan suffira, exotisme horrible de la silicose des mineurs du nord de l’Angleterre ou Dans la dèche à Paris et à Londres, à perdre sa santé dans les dortoirs qui sentent la tuberculose et les soupes populaires qui sentent le chou : « J'aimerais comprendre ce qui se passe réellement dans l'âme des plongeurs, des trimardeurs et des dormeurs de l'Embankment. Car j'ai conscience d'avoir tout au plus soulevé un coin du voile dont se couvre la misère. » L’expérience d’Orwell aurait évidemment plu à Bernanos, le catholique intégral mais pas intégriste. Bernanos aussi sait que la misère est la honte du monde, mais pour lui c’est Dieu qu’on blesse. Il le scande, il le slame, c’est partout le Christ aux outrages dans les nouvelles fabriques concentrationnaires où crèvent « les humiliés et les offensés ». Apostrophant la bourgeoisie au début des Grands cimetières sous la lune, il écrit : « Il est affolant de penser que vous avez réussi à faire du composé humain le plus stable une foule ingouvernable, tenue sous la menace des mitrailleuses. »
Diogène cherchait un homme, il en aurait trouvé au moins deux avec Orwell et Bernanos et pourtant l’espèce se fait rare dans l’Europe des années trente. On a pris de sales habitudes avec le genre humain depuis les abattoirs de Verdun, du Chemin des dames mais aussi dans les usines Ford taylorisées ou sur les chantiers des grands travaux du nazisme et du fascisme. On a tendance à ne plus distinguer que deux sortes d’individus : l’esclave et le surhomme. C’est ce que fuit Bernanos quand il part au Brésil en 1938, ce monde de robots cruels, celui que peindra en 49 un Orwell agonisant, écrivant
1984 comme un testament. Ces deux-là ont toujours eu l’intuition du massacre et cette intuition, c’est la Guerre d’Espagne qui va la vérifier. Ils vont lui consacrer chacun un livre qui paraît la même année, en 1938 : Les grands cimetières sous la lune pour Bernanos, Hommage à la Catalogne pour Orwell. La fracture qui s’opère pendant une guerre civile ne s’opère pas seulement entre des classes sociales, des régions ou des ethnies, elle traverse les individus eux-mêmes, dans une sorte de schizophrénie idéologique, de déchirement intérieur. Orwell et Bernanos vont constater la même chose. Le camp qui devrait être le leur est monstrueux. Bernanos devrait acclamer Franco, ses bataillons maures et ses évèques chamarrés, au nom du Christ-Roi et de sa victoire sur le matérialisme athée tandis qu’Orwell devrait soutenir sans nuance l’héroïsme de l’armée républicaine sous équipée, la furie sublime des anarchistes, la générosité des brigades internationales qui montent au feu avec cinq cartouches par fusil. Oui, mais voilà, Orwell et Bernanos sont affligés d’un mal terrible : l’honnêteté.
Engagé dans les rangs du POUM(2), Orwell constate la reprise en main par les plus durs des staliniens du camp républicain. La république veut les avions de l’URSS ? Le guépéou veut des têtes, et elle les aura. Orwell n’oubliera jamais pas les arrestations sauvages dans les rues de la Barcelone de mai 37. Bernanos, quant à lui, osera s’exclamer à propos de ce conflit et la complicité objective du clergé espagnol avec les massacres de paysans et d’ouvriers : « Excellences, Vos Seigneuries ont parfaitement défini les conditions de l’Ordre Chrétien. Et même à vous lire, on comprend très bien que les pauvres gens deviennent communistes. »
Ces deux-la ont eu un courage rarissime chez les intellectuels : être capable de tirer contre leur camp. Ils ne l’ont pas fait par dandysme, mais plutôt par ce qu’Orwell qualifiait fort justement de « common decency » , cet autre manière, modeste, de désigner l’honneur. Cela suffit à les réunir pour l’éternité, et à les ranger côte à côte dans nos bibliothèques, sans souci de cohérence alphabétique mais plutôt par nécessité méthodologique car nous allons avoir de plus en plus besoin des deux, en même temps.
Jérôme Leroy (texte publié dans Témoignage Chrétien, numéro spécial Guerre d'Espagne, été 2009)