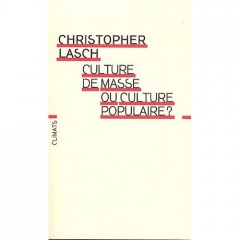Oublier l'Occident
L' « Occident»? Raymond Abellio avait observé que « l'Europe est fixe dans l'espace, c'est-à-dire dans la géographie», tandis que l'Occident est « mobile». De fait, 1'« Occident» n'a cessé de voyager et de changer de sens. Au départ, le terme évoque seulement la terre du Couchant (Abendland), par opposition au pays du soleil levant (Morgenland). A partir du règne de Dioclétien, à la fin du IIIe siècle de notre ère, l'opposition entre Orient et Occident se ramène à la distinction entre l'empire romain d'Occident (dont la capitale fut Milan, puis Ravenne) et l'empire romain d'Orient installé à Constantinople. Le premier disparaîtra en 476, avec l'abdication de Romulus Augustule. Occident et Europe se confondent ensuite, durablement. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, l'adjectif « occidental» se retrouve sur les cartes maritimes en référence au Nouveau Monde, appelé aussi « système américain », par opposition au « système européen» ou à 1'« hémisphère oriental» (qui comprend alors aussi bien l'Europe que l'Afrique et l'Asie). Dans l'entre-deux guerres, l'Occident, toujours assimilé à l'Europe, par exemple chez Spengler, s'oppose globalement à un Orient qui devient à la fois un objet de fascination (René Guénon) et un repoussoir (Henri Massis). Durant la guerre froide, l'Occident regroupe l'Europe occidentale et ses alliés anglo-saxons, Angleterre et États-Unis, pour s'opposer cette fois au « bloc de l'Est» dominé par la Russie soviétique. Cette acception, qui permet aux États-Unis de légitimer leur hégémonie, survivra à la chute du système soviétique (ainsi chez Huntington).
Aujourd'hui, l'Occident a encore changé de sens. Tantôt il reçoit une définition purement économique: sont « occidentaux» tous les pays développés, modernisés, industrialisés, aussi bien le Japon et la Corée du Sud que l'Australie, les anciens« pays de l'Est », l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine. « Ex Oriente lux, ex Occidente luxus », disait plaisamment l'écrivain polonais Stanislaw Jerzy Lee. L'Occident perd alors tout contenu spatial pour se confondre avec la notion de modernité. Tantôt, il s'oppose globalement à la dernière incarnation en date de la furor orientalis aux yeux des Occidentaux: l'islamisme. Dans cette vision, une fracture essentielle opposerait l' « Occident judéo-chrétien» à 1'« Orient arabo-musulman », certains n'hésitant à prédire que la lutte finale de « Rome» et d' « Ismaël» -la guerre de Gog et de Magog - débouchera sur l'ère messianique.
En réalité, il n'existe pas plus d'« Occident» unitaire que d'« Orient» homogène. Quant à la notion d'« Occident chrétien» elle a perdu toute signification depuis que l'Europe a majoritairement versé dans l'indifférentisme et que la religion y est devenue une affaire privée. L'Europe et l'Occident se sont totalement disjoints - au point que défendre l'Europe implique bien souvent de combattre l'Occident. Ne se rapportant plus à aucune aire géographique ni même culturelle particulière, le mot « Occident » devrait en fait être oublié.
Parlons donc plutôt de l'Europe. En inventant l'objectivité, c'est-à-dire le décentrement par rapport à soi, en cherchant à statuer objectivement sur le vrai, le juste et le bien, l'Europe a voulu d'emblée accéder à l'universel, souci que l'on ne retrouve pas dans les autres cultures. Jean-François Mattéi parle très justement de « regard théorique de l'universel ». Ce souci de l'universel a ensuite dégénéré en universalisme, religieux d'abord, puis profane (il y a autant de distance entre l'universel et l'universalisme qu'entre la liberté et le libéralisme). L'universalisme se résume dans l'idéologie du Même, dans la recherche de la Mêmeté au détriment de la Différence, dans l'affirmation du primat de l'Un sur le Multiple. Mais c'est aussi un ethnocentrisme masqué, dans la mesure où tout souci de l'universel reflète inévitablement une conception particulière de l'universel. Au départ, on avait voulu comprendre les autres à partir des autres, non à partir de soi-même, ce qui était aussi louable que nécessaire. Après quoi, on a renoncé à être soi, ce qui s'est révélé dramatique.
L'Europe paraît aujourd'hui en déclin sur tous les plans. La construction européenne elle-même se liquéfie sous nos yeux. L'Europe n'est pas seulement 1'« homme malade de la planète économique» (Marcel Gauchet). Elle connaît une crise sans précédent de l'intelligence et de la volonté politique. Elle aspire à sortir de l'histoire, portée par l'idée que l'état présent des choses - l'illimitation du capital et de la technoscience - est appelé à se maintenir indéfiniment, qu'il n'en est pas d'autre possible, et surtout qu'il n'en est pas de meilleur. S'abandonnant à un mouvement qui en a fait l'objet de l'histoire des autres, elle s'exonère d'elle-même. Entre destitution du passé et peur de l'avenir, elle ne croit plus qu'à une morale abstraite, à des principes désincarnés qui lui épargneraient d'avoir à persister dans son être - fût-ce en se métamorphosant. Oubliant que l'histoire est tragique, croyant pouvoir rejeter toute considération de puissance, recherchant le consensus à tout prix, flottant en état d'apesanteur, comme entrée en léthargie, non seulement elle paraît consentir à sa propre disparition, mais elle interprète cette disparition comme la preuve de sa supériorité morale. On pense évidemment au « dernier homme» dont parlait Nietzsche. C'est pourquoi la seule chose qui ne décline pas, c'est l'interrogation sur le déclin - qui se décline partout. Cette interrogation ne relève pas simplement de la tradition du pessimisme culturel. Il s'agit de savoir si l'histoire obéit à des lois intrinsèques excédant l'action des hommes. S'il y a déclin de l'Occident, en tout cas, ce déclin vient de loin et ne saurait se ramener à la conjoncture actuelle, la mondialisation par exemple. Le destin d'une culture est contenu dans son origine. Sa fin même est déterminée par l'origine, car c'est cette origine qui détermine sa trajectoire, sa capacité narrative et le contenu de sa narrativité. Historiquement, l'idée occidentale s'est d'abord exprimée sous une forme métaphysique, puis idéologique, puis « scientifique». Elle s'épuise aujourd'hui, de toute évidence. L'Occident a exprimé tout ce qu'il avait à dire, il a décliné ses mythèmes sous toutes les formes possibles. Il s'achève dans la dissolution chaotique, l'épuisement des énergies, le nihilisme généralisé.
Toute la question est de savoir s'il existe une autre culture qui, s'étant déjà approprié la modernité, puisse proposer au monde une nouvelle forme de maîtrise de l'universel théorique et pratique, ou si la culture occidentale, parvenue en phase terminale, donnera d'elle-même naissance à une autre. Quand une culture s'achève, en effet, une autre peut toujours la remplacer. L'Europe a déjà été le lieu de plusieurs cultures, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être encore le foyer d'une culture nouvelle, dont il s'agit alors de déceler les signes avant-coureurs. Cette nouvelle culture fera suite à la précédente, mais n'en sera pas le prolongement. Plutôt que de verser dans des lamentations inutiles, il vaut mieux avoir le regard assez aigu pour voir où - dans quelles marges - croît ce qui permet de garder espoir. On en revient à Spengler, mais avec un correctif: ce qui s'achève annonce un nouveau commencement.
Robert de Herte