Vous pouvez écoutez ci-dessous un entretien donné par Alain de Benoist à la Radio iranienne de langue française à propos de la guerre en Libye et des tentatives de marche arrière de notre pays pour sortir rapidement du conflit.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Vous pouvez écoutez ci-dessous un entretien donné par Alain de Benoist à la Radio iranienne de langue française à propos de la guerre en Libye et des tentatives de marche arrière de notre pays pour sortir rapidement du conflit.

Le nouveau numéro du magazine Eléments ( le n°140) est en kiosque et on peut constater que la nouvelle formule, mise au point par Pascal Eysseric, tient ses promesses ! On trouve dans ce numéro un dossier sur les révoltes du monde arabe, des entretiens avec le général Vincent Desportes, l'écrivain aventurier Sylvain Tesson et le politologue suisse Patrick Haenni, des pages consacrées au combat des idées, abordant aussi bien l'érotisme que l'avénement de la Chine dans le marché mondial, et, bien sûr, les pages Cartouches sur les livres, le cinéma, la science, etc... et l'éditorial de Robert de Herte (alias Alain de Benoist). Bref, un numéro riche et stimulant à emporter sur la plage pour ne pas bronzer idiot !

Au sommaire du dossier : "Révoltes arabes sous influences"
Toute la question, maintenant, est de savoir comment les mouvements actuels pourront résister aux récupérations de toutes sortes, voire aux contre-révolutions. « On osa jusqu’à la fin, parce qu’on avait osé d’abord », disait Saint-Just à propos de la Révolution de 1789. Mais les révolutionnaires français savaient au moins ce qu’ils voulaient. L’anonyme « printemps arabe», qui n’a pour l’instant fait émerger aucune idée neuve, aucune figure capable de remplir le vide du pouvoir, aucune classe intellectuelle capable de théoriser ses aspirations, osera-t-il « jusqu’à la fin » ? On peut en douter. Les révoltes permettront à de nouvelles générations d’accéder au pouvoir, pas forcément de changer de régime.
Le monde arabe moderne est né en 1916, quand les populations du Proche-Orient se sont soulevées contre les Turcs ottomans, maîtres de la région depuis le début du XVIème siècle. Depuis cette date, les « printemps arabes» se sont succédé, mais l’« indépendance » proclamée le 5 juin 1916 à La Mecque est toujours restée un rêve. On attend encore qu’il puisse se concrétiser.
• Derrière les jacqueries des peuples, les révoltes de palais, par Pascal Eysseric
• Egypte : le pays qui dansait sur un volcan
• Entretien avec Patrick Haenni, métamorphose de l'islam
• Chronologie des révoltes arabes
• Turquie : la nouvelle révolution verte, par Tancrède Josseran
Et aussi
• Entretien exclusif avec le général Vincent Desportes : « Le piège américain »
• L'aventure de Sylvain Tesson : la quête du paladin
• Chine : les habits neufs du capitalisme mondial, par Flora Montcorbier
• Nicolas Gogol, le démon du ridicule, par François Bousquet
• Bruno de Cessole, promenade au pays des géants, par Michel Marmin
• D. H. Lawrence, le prophète du sang primitif, par Fabrice Valclérieux
• Le dictionnaire culte des films français pornographiques et érotiques, par Francis Moury

Le numéro de juillet-août 2011 de la revue Le spectacle du monde est en kiosque. Pour la période estivale, le dossier est consacré aux trésors que cache notre pays et qu'il convient de découvrir. Des personnalités du monde intellectuel ou artistique comme Marc Fumaroli, Jean Tulard, Jean des Cars, Alain de Benoist, Dominique Venner, Frédéric Taddéï ou Stéphane Denis nous font découvrir un oeuvre, un monument ou un site qu'ils affectionnent particulièrement. Mais deux articles de Martin Peltier ("Patrimoine, cette nouvelle grande misère") et de Christine Clerc ("Le patrimoine, c'est notre avenir") viennent nous rappeler opportunément que ce patrimoine est menacé...
Hors dossier, on pourra aussi lire un entretien avec Hervé Juvin ("Partageons le combat des indigènes contre les colons"), un article de Arnaud Guyot-Jeannin sur Drieu la Rochelle ("Pierre Drieu la Rochelle, un Européen en quête d'absolu") et un article de Jean-Francois Gautier sur Guiseppe Verdi. Et on retrouvera aussi les chroniques de Patrice de Plunkett et d'Eric Zemmour.
Nous reproduisons ci-dessous un texte d'Andrea Massari, cueilli sur le site de Polémia, dans lequel il dresse un panorama des intellectuels en révolte contre le système. Les tireurs sont en position... Feu sur le quartier général !

La révolte des intellectuels contre le système
La dissidence des intellectuels a précédé la chute de l’Union soviétique. La révolte des intellectuels contemporains pourrait bien annoncer la chute de l’empire cosmopolite. Certes, les oligarques du Système sont puissants : ils possèdent l’argent et contrôlent les médias classiques. Mais le pouvoir de ces oligarques est triplement menacé : par la révolte populiste, par la révolte numérique mais aussi par la révolte des intellectuels. Philosophes, anthropologues, économistes, géopoliticiens, géographes et sociologues sont de plus en plus nombreux à contester le désordre établi. A l’écart d’une actualité hollywoodienne, Andrea Massari nous propose de prendre un peu de hauteur… Explications.
Les philosophes à la quête du sens
Dans les années 1950, la majorité des philosophes étaient marxistes ; ils sont devenus droits-de-l’hommistes dans les années 1970/1980. Aujourd’hui, beaucoup de philosophes sont des critiques acerbes de la modernité et portent souvent la parole d’un retour à la tradition. C’est le cas de Jean-François Mattéi, auteur de La Barbarie intérieure et du Procès de l’Europe. C’est le cas de Philippe Nemo, auteur de La Régression intellectuelle de la France. Chantal Delsol dénonce, elle, L’Age du renoncement. Et avec une grande rage littéraire l’écrivain Richard Millet dénonce La Fatigue du sens et l’horizontalité du monde. Un pamphlet philosophique éloigné de toute bien-pensance et frappé du sceau de la radicalité.
Le grand retour des frontières
Dans la novlangue contemporaine le mot frontières était devenu tabou : on n’en parlait pas, si ce n’est pour les… supprimer. Régis Debray a brisé le tabou en publiant un Eloge des frontières. L’éloge des frontières, c’est aussi le fil rouge du livre fulgurant d’Hervé Juvin : Le Renversement du monde. L’économiste et anthropologue rejoint ainsi le philosophe. L’un et l’autre chez Gallimard.
La réhabilitation du protectionnisme
Face à la grande menace industrielle, le vieux gaulliste Jean-Marcel Jeanneney avait publié, en 1978, Pour un nouveau protectionnisme. En forme de chant de cygne car depuis la fin des années 1970, c’est le libre-échange qui donne le tempo. Parvenant même à faire censurer le Prix Nobel Maurice Allais. Cette époque de censure est révolue : des économistes osent aujourd’hui s’afficher protectionnistes : Jacques Sapir et Jean-Luc Gréau ont rejoint Gérard Dussouy, théoricien de la mondialité, et Alain Chauvet (Un autre monde : Protectionnisme contre prédation).
Sociologues et géographes portent un regard critique sur l’immigration
Le géographe Christophe Guilluy a jeté un pavé dans la mare avec ses Fractures françaises. Il y montre l’ampleur des fractures ethniques. Fractures ethniques qui ne sont pas forcément sociales : car on est plus riche (monétairement parlant, en tout cas) en Seine-Saint–Denis que dans la Creuse. De son côté, Malika Sorel tient Le langage de vérité [sur] Immigration, Intégration. Dans les mêmes perspectives que Michèle Tribalat (de l’INED) dans Les Yeux grands fermés (L’Immigration en France) ou Hugues Lagrange dans Le déni des cultures.
Le grand retour de la géopolitique
Chaque année le festival de géopolitique de Grenoble, organisé par Pascal Gauchon et Jean-Marc Huissoud, marque le retour des intellectuels vers les préoccupations de puissance : Aymeric Chauprade, auteur de Chronique du choc des civilisations, peut y croiser Pascal Boniface, auteur de Atlas du monde global et pourfendeur des Intellectuels faussaires. Hors champ, on ne saurait oublier le général Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre et critique des guerres américaines. Ni Alain Soral, qui ne veut pas seulement Comprendre l’empire mais le combattre. Ni Christian Harbulot, théoricien de la guerre économique. Ni François-Bernard Huyghe, lumineux médiologue.
Le dévoilement de l’art « contemporain »
L’art « contemporain » a plus… d’un siècle. Il est plus que… centenaire ! Il est né dans les années 1890 et trône dans les musées depuis l’Urinoir de Duchamp en 1917 ! Mais les critiques de l’art « contemporain » sont de plus en plus nombreuses et acerbes. Jean-Philippe Domecq annonce que « l’art du contemporain est terminé ». Ces Artistes sans art sont aussi critiqués par Jean Clair, académicien et ancien directeur du Musée Picasso, dans L’hiver de la culture et Dialogue avec les morts. Sans oublier les charges argumentées d’Aude de Kerros (L’art caché), de Christine Sourgins (Les mirages de l’art contemporain), de Jean-Louis Harouel (La grande falsification de l’art contemporain) ou d’Alain Paucard (Manuel de résistance à l’art contemporain).
La dénonciation des oligarchies
Il y a dix ans, les « oligarques » désignaient des dirigeants russes plus ou moins mafieux qui s’enrichissaient sur les ruines de l’ex-Union soviétique. Aujourd’hui, la critique des oligarchies a franchi le mur de l’ex-« rideau de fer ». Apôtre de la démocratie directe, Yvan Blot publie L’Oligarchie au pouvoir. Il se trouve en compagnie d’Alain Cotta dénonçant Le Règne des oligarchies et d’Hervé Kempf qui publie, au Seuil, L’Oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Et le libéral Vincent Bénard, directeur de l’Institut Hayek, dénonce les « oligarchismes ». Un point de vue que reprend d’une autre manière, l’anthropologue Paul Jorion dans Le Capitalisme à l’agonie. Ainsi cinq auteurs, partant de cinq points de vue différents, convergent dans la même critique. A la place des oligarques on s’inquiéterait !
Les neurosciences contre la télévision et les pédagogies nouvelles
Des milliers d’études scientifiques ont établi la malfaisance de la télévision sur la santé (obésité, maladies cardio-vasculaires) et le développement intellectuel en particulier des jeunes enfants. Avec TV lobotomie Michel Desmurget en fait un point sans concession, frappant au cœur l’instrument central de contrôle des esprits.
Les neurosciences offrent aussi des arguments décisifs contre les pédagogies dites « nouvelles » dont les ravages dans l’éducation sont constamment dénoncés, notamment par Laurent Lafforgue, médaille Fields.
Un bouillonnement fécond
Ce qui est frappant dans ce nouveau paysage intellectuel, c’est la diversité de ceux qui le composent. Il y a les établis et les marginaux : ceux qui ont pignon sur rue chez Gallimard et au Seuil, et ceux qui publient leurs livres à la limite de l’autoédition. Qu’importe, les uns et les autres rencontrent le succès grâce à Amazon notamment.
Il y a ceux qui viennent des rives de la gauche et du marxisme et ceux qui s’assument réactionnaires. Il y a des libéraux lucides et des lecteurs de Krisis. Il y a des catholiques, des laïcs et des panthéistes. Il y a ceux qui sortent de trente ans de bien-pensance et ceux qui luttent depuis trente ans contre la bien-pensance. Il y a aussi tous ceux qui viennent de nulle part mais qui respectent les faits.
Le pouvoir des oligarques et l’ordre politiquement correct (mondialiste, « antiraciste », libre-échangiste, en rupture avec les traditions) sont placés sous un triple feu : les mouvements populistes, la blogosphère dissidente et les intellectuels en rupture. Gageons que les événements qui viennent les feront converger !
Andrea Massari (Polémia, 5 juillet 2011)
Avec Les idées à l'endroit, l'essai d'Alain de Benoist, les éditions Avatar rééditent un grand classique de la pensée non-conformiste. L'ouvrage, publié initialement en 1979, a été augmentée d'un avant-propos inédit. On pourra y retrouver des textes importants comme "Fondements nominalistes d'une attitude devant la vie", "Vingt-cinq principes de morale", "Une nouvelle anthropologie", "L'élite ?" ou "Contre le racisme", qui constituent des jalons dans l'évolution intellectuelle de leur auteur.
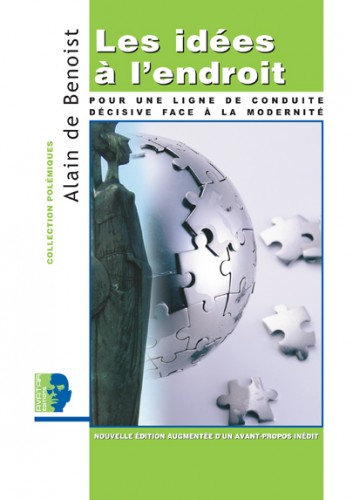
Pour une ligne de conduite décisive face à la modernité.
Les idées à l’endroit sont parues aux éditions Libres Hallier en 1979. C’était peu de temps après la grande campagne de presse sur la Nouvelle Droite (ND) de l’été. L’auteur, Alain de Benoist, s’était trouvé au cœur de cette campagne. Il avait souhaité y répondre en essayant de dissiper bien des malentendus. Les idées à l’endroit sont pourtant beaucoup mieux qu’un livre de circonstance. Si l’auteur, dans une longue préface ici reproduite, rappelait le contexte des débats d’idées des années 1970 et le rôle que lui-même et ses amis y
ont tenu au travers de livres, de rééditions de classiques de la pensée politique et — déjà — de la revue Eléments, le livre ouvrait des perspectives qui gardent toute leur pertinence. Trente ans après la première édition, bien entendu épuisée, il est temps de redécouvrir cet ouvrage de fond.
Non que l’auteur n’ait évolué. Au contraire, dans sa préface de 2010, Alain de Benoist rappelle brièvement (car il l’a fait plus complètement ailleurs, notamment dans Au temps des « idéologies à la mode », dans la réédition de Vu de droite en 2001, et dans Cartouches) le chemin parcouru et les pistes abandonnées, et le pourquoi des nouvelles explorations.
Les textes des Idées à l’endroit sont bien autre chose que des textes datés. Ils définissent des orientations, et plus encore une attitude. Que celle-ci relève ou nom du qualificatif de « nominaliste » est accessoire. C’est l’attitude même qui compte, comme le montre le texte intitulé « 25 principes de “morale’’ ». La meilleure preuve en est que c’est précisément l’attitude, ou encore la méthode, qu’Alain de Benoist définit dans ce livre qui a permis à sa pensée de poursuivre son itinéraire, de se dégager de quelques simplismes, et plus encore de sortir des ambiguïtés de la critique de l’égalitarisme pour mettre l’accent sur la dénonciation de l’« idéologie du Même ». C’est en ce sens un livre capital.
Paru pour la première fois en 1979, Les idées à l’endroit voulaient répondre à une demande créée par l’événement, en l’occurrence la grande campagne de presse autour de la « Nouvelle Droite » qui s’est déroulée durant l’été 1979. Ce texte, qui reste de première actualité, était épuisé depuis de nombreuses années. Cette réédition, très attendue, est augmentée d’un nouvel avant-propos de l’auteur.
Nouvelle édition augmentée d’un avant-propos inédit
En ce jour de solstice d'été, vous pouvez lire ci-dessous un texte d'Alain de Benoist, publié en 1979, dans le Figaro Magazine, et consacré à la tradition des feux de solstice...
UNE SAINT-JEAN POUR le XXIe SIECLE
Lancée à l'initiative de l'association Espaces pour demain, la grande kermesse de l'énergie solaire culmine aujourd'hui, 23 juin, avec la « Journée du Soleil ». Après six mois d'une campagne d'animation et d'information à laquelle se sont associés aussi bien les ministères que l'industrie et la télévision, les organisations de consommateurs et les collectivités locales, c'est donc à la célébration du solstice d'été que la France entière est conviée – renouant ainsi avec une antique tradition.
« A l'idée d'une fête de solstice, écrit Marguerite Yourcenar, un étrange vertige nous prend, pareil à celui d'un homme qui se maintient en équilibre sur une sphère glissante. Cette apogée signale le commencement d'une descente ; les jours, désormais, iront raccourcissant jusqu'au nadir du solstice d'hiver ; l'hiver astronomique commence en juin, comme l'été astronomique commence en décembre, quand les heures de lumière croissent insensiblement de nouveau… Nous sommes pris dans cette double spirale, montante et descendante “Arrête-toi, tu es si beau”, pourrait dire Faust au solstice de juin. Il le dirait en vain. C'est en nous seuls, et encore sans trop l'espérer ni trop y croire, qu'il faut chercher la stabilité » (Le Figaro, 22 juin 1977).
Comme chaque année et comme toujours, ce soir, des feux s'allumeront dans toutes les régions de France et d'Europe pour célébrer la nuit la plus courte de l'année. La population aura amassé des fagots et construit le bûcher. Un mât orné de branchages, décoré aux couleurs de la région, se dressera à son faîte et, la nuit venue, quand la flamme, après avoir hésité, aura définitivement triomphé, les chants et les danses se poursuivront longtemps, autour du brasier flamboyant.
Cette « fête du Soleil » vient du plus lointain passé. « Pour les Indo-Européens, explique Pierre Vial, le soleil était la source de la lumière, de la chaleur et de la vie. Attentifs à la course du soleil dans le ciel, les Indo-Européens célébraient avec ferveur le solstice d'hiver et avec magnificence le solstice d'été. Ils célébraient la puissance du soleil dans la joie » (Les solstices. Histoire et actualité, Copernic, 1977.) En Angleterre, dès le IIIe millénaire av. notre ère, le site de Stonehenge, immense cercle de pierres levées, « cathédrale » proto-historique et temple mutilé, forme un observatoire astronomique dont l'enceinte extérieure regroupe 125 pierres réunies par des linteaux. Les hommes, déjà, y rendent un culte au Soleil : « Une avenue d'accès, jalonnée par quelques menhirs, détermine dans le monument un axe, très exactement orienté sur le soleil levant au solstice d'été » (Fernand Niel).
Le mot même de « dieu » chez les Indo-Européens – deus, theos ou deiwos – exprime à l'origine une notion de luminosité : le dieu souverain est dieu « du ciel lumineux ». En Grèce, Hélios, de la race des Titans, accomplit chaque jour, monté sur son char d'or attelé de trois chevaux ailés, une course à travers les cieux. Embrasant d'un seul regard toute la surface de la Terre, il renseigne l'Olympe sur ce qui s'y passe. Son fils, Phaéton (dont le nom signifie « celui qui brille »), tenta un jour de conduire son attelage, mais fut vite dépassé par la tâche. Sous l'effet de sa course désordonnée, les fleuves se transformèrent en vapeur, les montagnes et les forêts s'embrasèrent, la terre se fendit en plusieurs endroits. Pour mettre fin au désastre, Zeus dut foudroyer l'imprudent, qui fut précipité dans le fleuve Eridanos. Ses sœurs, les Héliades, vinrent pleurer sur sa tombe des larmes d'ambre (cet épisode renvoie peut-être aux catastrophes naturelles qui eurent lieu en Europe du nord au XIIe siècle av. notre ère et qui provoquèrent l'invasion des Doriens en Grèce. Le fleuve Eridanos serait alors l'Eider, qui s'ouvre dans la mer du Nord aux parages de Héligoland, là où, précisément, on extrayait l'ambre jaune dans l' Antiquité).
Chez les peuples nordiques, les solstices donnaient également lieu à de grandes célébrations. Dans les calendriers runiques, le jour du solstice d'hiver est figuré par une roue – et le char attelé de Hélios trouve sa contrepartie dans le célèbre char solaire germanique découvert à Trundholm (Danemark), aujourd'hui au Musée national de Copenhague, constitué d'un assemblage attelé supportant un grand disque doré aux faces ornées de spirales et de cercles concentriques. Chez les Indo-Aryens, le Rig-Véda mentionne à maintes reprises la « roue de Souria », la roue du Soleil, symbole du devenir du monde, qui tourne éternellement : « Un coursier unique au septuple nom meut la roue au triple moyeu, la roue immortelle que rien n'arrête, sur laquelle reposent tous les êtres ». A Rome, la fête de la déesse Palès, le 21 avril, coïncide avec le dies natalis de la capitale de l'Empire. « Bien souvent, écrit Ovide, au jour des Parilia, j'ai sauté à travers trois brasiers alignés ; bien souvent, dans mon enfance, j'ai aspergé l'autel d'eau lustrale avec une branche de laurier […] Imitez-moi, jeunes bergers, allumez les feux, faites passer rapidement vos corps généreux à travers les amas embrasés de paille qui pétille… » (Fastes, IC, V, 720).
Dans le calendrier julien, le 25 décembre était autrefois appelé « jour de la naissance du Soleil » (Pline, Hist. nat., XVIII, 221.) Fait révélateur : quand la vieille religion gréco-romaine disparaîtra, on verra le soleil prendre une place essentielle dans le culte païen menacé, ainsi qu'en témoignent le traité Sur le Soleil roi, de l'empereur Julien, ou l’Hymne au Soleil, de Proclus. En 274, l'empereur Aurélien construit un temple au Soleil sur le champ de Mars. Le 25 décembre, déjà fête de Mithra, devient la fête du Soleil invaincu (Sol invictus). Le mithracisme, culte solaire s'il en fut, connaît alors son apogée. On connaît le mot de Renan : « Si le christianisme avait été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste ».
L'Église tenta d'abord de résister aux vieux rites. Au début du VIIe siècle, saint Éloi écrit : « Ne vous réunissez pas au solstice, qu'aucun de vous ne danse et ne saute autour du feu ni ne chante de chansons en ce jour ». Il ajoute : « Que personne n'appelle le soleil son maître et ne jure par lui ! » Charlemagne recommande aux évêques de proscrire « ces feux sacrilèges qu'on appelle ned fratres et d'autres vaines observances des païens ». Mais ces instructions restèrent lettre morte, si grande et si enracinée était la ferveur populaire. La hiérarchie entreprit alors de composer. Elle reprit à son compte, en les détournant de leur sens, de nombreuses coutumes du paganisme qui faisaient obstacle à la propagation de la foi nouvelle. Le solstice d'hiver devint la fête de la Nativité (Noël) ; le solstice d'été, la « Saint-Jean ». Réalisant un habile syncrétisme, saint Augustin déclare : « A la nativité du Christ, le jour croît ; à la nativité de saint Jean, il décroît. Le jour augmente lorsque se lève le Sauveur du Monde ; il diminue lorsque naît le dernier des prophètes ».
Symbole classique du paganisme, le soleil apparaît dans l'iconographie chrétienne surtout à partir du Moyen Age. L'or, couleur du soleil, devient symbole de triomphe et de joie. Jésus, déjà désigné dans les évangiles comme le « soleil levant » (Matthieu 4,2 ; Luc l,78), est assimilé à la « lumière du monde » et au « soleil de justice ». Le cierge prend le relais de l'ancienne torche. L'ostensoir en forme de soleil rayonnant sert aux bénédictions solennelles. A partir du Ve siècle, l'habitude se prend d'orienter les églises selon la direction est-ouest, avec l'abside tournée vers le soleil levant. Et saint François d'Assise exprime sa foi en ces termes : « Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, et singulièrement pour notre frère messire le Soleil, qui nous donne le jour et la lumière ! »
Allusions historiques (le « soleil d'Austerlitz »), noms de villes idéales (la Citadelle solaire des Rose-Croix, la Cité du Soleil de Campanella), envolées littéraires ou lyriques, formules empreintes d'exaltation ou de ferveur : « messire le Soleil » n’a cessé, sous mille avatars, d'inspirer les hommes et de garder sa signification originelle. Bernardin de Saint-Pierre écrit : « Soleil, viens me réchauffer de tes feux et m'éclairer de ta lumière, cœur du monde, œil de la nature, vivante image de la Divinité ». Le poète normand Malfilâtre s'exclame : « Je te salue, âme du monde, sacré soleil, astre de feu, image de mon Dieu ! » Chez Leconte de Lisle, Hjalmar, le héros intrépide, va s'asseoir après sa mort « parmi les dieux, dans le soleil ». Le Chanteclerc de Rostand s'écrie : « Je t'adore soleil ! Toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont ». Au dernier acte des Revenants, Ibsen laisse Oswald Alving demander : « Mère, donne-moi le soleil ». Verlaine fait du soleil le « complice de [sa] joie ». Nietzsche déclare : « Moi qui suis né sur la Terre, j'éprouve les maladies du soleil comme un obscurcissement de moi-même et un déluge de ma propre âme ».
La renaissance de la pratique sportive au XIXe siècle, l'irrésistible poussée des masses vers les plages durant les mois d'été, ont encore accentué et souligné l'antique familiarité des hommes et de l'astre flamboyant. Renan disait : « L'histoire du monde n'est que l'histoire du soleil » !
Alain de Benoist (Le Figaro Magazine, 23 juin 1979)