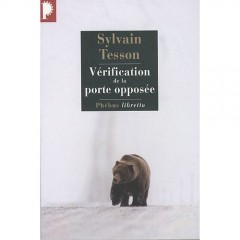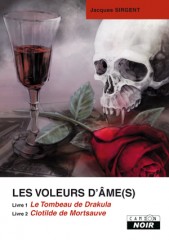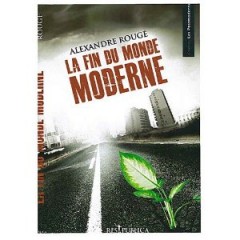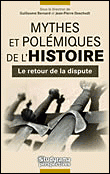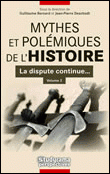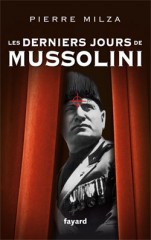Daniel Lefeuvre, spécialiste de l'Algérie coloniale et professeur d'histoire à l'université Paris-8 (Saint-Denis), a écrit en 2006 Pour en finir avec la repentance coloniale. Publié initialement chez Flammarion, cet ouvrage a été réédité en format poche dans la collection Champs. A lire avant la sortie en salle de Hors-la-loi, le film de Rachid Bouchareb, qui devrait relancer les polémiques stériles sur la colonisation...
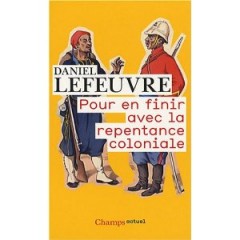
"Après celle de la guerre d'Algérie, une nouvelle génération d'anticolonialistes s'est levée, qui mène combat pour dénoncer le péché capital que nous devons tous expier: notre passé colonial, à nous Français. Battons notre coulpe, car la liste de nos crimes est longue ! Nous avons pressuré les colonies pour nourrir notre prospérité, les laissant exsangues à l'heure de leur indépendance; nous avons fait venir les "indigènes" au lendemain des deux guerres mondiales pour reconstruire la France, quitte à les sommer de s'en aller quand nous n'avions plus besoin d'eux; surtout, nous avons bâti cet empire colonial dans le sang et les larmes, puisque la colonisation a été rien moins qu'une entreprise de génocide : Jules Ferry, c'était, déjà, Hitler !. Contrevérités, billevesées, bricolage... voilà en quoi consiste le réquisitoire des Repentants, que l'auteur de ce livre a entrepris de démonter, à l'aide des bons vieux outils de l'historien - les sources, les chiffres, le contexte. Pas pour se faire le chantre de la colonisation, mais pour en finir avec la repentance, avant qu'elle transforme notre Histoire en un album bien commode à feuilleter, où s'affrontent les gentils et les méchants."