Les éditions Flammarion viennent de publier un roman de Bernard Quiriny intitulé Le village évanoui. Professeur de droit public, Bernard Quiriny écrit là son deuxième roman, mais a également à son actif trois recueil de nouvelles, dont les savoureux Contes carnivores (Seuil, 2008), hantés par Gould son personnage fétiche... Nous reproduisons l'entretien qu'il a donné au Figaro à l'occasion de la parution de ce roman.
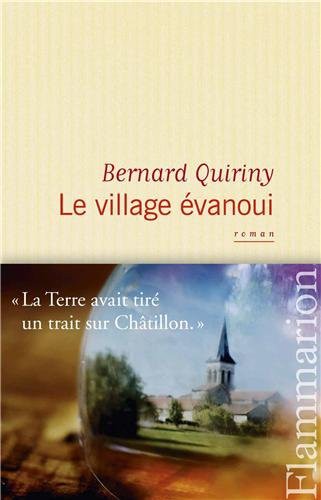
Bernard Quiriny: «Et si demain nous étions coupés du monde?»
LE FIGARO. - Comment avez-vous eu l'idée d'imaginer ce que deviendrait un village français contemporain soudain coupé du monde?
Bernard Quiriny. - J'avais envie de poser des questions sur notre place dans le grand capharnaüm où nous vivons actuellement et sur ce qui se passera quand nous en serons coupés, ce qui finira forcément par arriver. Il y a cent ans, nous vivions dans un environnement qui allait jusqu'aux bourgs voisins ; aujourd'hui, il s'est élargi à la planète. Nous sommes distraits en permanence de notre vie par des événements lointains. Et nous dépendons de la terre entière. Cela m'amusait de montrer qu'en cas de crise qui nous couperait du monde, les valeurs seraient renversées: l'intellectuel serait démonétisé, l'informaticien aussi, tandis que la cote des paysans et des savoir-faire pratiques remonterait en flèche. Par ailleurs, nous vivons dans un pays centralisé où tout est organisé par l'État. Face à l'obligation de se prendre en main collectivement, comme mes villageois, comment réagirions-nous?
Pourquoi avez-vous choisi de faire cette expérience imaginaire dans un village et pas dans un quartier de Paris, par exemple?
Dans un arrondissement comme le VIe, où nous sommes, les protagonistes auraient tenu deux semaines, après ils se seraient tous entretués faute de vivres, puisqu'on ne peut pas manger des chemises Armani. Le roman aurait donc tourné court. Cette situation d'autarcie ne pouvait être viable que dans un village, avec des ressources et des terres cultivables. Et puis j'avais envie d'un roman à la Clochemerle…
Au fond, vos personnages se retrouvent en l'espace d'une nuit dans une configuration féodale?
Oui, à ceci près que si les conditions spatiales redeviennent féodales, les mœurs, elles, sont d'aujourd'hui. Ce qui crée des frictions… Mais c'est vrai, et je ne l'avais pas prémédité, qu'au bout d'un temps, un paysan plus volontaire que les autres crée une sorte de seigneurie où ceux qui le veulent peuvent venir travailler et vivre, tandis qu'une poignée de jeunes gens crée un monastère. Si le prix du baril de pétrole flambait et que l'énergie vînt à manquer - finis les avions et les voitures -, nous pourrions en revenir à cette géographie quasi féodale. Que se passerait-il?
Vous confrontez deux figures d'hommes politiques.
En quelque sorte. Il fallait un trouble-fête pour faire rebondir l'histoire: j'ai donc imaginé ce paysan qui fait sécession pour empêcher la municipalité de réquisitionner ses stocks. Face à lui, le maire, qui est un brave gestionnaire. Dans un premier temps, les habitants se satisfont de cet édile qui gère prudemment la crise et fait en sorte que ses administrés ne meurent pas de faim. Mais à mesure que le temps passe et qu'ils perdent l'espoir d'être un jour reconnectés au monde, ils ont besoin d'un chef plus charismatique, qui leur donne une perspective. La gestion à la corrézienne ne suffit plus, il leur faut l'appel de Londres. On voit aussi que, selon leur caractère, certains préfèrent le côté rassurant du gestionnaire, et d'autres, l'homme qui prend des risques mais donne un élan. Je n'aimerais pas trop vivre une telle crise parce que j'aime la stabilité. La moindre panne de courant me panique. Mais si ça arrivait, je serais curieux de voir comment les politiques réagiraient.
Vous n'êtes pas tendre avec l'homme de gauche qui propose de tout mettre en commun…
C'est un idéologue. C'est amusant de mettre en scène des imbéciles. Je voulais montrer aussi les différentes options en cas de pénurie. En réalité, ceux qui sont communisants dans ces moments-là sont d'abord ceux qui ont faim.
Lorsqu'il accuse le paysan qui a fait sécession d'être sectaire, vous écrivez qu'il projette sur l'autre sa propre intolérance.
Rien n'est plus intolérant qu'un apôtre de la tolérance. Le réel finit toujours par mettre à mal ses bons sentiments. Il prône l'indulgence universelle, puis, le jour où on lui vole son portefeuille, il réclame le retour de la guillotine.
Vous décrivez avec une certaine ironie le regain de foi des habitants.
Face à un événement qui nous dépasse, il est naturel de se poser des questions spirituelles, auxquelles nous réfléchissions jadis le dimanche, avant de préférer faire nos courses ce jour-là. Un choc peut provoquer une conversion. Cela dit, aller à la messe pour des raisons utilitaires, comme les villageois du roman, ce n'est pas encore une conversion.
Vous semblez néanmoins éprouver une certaine sympathie pour votre prêtre.
J'aime bien les personnages de curés.
Au début du roman, on a le sentiment que le retour à un espace à taille humaine vous stimule et vous réjouit: les habitants montrent qu'ils ont des ressources, ils s'entraident. Puis l'hiver arrive et ça dérape. Vous avez une vision pessimiste de la nature humaine?
Réaliste, plutôt: ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il est inutile d'en demander trop à l'homme. Il est capable de réalisations grandioses, mais, face à la nature, et a fortiori au surnaturel, il reste un vermisseau. Alors oui, on peut voir ça comme une satire de l'orgueil, de l'homme qui se croit capable de tout et qui se veut souverain.
Au fond, vos villageois baissent les bras quand ils n'espèrent plus rien?
Oui. Et je ne leur jette pas la pierre. Après la stupeur initiale et les efforts déments pour s'adapter, ils prennent la mesure de leur petitesse. Que la planète soit grande ou minuscule, le fond de l'homme reste le même.
Bernard Quiriny (Le Figaro, 13 février 2014)
