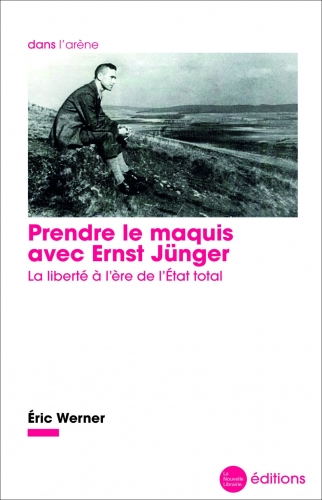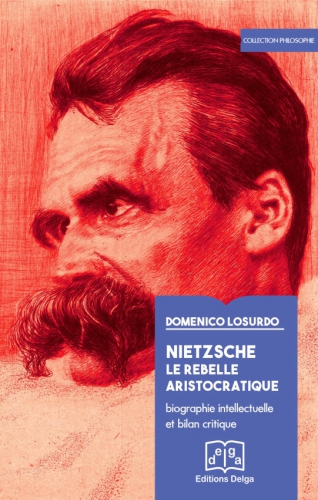Rester ce que nous sommes. De la sécession intérieure à la reconquête
Sécession ou reconquête ? Pour bien comprendre le sens de la question que posent aujourd’hui nos partenaires d’Academia Christiana, il faut revenir a minima sur la signification de ces deux mots. « Reconquérir » signifie récupérer par la lutte ce que l’on nous a pris. « Faire sécession » signifie au contraire s’exclure volontairement de quelque chose qui nous appartenait, mais dans lequel nous ne nous reconnaissons plus, quelque chose qui nous est devenu insupportable, peut-être justement parce qu’il nous a été pris d’une manière ou d’une autre. Faire sécession, c’est donc affirmer vouloir se séparer d’une partie de nous-même pour masquer discrètement le fait que nous ne sommes plus capables de la maintenir en l’état hic et nunc. Par comparaison, choisir la sécession plutôt que la reconquête, c’est donc préférer une forme de fuite discrète à une « extension du domaine de la lutte », notamment quand une voie plus facile suggère qu’elle pourrait être perdue d’avance. Cette façon d’envisager l’action est évidemment totalement incompatible avec les positions de l’Institut Iliade, qui affirme au contraire son objectif de reconquête intégrale. Mais elle est également contre-productive, pour ne pas dire incohérente.
Faire sécession, nous venons de le dire, implique une séparation vers quelque chose d’autre qui, par définition, sera nécessairement différent. Or, l’objectif n’est pas de devenir différent, mais de le rester : être ce que nous sommes où nous sommes, en revendiquant ce que d’autres appelleraient un « droit à la continuité historique », au sein des territoires qui ont justement été construits à travers cette continuité historique en la véhiculant concrètement. Qui sommes-nous sans les paysages, les villes où les quartiers qui nous ont vu naître ? Des déracinés ? Des migrants ? L’allusion paraît facile, mais il est également très facile de la solidifier par l’exemple. Historiquement, il existe en effet deux façons d’envisager concrètement la sécession.
La première est aujourd’hui assez éloignée de nos préoccupations contemporaines, mais elle reste essentielle pour la démonstration. Elle fait référence aux communautés confessionnelles qui, à l’époque moderne, ont pris le chemin d’une expatriation lointaine et durable. Historiquement, on ne peut nier que pour les quakers anglais ou les anabaptistes de l’espace germanique, le départ outre-Atlantique a été l’occasion de créer ailleurs un Nouveau monde, susceptible de transcrire leurs idéaux dans une réalité vierge. Deux questions émergent de ce constat : 1. Avaient-ils le choix ? ; 2. Qu’ont-ils fait là-bas ? Nous n’avons pas le temps ici de répondre précisément à ces questions, mais il est aujourd’hui clair qu’ils y ont fondé quelque chose qui, étant essentiellement le produit du messianisme vétéro-testamentaire, s’est largement éloigné de la tradition européenne. Par ailleurs, leur utopie de société nouvelle n’a su partiellement se conserver que dans le cadre de communautés fermées, condamné à la mise à distance d’un monde sur lequel ils n’ont pas prise. Il suffit pour cela de penser aux communautés Amish aux États-Unis, ou aux Huttites du Canada.
Secondement, en France, un autre exemple nous vient des « communautés » artificielles, plus ou moins sectaires, fondées dans les années 1960 et 1970 par une approche dite hippie. Elle souhaitait bâtir une société nouvelle, réunie par une idéologie commune, extrêmement sensible à certaines valeurs, mais à certaines valeurs seulement. Ce faisant, en partant « élever des chèvres dans le Larzac », pour ne prendre que ce cas particulièrement caricatural, elles ont en réalité construit un monde « hors-sol » idéalisé, en opposition au monde « réel » qui a continué à avancer sans elles. Un alter-monde, en somme, soumis à l’adoption de règles logiques perçues comme « supérieures », mais qui se situent en réalité à l’antipode de la complexité qui nous a été transmise depuis l’antiquité grecque, à une époque où la culture européenne n’envisageait pas l’opposition autrement que comme une forme constructive de « complémentarité des contraires ».
On comprend donc que cette forme de sécession traduit politiquement un des « instincts » de conservation les plus élémentaires : la mise à l’abri, la retraite, la rétraction sur une base vitale. Il s’agit de quitter physiquement une situation devenue intolérable pour un mode de vie plus sécurisant, plus familier, plus apte à s’inscrire avec cohérence dans une certaine vision du monde. Dans le règne animal, cet instinct de préservation, qui consiste à fuir le danger, relève de la capacité de survie. Chez l’être humain en revanche, il ne constitue pas véritablement un instinct de survie, mais plutôt un confort lié à un besoin de stabilité intérieure. D’un point de vue psycho-social, le sécessionnisme apparaît donc comme un escape game collectif visant à recréer ailleurs et à une autre échelle une réalité collective identifiée comme « plus digne ». L’ensemble tient à un seul et même facteur : le sentiment d’impuissance, l’impossibilité de l’action et l’espoir de les recouvrer dans une réalité alternative.
Ainsi, quand on entend aujourd’hui le gouvernement se poser à lui-même la question de la localisation des migrants, « fraîchement arrivés » (selon l’expression médiatique) dans les campagnes de France, on peut évidemment se demander où s’arrêtera la fuite en avant pour ceux qui sont entrés dans l’engrenage sécessionniste. Nous avons à notre disposition toute la France, puis l’Europe, puis les cinq continents, puis la Terre entière, puis le cosmos et l’espace intersidéral. Autant dire qu’il existe une marge pour organiser de nouveaux flux migratoires à l’ombre du drapeau « No Border ». Face à cette absence théorique de limite, il est donc fondamental de raisonner à la bonne échelle. C’est un souhait légitime que nous devons nous approprier en mobilisant toutes les armes idéologiques, culturelles, économiques, artistiques et politiques qui sont à notre disposition, en sachant pertinemment que certaines ne peuvent être inventées que par nous-même, à travers la pluralité des points de vue que constitue notre héritage européen. Le monde à reconquérir n’est pas ailleurs, il est ici, déjà ébréché par la profondeur des changements que nous lui imposons collectivement et individuellement avec la tenue, le style et le panache qui sont les nôtres.
Ce que l’on doit regretter in fine, c’est que l’Europe des élites ait déjà elle-même fait sécession face aux valeurs qui sont historiquement les siennes. Comment l’aider dans cet exercice de reconquête tous azimuts ? Pour commencer, on peut évoquer la figure du Rebelle d’Ernst Jünger. S’il lutte contre Léviathan, c’est avant tout dans sa « sécession intérieure » que le Rebelle, par le « recours aux forêts », retrouve sa souveraineté en tant qu’« individu ». Dans toute la profondeur et la subtilité du développement jüngerien, il reste partagé entre une forme de liberté (assimilable ici à la sécession) et une forme de nécessité (ici à la reconquête). La sécession y apparaît avant tout comme une lutte intérieure, une lutte de l’être, une réflexion sur soi-même qui constitue le travail de toute une vie.
Une sécession « extérieure », sous ses différentes formes, serait une action bien consciente, un choix de vie ou un projet à réaliser. La sécession intérieure, quant à elle, s’apparente davantage à un phénomène inconscient, dont nous sommes moins le sujet que l’objet. De ce fait, nous ne sommes pas en sécession parce que, au terme d’une réflexion ou d’une expérience, nous décidons de rompre avec le monde tel qu’il est. Nous sommes en sécession précisément parce que nous n’adhérons pas à la réalité actuel du monde. En ce sens, notre sécession est un état, et non un acte. On ne fait pas sécession, on est en sécession. Tout l’enjeu consiste donc, et c’est ce qu’il convient de souligner, à ne pas céder à une mise à l’écart superficielle pour fuir ce sentiment de rupture. Il faut au contraire en sonder toute la profondeur, ressentir le vertige de l’abîme tout en continuant à se confronter à la réalité telle qu’elle est. Pour cela, il est nécessaire de donner une orientation à notre sécession, c’est-à-dire un horizon poétique et spirituel capable d’ouvrir la voie à un cheminement intérieur qui réponde aux exigences du combat.
Pour autant, si l’on envisage l’engagement politique comme la confrontation active au monde réel tel qu’il est, dans toute son hostilité, le recours à un monde préservé par ses grandes permanences (réelles ou abstraites) s’impose comme une nécessité. Et c’est bien là le sens qu’il faut donner à la métaphore du Recours aux forêts. Car une reconquête qui constituerait une lutte factice, sans réel fondement, est vaine. Elle doit au contraire s’inscrire dans la continuité d’un combat intérieur, nourri et orienté par notre longue mémoire.
En lieu et place d’une sécession trop facile, l’Institut Iliade privilégie donc le ressourcement comme une base arrière privilégiée et mobilisable pour un combat authentique. Le renouement avec les grands espaces, la soustraction aux mécanismes des technostructures, l’immersion dans une convivialité élégante et pacifiée, s’ils présentent toujours un risque de désertion face au combat, doivent justement nous donner le courage et la force de l’emporter. Les grands monastères de l’Occident chrétien n’ont pas été construits pour offrir à quelques-uns la possibilité de cultiver une vie intérieure loin du tumulte du monde. Les moines, depuis leurs monastères, ont donné forme au monde, et toute leur vie spirituelle a été mise au service de ce qu’ils concevaient comme une lutte eschatologique. Aujourd’hui, c’est dans nos villes ou derrière les murs de nos maisons de campagne, dans nos cercles d’amis, à l’ombre des grandes œuvres de la tradition européenne, que se tiennent partout, en secret, les conseils de guerre de la grande reconquête politique et spirituelle.
Pôle Étude de l’Institut Iliade (Institut Iliade, octobre 2022)