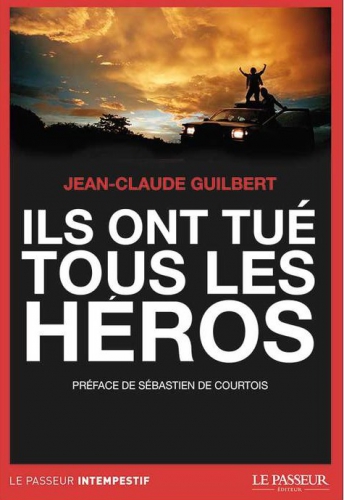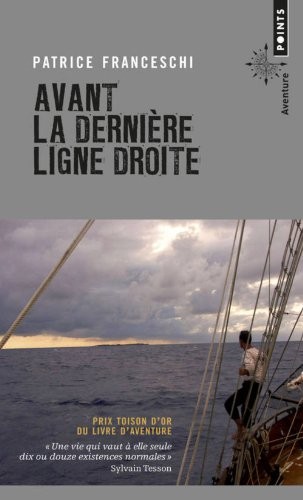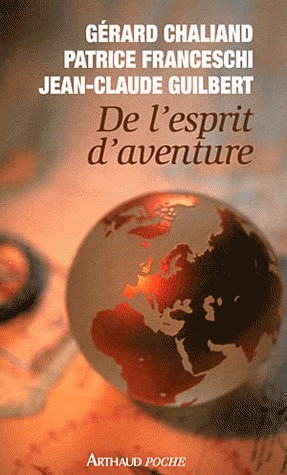Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Patrice Franceschi au Figaro Vox et consacré à l'aversion morbide de notre société pour le risque. Écrivain et aventurier engagé, Patrice Franceschi a publié de nombreux récits et témoignages et quelques essais, dont Éthique du samouraï moderne (Grasset, 2019) et dernièrement, avec Andrea Marcolongo et Loïc Finaz, Le goût du risque (Grasset, 2023).

Patrice Franceschi: «L’homme occidental a oublié que le risque fait intégralement partie de la vie»
LE FIGARO. – Du XIXe siècle jusqu'au siècle dernier, le risque est valorisé, lié au développement du progrès. Après la première grande catastrophe ferroviaire en France en 1842, Lamartine s'exclame à la Chambre : «La civilisation a aussi ses champs de bataille : il faut que des hommes y tombent pour faire avancer les autres.» Aujourd'hui, à l'inverse, nous avons perdu le goût du risque. Comment s'est produit ce renversement ? Comment se manifeste-t-il aujourd'hui ?
Patrice FRANCESCHI. – Ce qu'il importe de comprendre en premier lieu, c'est que l'aversion au risque est devenue l'une des maladies centrales de l'Occident et que cette aversion est une clef d'explication de tout ce qui «décompose» aujourd'hui notre société. C'est sous ce prisme précis que nous avons écrit Le goût du risque, Andréa Marcolongo, Loïc Finaz et moi-même. Et c'est son originalité.
En moins d'un siècle, l'homme occidental est tombé dans un grand oubli : celui du lien consubstantiel entre le risque et la vie. Il ne sait plus – ou ne veut plus savoir – que le risque fait intégralement partie de la vie. Il lui est même si intimement lié que le «contrat de départ» de nos existences individuelles n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité : nous naissons pour mourir et aucune protection contre le risque n'empêchera cette fin programmée.
Il faut accepter de voir les choses comme elles sont, et dire ce qu'elles sont. Rien ne peut être entrepris sans prise de risque – et en premier lieu aucune action ou pensée ouvrant des routes nouvelles. Vu sous cet angle, le risque est au fondement de toute nouveauté, de toute révolution. Le basculement vers le refus du risque, dans nos existences quotidiennes comme dans les grands projets collectifs, a eu lieu progressivement. Le confort procuré par la modernité s'est conjugué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à un individualisme sans frein doublé d'un narcissisme exacerbé qui nous ont poussé à une quête éperdue de sécurité au détriment de toute liberté si tel est le prix à payer. Cela fait de nous aujourd'hui des peuples effrayés dirigés par des gens effrayés.
Avant ce grand basculement, la liberté était considérée comme la valeur suprême permettant d'irriguer toutes les autres pour leur donner sens. Et l'on prenait tous les risques pour elle. Désormais, la liberté est une valeur optionnelle.
Si l'on observe bien les choses, nous devons convenir que l'une des grandes impostures intellectuelles de notre époque est de tout tenter pour nous inculquer la croyance quasi millénariste que le risque pourrait être à jamais banni de nos existences par des lois adéquates, des réglementations strictes, un changement radical de nos comportements quotidiens – ce qui revient à nous faire accepter de force une mutation profonde de notre vision de la vie et du monde, et plus encore, de notre façon de vivre librement. Cette imposture nous a menés peu à peu à la fabrique d'une prison nouvelle. C'est notre société qui l'a édifié elle-même, avec de splendides barreaux dorés... Aucun ennemi extérieur n'a été à l'œuvre. D'une certaine manière, nous avons été à nous-même notre propre ennemi, provoquant par une sorte de contre-volonté inconséquente et perverse, notre asphyxie et notre étouffement progressif. Les hommes libres peinent à respirer.
On peut ajouter que dans la mesure où notre consentement collectif à cet état de fait ne nous a jamais été demandé, il y a là comme un déni démocratique qu'il faut contester.
Nos vies sont encadrées par des normes dans leurs moindres détails. Pourquoi y voir un «cauchemar civilisationnel» ? L'essor de l'intelligence artificielle va-t-il en précipiter l'avènement ?
Nous vivons effectivement cernés par une quantité prodigieuse et jamais vue dans notre civilisation, de normes carcérales, de précautions inutiles ou de formatages infantilisants. Ils sont toujours édictés «pour notre bien» cela va de soi. L'ensemble forme un filet entre les mailles duquel il devient de plus en plus difficile de se faufiler pour demeurer maître et possesseur de son destin.
Au final, nous vivons perclus de rhumatismes qui ont pour noms : bureaucratisation effrénée, judiciarisation de notre quotidien, surveillance généralisée de nos comportements, robotisation de nos vies, la liste n'est pas exhaustive tant nous vivons sous algorithmes... Cependant, nul n'a décidé un jour, quelque part, d'en arriver là. Pas de Big Brother caché quelque part, tirant les ficelles du jeu de masque de nos existences. Si un tel tyran existait, il serait aisé de se retourner contre lui. Hélas, les choses se sont faites lentement, par les décisions éparpillées d'un nombre indéterminé mais considérable d'acteurs de tous ordres et de tous niveaux. Perversion des tyrannies molles.
Il va sans dire que les normes en elles-mêmes sont une bonne chose. Qui voudrait voler dans des avions mal conçus où donner à ses enfants des jouets qui les blesseraient faute d'être fabriqués correctement ? Ce qui pose problème, ce n'est pas l'existence de normes mais leur inflation outrancière, au-delà de toute mesure. Dans un souci pathologique de protection à tout prix, nous avons construit des systèmes administratifs qui ne peuvent justifier leur existence que par une production de normes à jets continus dont la somme nous contraint à vivre corseté. La plupart de ces normes sont injustifiées ou largement exagérées, chacun en a conscience mais ne peut rien faire pour s'y opposer. D'une certaine manière, on nous enjoint de consentir à une vie au rabais – au mieux de nous satisfaire de miettes d'existence. C'est le chant de la vie qui est muselé. Toute entreprise un tant soit peu exaltante est tuée dans l'œuf. Or, il faut vivre sans délai tant la fuite du temps est fugace. Aujourd'hui, on interdirait à Christophe Colomb de partir : destination inconnue, retour improbable… Nous en sommes arrivés à un point où les libertés individuelles sont menacées de disparition. Là est le grand péril existentiel de cette affaire.
L'intelligence artificielle ne va rien arranger tant elle pourra fignoler ce système aussi doucereux que pervers. Dans la mesure où il est indolore, peu de citoyens prennent parti de lui résister. Les autres, même s'ils partagent le constat d'une disparition ontologique de leur être, préfèrent se résigner plutôt que lutter. Le résultat final est une forme de servitude volontaire dont l'ambition se limite à la seule liberté de consommer.
Selon vous, même notre manière de faire la guerre a été contaminée par notre aversion du risque. Comment cela se traduit-il ?
En ce qui concerne le fait militaire, tout s'est accéléré avec l'extension du «principe de précaution». À partir du moment où nous avons commis l'inconséquence de l'inscrire dans la Constitution, il ne pouvait que déborder de son cadre initial pour s'emparer de tous les secteurs de la société, armée comprise. C'était une pente juridiquement inéluctable. Ce principe de précaution avait pour souci la protection de la nature pour les générations futures. C'était un excellent principe et il le demeure à jamais. Simplement, sa place n'était pas dans la Constitution mais dans l'action quotidienne des pouvoirs publics.
Le principe de précaution s'est ainsi fait moloch. Il a accouché d'un certain nombre d'aberrations logiques dont la plus fascinante, intellectuellement, est le concept de «guerre zéro mort». Que la guerre ne tue plus personne – sous-entendu chez nous – est un but aussi louable qu'inatteignable par définition. Donner ce but au soldat, même inconsciemment, le mène mécaniquement à donner le primat de son action non plus au succès de sa mission militaire, mais au retour intact au bercail. Résultat : toutes nos guerres se font «à moitié» et nous les perdons sans exception, d’une manière ou d’une autre.
Dans ce domaine, ce ne sont pas les soldats eux-mêmes qui sont responsables – la plupart d'entre eux, surtout les jeunes, ne demandent qu'à accomplir leur vocation pour défendre ce qui leur est cher – mais les chefs, notamment politiques, puisque dans nos démocraties le militaire demeure subordonné au politique.
Vous écrivez que «la sécurité endort les hommes quand la liberté les tient éveillés». Pourquoi opposer sécurité et liberté ?
Parce que cette opposition est une évidence depuis toujours. L'image d'un vase communiquant entre sécurité et liberté est plus pertinente que jamais : plus vous mettez de sécurité quelque part plus vous enlevez de liberté, et vice versa. Dans Le goût du risque, nous n'affirmons jamais que pour vivre libre il faudrait supprimer le désir de sécurité. Ce serait très sot. Nous disons que c'est le «juste milieu» entre ces deux opposés qui est en cause. Le fléau de la balance s'est déplacé vers le «tout sécurité» au détriment du souci de liberté. Il est impératif de rééquilibrer les choses pour vivre dignement.
La peur de la mort est un des principaux facteurs d'inhibition face au risque selon vous. La façon dont a été gérée la crise du Covid en est-elle l'illustration ?
Dans les sociétés occidentales, la mort est devenue un tabou. On la cache, on l'édulcore, on l'euphémise, elle ne nous est plus familière comme aux temps difficiles de jadis. Nous ne l'acceptons plus. C'est une autre des conséquences de nos sociétés de confort et d'individualisme. Ce tabou de la mort s'est mué en totem inattaquable puisque la mort gâche la pleine jouissance d'un consumérisme absolu se voulant modèle de vie.
Jamais dans notre histoire bimillénaire nous n'avons eu aussi peur de la mort. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nos armées ont pour premier principe de l'éviter à leurs soldats, quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire au détriment de l'efficacité au combat s'il le faut, tant leurs concitoyens, comme leurs chefs politiques, leur reprochent le moindre sang versé. Si nous avions été dans cet état d'esprit au cours de la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait eu ni De Gaulle, ni la France Libre, ni Jean Moulin, ni réseaux de résistants. La liberté, hélas, à un prix souvent élevé. Il faut à nouveau consentir à la mort pour ce qui est plus grand que nous, surtout dans une époque où les orages de l'histoire se rapprochent.
Aujourd'hui, le soldat mort au combat pour la défense des siens est devenu un problème politique presque insoluble, celui d'une société qui ne supporte plus la disparition de qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. C'est l'air du temps... Notre société a évacué le fait principal de la condition humaine : le tragique contenu dans cette condition. Or, seul le sens du tragique permet de surmonter les épreuves.
Comme le disaient avec lucidité les philosophes grecs dont la pensée nous a forgés des siècles durant, la crainte de la mort est le début de la servitude. L'injonction de ces penseurs à vivre sans tenir compte de l'effroi provoqué par notre finitude est une leçon que nous devons nous réapproprier. En y ajoutant que la seule chose dont, en vérité, nous devons avoir peur est de mal employer le peu de temps que la vie nous concède avant que le destin nous contraigne à quitter la scène de l'existence. Il faut mesurer la longueur de vie non à l'étalon de la durée, mais à celui de l'intensité.
La gestion de la crise du Covid a été l'illustration de ce qui vient d'être dit. C'est la peur de la mort qui a dicté nos conduites dans cette épreuve, non la volonté de préserver la liberté et le goût de vivre. Et chacun sait qu'être gouverné par la peur est la pire des politiques que puisse subir un citoyen dans une démocratie acceptable.
Quels sont les antidotes à la «maladie du risque» ?
La soif de liberté avant tout. Pouvoir encore dire : vivre libre ou mourir. Et ainsi retrouver l'élan vital du plus puissant principe d'existence qui ait jamais été prononcé en ce bas-monde. Second antidote : l'amour de la vie, puissante et entière.
En définitive, il faut savoir dire non à ce qui abaisse notre humanité – et être prêt à en payer le prix puisque le plus beau des risques reste la liberté.
Patrice Franceschi, propos recueillis par Guillaume Daudé (Figaro Vox, 8 décembre 2023)