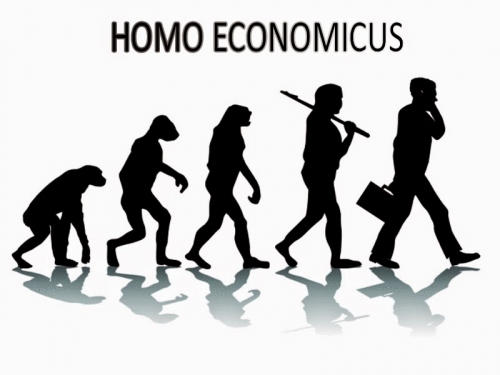Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Frédéric Saint-Clair, cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à l'illusion humanitaire et à celle du droit international à l'heure des conflits entre blocs civilisationnels.
Politologue et analyste en stratégie et en communication politique, Frédéric Saint-Clair a publié un essai incisif intitulé L’Extrême Droite expliquée à Marie-Chantal (La Nouvelle Librairie, 2024).

La guerre à l’heure des grands blocs civilisationnels
La guerre est, aujourd’hui plus que jamais, un phénomène médiatique. Elle est commentée heure par heure, minute par minute, sur les chaînes d’info en continu. Chaque Français est devenu fin connaisseur des régions les plus reculées de l’Ukraine autant que des missiles longue portée iraniens. Et pour ambiancer le tout, les journalistes se survoltent, passent en mode « breaking news », saturent les ondes, chaque fois qu’ils ont l’impression de vivre un moment historique, un moment décisif pour l’avenir du monde : envoi massif de drones sur Kiev, salve de missiles iraniens sur Tel-Aviv… Pendant ce temps, Athéna, la déesse de la guerre, les regarde en ricanant. Car depuis l’invasion de l’Ukraine jusqu’au pilonnage de Gaza, elle n’a pas bougé un sourcil. C’est qu’il y a, dans la mythologie grecque, deux dieux de la guerre : Arès et Athéna. Le premier est attaché à la force brute, au choc frontal et à la destruction ; la seconde est l’incarnation de la mètis qu’elle a héritée de son père, Zeus ; elle s’occupe de stratégie, de la dimension politique de la guerre. Elle a inspiré à Clausewitz, entre autres, sa conception de la guerre comme continuation de la politique par d’autres moyens. La seule question qui devrait nous occuper en ce moment est : à quoi pense Athéna lorsqu’elle regarde les guerres du XXIe siècle ?
Pourquoi Athéna méprise les discours de paix de l’Europe occidentale
Soyons clairs : Athéna ne se soucie pas de l’utilisation de drones, ni de l’obsession technologique de la guerre de manière générale, dont elle ne nie pourtant pas l’importance. Elle ne soucie pas davantage de la querelle sémantique : Hamas, mouvement de résistance ou groupe terroriste ? Selon elle, il s’agit d’un mouvement de résistance. Non pas pour les raisons évoquées par LFI, mais pour des raisons théoriques, parce que le terrorisme est un moyen, pas une fin. Tout comme la guerre d’ailleurs. Le Hamas est, à ce titre, plutôt un mouvement de résistance engagé dans une guérilla, menant parfois une guerre irrégulière contre une armée régulière, Tsahal, et parfois organisant des attaques terroristes contre les populations civiles. Athéna se dit que, de toutes façons, ceci a peu d’importance ; la question qui l’occupe en ce moment est : jusqu’à quand l’Occident soutiendra-t-il une solution impossible à deux États ? Quand le nationalisme islamique et le nationalisme hébreux, tous deux habités par le principe d’un seul État, se retrouveront-ils face à face ? Il ne peut en être autrement. Et la guerre ne cessera pas tant qu’une solution territoriale quasi unitaire ne sera pas trouvée. Ce que l’Occident nomme « radicalisation » du conflit israélo-palestinien est en réalité une clarification inédite et salutaire. La confrontation Iran-Israël est à ce titre un grand pas en avant vers une solution négociée puisqu’enfin les deux véritables protagonistes sont face à face, à couteaux tirés. Quelle place les pays de la région sont capables de faire à une diaspora palestinienne refusant de vivre sous un État israélien quasi global et accueillant la part du peuple palestinien désireux d’y résider en paix est l’unique nœud que le dialogue diplomatico-militaire Israël-Iran mérite de trancher. Athéna le sait, même si elle n’en parle pas… car personne n’est encore prêt à l’entendre.
Mais revenons un instant au réalisme politique d’Athéna, et à la question plus globale de la guerre au XXIe siècle. Rappelons que l’entrée du monde dans le XXIe siècle se fait par deux chocs consécutifs : les attentats du 11 septembre 2001 et l’entrée de la Chine dans l’OMC au mois de décembre de la même année.
1°) L’irruption du Choc des civilisations dans la grammaire des relations internationales.
2°) Le basculement à l’Est de l’ordre du monde signant la défaite du projet néo-libéral formalisé dix ans plus tôt par Francis Fukuyama.
Fin de partie pour les idéalistes
Voilà plus de vingt ans que cela s’est produit, et on entend encore, tous les dimanches sur France Culture, le même vieux discours libéral-idéaliste d’un Bertrand Badie. Athéna, qui ne pense pas de manière « morale », s’en agace parfois. Elle s’irrite de l’habitus idéaliste de l’Europe de l’Ouest : « La guerre c’est mal » ; « Nous devons œuvrer résolument à l’établissement de la paix » ; « La première condition est d’obtenir un cessez-le-feu » ; « Il faut protéger les populations civiles à tout prix » ; « Le droit international a été bafoué » ; « Les criminels de guerre doivent être traduits en justice ». Or, Bertrand Badie, icône du social-libéralisme intellectuel en matière de relations internationales, prend toujours l’exact contre-pied d’Athéna. Pour s’en convaincre, deux ouvrages, entre autres : La Fin des territoires (en 1995) et L’Impuissance de la puissance (en 2004). Autant dire qu’il a faux sur toute la ligne. Mais il persiste ! Voici deux citations qui ne résument pas seulement sa pensée, mais celle de toute la classe politique progressiste française : « Penser le monde à travers une filiation où se succèdent Hobbes, Metternich, Clausewitz, Carl Schmitt et Kissinger ne permet plus d’accéder à la complexité du jeu international qui a cours aujourd’hui » et « Dès les « quatorze points », Wilson réintroduisait le rôle équilibrant des sociétés… L’ancien professeur de Princeton était certain que l’ordre triompherait par la démocratie, et donc par le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, complété des vertus de la délibération collective. Les nations libres devaient décider entre elles de la marche du monde, selon les codes naissants d’un multilatéralisme que la SDN devait annoncer. »
Rappelons-le, encore et encore : si, Hobbes, Clausewitz, Schmitt et Kissinger sont essentiels pour comprendre notre monde ! Et, pour ceux qui souhaitent poser un regard pertinent sur le conflit russo-ukrainien, La Grande Rupture de Georges-Henri Soutou est sans nul doute l’ouvrage à lire : revisiter l’époque Eltsine en Russie ; se remémorer le rejet de la greffe libérale à la fois par les communistes post-URSS et par les nationalistes ; comprendre le changement de paradigme résolument impérialiste de Bill Clinton, dont le wokisme actuel est largement issu ; rappeler les contradictions de l’Europe occidentale, une Europe de l’Ouest que Robert Kagan associe à la faiblesse quand les États-Unis – démocrates et républicains confondus – persistent dans une logique de puissance. C’est l’idéal wilsonien, lequel anime autant un Badie qu’un Macron, qui est mort ! Les penseurs de la puissance sont, à l’inverse, plus vivants que jamais ; indispensables pour comprendre un monde où se superposent deux logiques : une logique civilisationnelle oubliée du XXe siècle, principalement lors de la guerre froide, mais omniprésente au XXIe, et une logique impérialiste réhabilitée.
Empire et bloc civilisationnel
Les blocs civilisationnels ont ceci de spécifique qu’ils mélangent habilement hard power et soft power. Ces grands espaces se conçoivent comme des empires à part entière. L’Union européenne ne fait d’ailleurs pas exception. L’obsession macroniste visant à nier la souveraineté propre de la France pour faire de celle-ci une région de l’Europe – si possible la principale ; la multiplication des discours de propagande affirmant que telle ou telle question (immigration, industrialisation, etc.) ne peut pas être réglée au niveau national, mais seulement au niveau européen, sont autant de signes témoignant d’une volonté impériale européenne. Une spécificité : l’annexion territoriale ne se fait pas par la guerre, mais par l’adhésion contrôlée des pays postulant. Pas de coercition dans l’univers idéologique wilsonien, mais une coopération basée sur l’accord des peuples (et quand ils ne veulent pas, les responsables politiques progressistes les aident un peu…). Le trumpisme, aux États-Unis, rime également avec néo-impérialisme. Le moyen et la fin sont tout autres en revanche. Le projet d’hyper-puissance demeure, mais il a muté : on ne parle plus seulement d’imposer un régime démocratique et libéral à la planète par les armes – en n’oubliant jamais les contreparties financières –, mais aussi d’annexion territoriale en bonne et due forme, de prise de terre, pour parler comme Carl Schmitt : Canal de Panama, Canada, Groenland… La logique russe n’est pas très différente. Le moyen seul diffère. À ce titre, la guerre russo-ukrainienne n’est pas un objectif militaire en soi, ni même strictement politique. Seule la guerre civilisationnelle sous-jacente importe – d’un côté comme de l’autre d’ailleurs, pour la Russie comme pour les pays membres de l’Otan.
Parce que les empires mélangent habilement soft et hard power, aucune forme de puissance ne mérite d’être négligée. C’est ainsi que nous vivons probablement le siècle non pas de la « guerre totale » – dont Ludendorff est le théoricien et qui n’a rien à voir avec cela –, mais de la puissance totale. Le soft power civilisationnel a été reconnu par les blocs chinois, russe et islamique comme le fondement de toute puissance digne de ce nom. Ils ont retrouvé ce que l’Occident romain avait rangé sous le vocable imperium et qui comprenait une dimension éminemment spirituelle. Dimension que l’Europe de l’Ouest, sous l’influence combinée du matérialisme athée socialiste et du sécularisme « laïc » libéral, a détruite. Dès lors, comprendre la guerre russo-ukrainienne, c’est comprendre la réaffirmation de la dimension eurasienne de la Russie au travers du conflit, avec en ligne de mire l’offensive idéologique woke d’une partie de l’Europe et des États-Unis. L’incompatibilité entre le modèle de développement progressiste occidental et le trio Russie-Chine-Islam est désormais totale. La recomposition du monde en blocs civilisationnels adverses suppose une concurrence féroce dans la constitution de ces blocs. Et s’il faut la guerre, il y aura la guerre. Car l’économie se reconstruit, parfois avec une étonnante facilité. La civilisation et son socle spirituel, non. La fracture idéologique qui traverse l’Ukraine – et qui est politiquement affichée depuis l’Euromaïdan de novembre 2013 – ne pouvait pas ne pas poser la question de la fracture territoriale du pays. Si Poutine a échoué à ramener Kiev à lui. S’il a échoué à imposer militairement la supériorité de la Russie. Il a en revanche réussi à tracer une frontière culturelle, civilisationnelle, encore politiquement imprécise à ce jour, car tout se décide en ce moment-même, mais dont on sait d’ores et déjà que l’Histoire retiendra qu’elle est la nouvelle ligne de démarcation de la guerre civilisationnelle globale ouverte en 2001. L’objectif ? Convaincre ou annexer. Dominer. Refaçonner de nouveaux hegemon. Et surtout, mettre un terme à une époque, celle des Badie & Co, celle du droit international sacralisé, celle des institutions internationales vénérées, celle même des droits de l’Homme divinisés. Celle du progressisme occidental. Athéna sait que la morale progressiste ne fera pas le poids face au soft power des centres spirituels russes, chinois et islamique. D’où ce léger ricanement que l’on entend parfois lorsqu’on éteint les chaînes d’info en continu.
Frédéric Saint-Clair (Site de la revue Éléments, 15 juillet 2025)