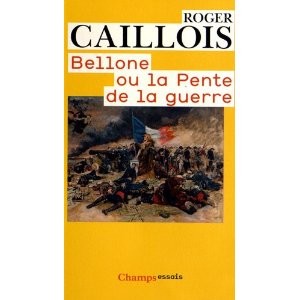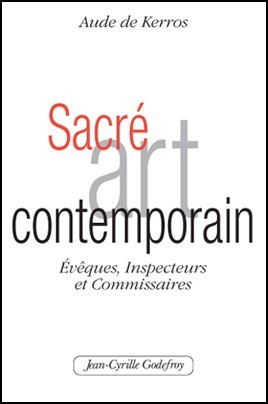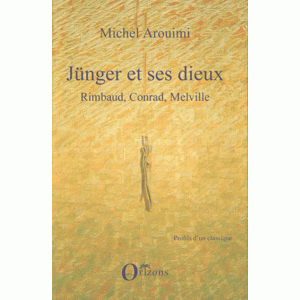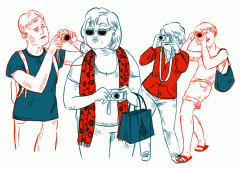Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la question de la représentation du divin dans les différentes religions...

« Iconoclastes contre iconodules : une histoire vieille comme les religions… »
Avec la tuerie perpétrée à Charlie Hebdo, un débat est redevenu d’actualité : la légitimité d’une représentation du sacré, que ce soit pour l’exalter ou le dénigrer. Dans l’islam, est-il donc interdit de représenter le Prophète ?
On connaît dans le monde musulman un certain nombre de représentations du Prophète, notamment sur des enluminures et des miniatures persanes ou turques. Mais il est vrai qu’il s’agit d’exceptions. En règle générale, la tradition islamique condamne la représentation imagée. Le Coran est pourtant parfaitement muet sur la question. Il dénonce bien sûr les « idoles » (al-âçnâm), mais les termes « image » (çûra) et « représentation » (rasm) sont totalement absents. C’est en fait vers la tradition qui se met en place à partir des VIIe et VIIIe siècles, et vers les recueils de h’adîths codifiés dans la seconde moitié du IXe, qu’il faut se tourner pour trouver les bases de l’aniconisme musulman. Al-Bukhâri, par exemple, déclare que « les anges n’entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images ». À la fin du VIIe siècle, la célèbre réforme monétaire du calife Abd al-Mâlik interdit de faire figurer des visages sur les pièces de monnaie.
Par la suite, l’hostilité aux images ne cessera de s’accentuer, surtout chez les sunnites, comme en témoigne la célèbre fatwâ du juriste shaféite syrien al-Nawawî, au XIIIe siècle : « Les grandes autorités de notre école et des autres tiennent que la peinture d’une image de tout être vivant est strictement défendue et constitue l’un des péchés capitaux […] parce qu’elle implique une copie de l’activité créatrice de Dieu. » La calligraphie, née dans les mosquées, permet alors de ramener le Prophète à un graphème. À l’inverse, on observe dans le monde iranien, et notamment dans le mysticisme soufi, une approche de la question nettement plus nuancée, tant dans la pratique que chez les exégètes.
Le paganisme n’était pas avare de représentations divines, en fresques, peintures ou statues, au contraire du monothéisme qui les prohibait. Comment expliquer cette différence fondamentale ?
« La religion grecque est la religion même de l’art », disait Hegel. C’est en tout cas en Grèce qu’elles ont connu l’une et l’autre leur plus bel épanouissement. L’usage des statues (agalmata), en particulier, est constitutif de la cité grecque. Le divin chez les Grecs se constate, s’éprouve en ce qu’il se donne à voir (et ce voir est indissociable d’un savoir). Pour les Européens, il a toujours été impensable de séparer la divinité de la beauté, elle-même indissociable de l’expérience de la vue.
Au contraire, la tradition biblique tend à dévaloriser la vue au profit de l’écoute (« Chema Israel », Deut. 6,4), qui commande un mode de compréhension plus abstrait, moins lié au sensible. Comme l’a écrit Régis Debray, dans le monothéisme, « seule la parole peut dire la vérité, la vision est puissance de faux ». Dans le Décalogue, la prescription iconoclaste constitue le second « commandement » : « Tu ne te feras aucune image taillée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux » (Exode 20, 4 et 34,17 ; Lév. 26, 1 ; Deut. 5, 8, etc.). Cette interdiction des images figurées est en rapport immédiat avec la proscription de l’« idolâtrie », c’est-à-dire de toute forme de culte étranger (« Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi »). L’« idole », en grec éidôlon, désigne ce qui se donne à voir. Mais dans la Bible, la transcendance absolue ne peut être ramenée à une représentation particulière. Cette vieille opposition du concept et de l’image, c’est aussi celle que l’on retrouve entre l’art figuratif et un « art contemporain » qui tend à privilégier l’abstraction.
Au sein même du christianisme, le débat a fait rage entre iconoclastes et iconodules. Et dans les temples protestants, il y a des croix, mais pas de Christ dessus…
Dans les premiers siècles de notre ère, l’art chrétien est presque inexistant. Issu du judaïsme, le christianisme a hérité de sa réticence de principe envers les représentations figurées. Il doit en outre se différencier du paganisme, qui fait grand usage des statues. Au début du IIIe siècle, Clément d’Alexandrie rappelle ainsi qu’il est interdit aux chrétiens « de produire des œuvres trompeuses, car Moïse a dit : Tu ne feras pas d’images… » Comme en outre les évangiles ne disent strictement rien de l’apparence physique de Jésus, la représentation que pourrait en donner les artistes serait nécessairement arbitraire : « Nous ne connaissons pas son apparence », dit saint Augustin. Tertullien, dans son De idolatria, manifestait déjà la même réticence. Eusèbe de Césarée, dans une épître adressée vers 315 à l’impératrice de Byzance, affirme qu’il est matériellement impossible de représenter le Christ : la fusion en lui de l’élément divin et de l’élément humain rend par avance blasphématoire tout portrait que l’on pourrait donner de lui. Les icônes ne deviendront courantes qu’à partir du VIe siècle, mais ne recevront de véritable justification doctrinale que deux siècles plus tard.
À partir de 1200, Orient et Occident empruntent des voies différentes. Tandis que dans la chrétienté orientale, l’image se fige dans le modèle de l’icône, l’art religieux explose sous toutes ses formes dans la plupart des pays d’Europe occidentale. L’image, du même coup, perd de son caractère proprement sacré, même lorsqu’elle continue à représenter des sujets religieux. Le grand art chrétien relève désormais avant tout de l’esthétique, tandis que le culte des images à l’ancienne se perpétue plutôt dans les ex-voto, les images de dévotion, les tableaux de mission ou de confréries. Le protestantisme reprendra plus tard à son compte la vieille prescription iconoclaste. C’est pour la même raison qu’il rejettera le culte marial et le culte des saints, trop proches selon lui du polythéisme.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 10 février 2015)