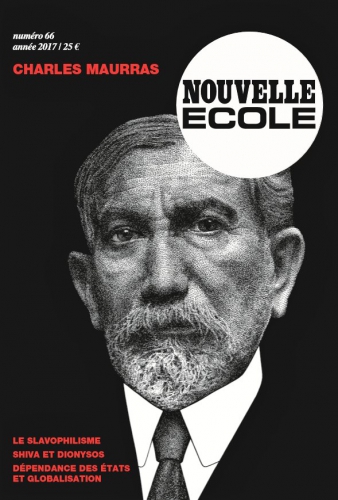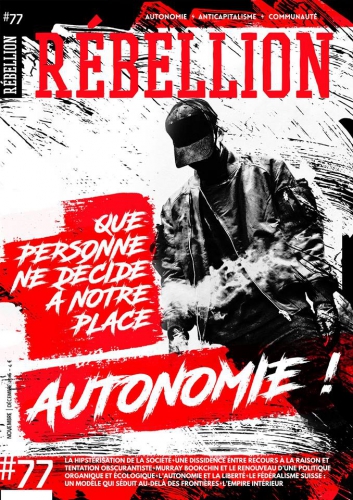Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Voxnr et initialement publié sur Philitt, consacré à la question du cosmopolitisme...

Alain de Benoist : « Le cosmopolitisme bute sur une aporie »
PHILITT : L’optimisme d’Érasme, « prince des humanistes », l’amenait à réfléchir sur les conditions de possibilité d’une Europe de la culture. Vous voyagez beaucoup sur le Vieux Continent, notamment en Italie où vous êtes, semble-t-il, plus connu qu’en France. Quel regard portez-vous sur l’idéal du philosophe de Rotterdam ?
Alain de Benoist : Il y a toujours eu une culture européenne, qui s’est muée très tôt en une « Europe de la culture ». Mais à partir de 1890, l’idée que la culture européenne puisse être un facteur d’unité du continent a progressivement reculé. Après 1945, le point de vue de Jean Monnet l’ayant emporté sur celui de Denis de Rougemont, la construction européenne s’est délibérément faite sur la base de l’économie et de la finance, non sur celle de la culture ou de la politique. Aujourd’hui, le problème se pose différemment dans la mesure où ce que recouvre le mot « culture » n’a plus grand-chose à voir avec ce que l’on entendait autrefois par là. Ce qui revient à dire que, si l’on veut s’interroger sur les chances de renaissance d’une « Europe de la culture», il faut d’abord prendre la juste mesure des « productions culturelles » d’aujourd’hui.
Dans quelle mesure le projet cosmopolite peut-il échapper à la réduction au Même ? Par essence, le cosmopolitisme ne met-il pas en danger la diversité des cultures, des traditions et des modes de pensée ?
Tout dépend de la définition que l’on donne à ce mot, qui n’apparaît en France qu’au XVIIIe siècle : c’est en 1721, dans le Dictionnaire de Trévoux, qu’il remplace le mot « cosmopolisme » (auparavant, ce n’était qu’un terme de botanique). Historiquement, il n’est pas douteux que le cosmopolitisme a partie liée avec l’universalisme, lui-même nécessairement associé à l’individualisme pour former ce que j’ai appelé l’idéologie du Même, cette idéologie
qui considère que les hommes sont partout les mêmes et qu’on doit tenir ce qui les distingue (langues, cultures, modes de vie, sexes, etc.) comme contingences secondaires, l’idéal étant d’aboutir à un monde unifié – gouvernance mondiale ou grand marché planétaire. Mais le terme est hautement polysémique. S’il évoque la « fraternité universelle » et l’idée d’un « monde unifié », il peut aussi se rapporter à un certain sentiment de l’unité du vivant, voire à la coexistence pacifique de plusieurs cultures au sein d’une construction historique telle que les empires romain, austro-hongrois ou ottoman. Comme l’écrivait récemment Emmanuel Mattiato, « le cosmopolitisme a très rarement été étudié pour lui-même et s’est plutôt imposé comme une sorte de mot-programme sémantiquement creux ».Chez les stoïciens, le cosmopolitisme n’implique nullement de renier sa particularité. Il ne détourne pas non plus de la cité. Il exprime plutôt un sentiment de l’universel, ou de l’unité du monde (qui est encore à cette époque le kosmos harmonieux), qui incite à participer à la vie publique en s’efforçant de la conduire selon les exigences de la raison. Contrairement à Diogène, les stoïciens sont favorables à une participation active à la vie de la cité, même s’ils estiment n’y appartenir que de façon contingente. Ils affirment seulement que le monde est la référence à partir de laquelle on doit penser l’ordre civil, ce « monde » renvoyant surtout à un ordre intellectuel (ce n’est qu’à partir de la Renaissance qu’il commencera à désigner quelque chose de concret).
C’est seulement avec le christianisme qu’apparaît l’idée selon laquelle l’individu, avant d’être citoyen, appartient au « peuple de Dieu », lequel ne se confond avec aucun peuple particulier. L’idée d’un Dieu unique implique celle de l’identité essentielle de tous les hommes, qui sont tous également appelés à l’adorer. Prenant le relais de la simple philanthrôpia, l’agapè chrétienne s’étend à tout le genre humain. On connaît les propos de saint Paul selon lesquels il n’y a plus, devant Dieu, ni homme ni femme, ni Juif ni Grec (Gal. 3, 28). « Vous n’êtes plus des étrangers, ni des immigrés, dit-il encore, vous êtes de la famille de Dieu » (Eph. 2, 19). Augustin, de son côté, oppose radicalement la cité des hommes à la cité de Dieu, que Clément d’Alexandrie qualifie de cité « au sens fort. »
Mais il y a encore une autre manière d’envisager le cosmopolitisme. Je pense ici à Paul Morand, fin diplomate et grand voyageur, qui se réclamait d’un « cosmopolitisme » qu’il définissait comme « tout ce qui subsiste de cet humanisme qui, au Moyen Âge et sous la Renaissance, grâce à une langue commune, le latin, grâce à une même religion, prit naissance et se développa jusqu’au XVIIIe siècle parmi une élite d’aristocrates, d’écrivains, d’artistes et de voyageurs ». Morand, qui fut en poste sous Vichy, regrettait le cosmopolitisme passé des élites intellectuelles européennes, sentiment que l’on retrouve aussi chez Thomas Mann ou chez Valéry Larbaud. Je n’aurais pas de mal, pour ma part, à me reconnaître dans ce modèle de « cosmopolite voyageur ». Dès que je passe une frontière, dès que je suis « à l’étranger », je respire ! Mais le « cosmopolitisme » désigne alors tout simplement la curiosité que l’on éprouve de visiter des peuples différents, d’aller voir sur place des cultures différentes, des modes de vie différents. Loin de signifier le désir de voir disparaître les différences, ce sont au contraire ces différences qui font tout l’attrait du voyage. Plaisir de franchir une frontière, plaisir de partir, plaisir de revenir. On voit en tout cas par là combien il y a de façons différentes de comprendre le terme.
Vous écriviez en 1986 dans Europe, Tiers-monde même combat que le Tiers-monde était une force capable de lutter contre le mondialisme. En 2015, pensez-vous, malgré la recomposition du monde, qu’il constitue encore une alternative ou, au contraire, que son destin est de rejoindre le giron mondialiste ?
Mon livre sur l’Europe et le Tiers-monde a été rédigé dans le contexte de la guerre froide, à une époque où la vie internationale se résumait à la confrontation, directe ou indirecte, du bloc soviétique et d’un « monde libre » dominé par les États-Unis. Ne me satisfaisant pas de cette alternative, je pensais que l’Europe devait chercher à se dégager de cette double emprise en prenant la tête de ce qu’on appelait alors les pays « non alignés ». Il est évident qu’aujourd’hui, le contexte est tout différent. Nous sommes sortis de l’après-guerre et la chute du Mur de Berlin, qui est allée de pair avec la désintégration du système soviétique, a ouvert la voie à un nouveau nomos de la terre, pour parler comme Carl Schmitt, dans lequel l’ancien monde bipolaire est en passe de céder la place, définitivement je l’espère, à un monde multipolaire où l’Europe pourra jouer le rôle d’un pôle de régulation de la globalisation. Quant au Tiers-monde, il est clair qu’il ne constitue pas un ensemble unitaire, et que les « pays émergents » qui l’ont en partie remplacé sont appelés à connaître des destins très différents.
Cela dit, si le cadre a changé (et même si l’on s’aperçoit aujourd’hui que la guerre froide n’a jamais vraiment cessé !), les observations que je faisais dans ce livre me paraissent être restées toujours actuelles. Je pense surtout à ce que j’écrivais sur les sociétés traditionnelles, par rapport à un monde occidental totalement dominé par les valeurs marchandes, ou sur le problème de la dette, qui a aujourd’hui cessé d’être un problème du seul Tiers-monde puisque ce sont désormais tous les États occidentaux qui se sont placés sous la coupe des marchés financiers.
La question du cosmopolitisme est intimement liée à un idéal de paix universelle. C’est une idée que l’on retrouve aussi bien chez Emmanuel Kant que chez Stefan Zweig. Pensez-vous comme ces auteurs que la « paix perpétuelle » n’est possible que si l’on dépasse le modèle politique de l’État-nation ?
Comme vous le savez, c’est en 1795 que Kant publie son Projet de paix perpétuelle, qui prolonge son Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784) et s’inscrit dans le sillage des ouvrages de l’abbé de Saint-Pierre (Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, 1712-1713) et de Grotius (De iure belli ac pacis, 1625). On dit souvent que l’originalité du cosmopolitisme kantien est d’être fondamentalement un cosmopolitisme juridique. Cela me paraît très contestable. Son jus cosmopoliticum (qu’il oppose, dans son projet de paix perpétuelle, au jus civitatis et au jus gentium) n’a en effet de juridique que le nom. Kant pose en fait la « paix perpétuelle » in abstracto comme une exigence de la raison pratique : « La raison moralement pratique énonce en nous son veto irrévocable : il ne doit pas y avoir de guerre. » On voit par là qu’il s’agit d’un vœu pieux, car s’il était possible de réaliser en pratique ce qui ne peut relever que du domaine de la raison pure, la distinction entre l’empirique et le métaphysique n’aurait plus de raison d’être. Kant ajoute d’ailleurs que « nous devons agir comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait être ! », ce qui revient à affirmer que l’être doit être assujetti au devoir-être. En réalité, loin d’être un projet juridique, le projet kantien de paix perpétuelle postule la domination du droit par la métaphysique et la morale, et l’affirmation de la souveraineté de la métaphysique sur sa pratique.
Tout ceci pour dire que votre question n’est à mon avis pas bien formulée. Vous me demandez si la « paix perpétuelle » n’est possible qu’au prix d’un dépassement du modèle politique de l’État-nation. Ma réponse est qu’en toute hypothèse elle est impossible. La paix ne se conçoit pas sans la guerre, et le contraire est également vrai. La guerre restera toujours une possibilité, parce qu’on ne pourra jamais faire disparaître ce qui la provoque, à savoir la diversité virtuellement antagoniste des aspirations et des valeurs, des intérêts et des projets. L’abolition de l’État-nation n’y changerait rien. Au sein d’un « État mondial », les guerres étrangères seraient seulement remplacées par des guerres civiles.
Diogène donne un point de départ au cosmopolitisme en disant à l’empereur Alexandre qu’il est « citoyen du monde » pour lui signifier qu’il ne reconnaît aucune institution. Le cosmopolitisme est-il un anarchisme ?
Quand il s’affirme « citoyen du monde », c’est-à-dire « cosmopolite » (de kosmos, « monde », et politês, « citoyen »), Diogène veut dire qu’il méprise les lois de la cité d’Athènes, non véritablement par anarchisme, mais parce qu’il se réclame d’une appartenance au « monde » au regard de laquelle l’appartenance athénienne est dépourvue de valeur, comme le sont à ses yeux toutes les lois attachées à un lieu. Signe d’ingratitude évidente pour la cité qui l’a accueilli, puisqu’il était lui-même originaire de Sinope. Par ce fait même, il opposait la morale à la politique. Mais se trouvait du même coup posée la question fondamentale : comment serait-il possible de penser la « citoyenneté mondiale » sachant que le citoyen ne peut se définir qu’en référence au non-citoyen, c’est-à-dire à l’étranger ?
Se dire « citoyen du monde » est en réalité une contradiction dans les termes, car on ne peut être citoyen que d’une société ou d’une communauté politique, ce que le monde n’est pas. Il ne l’est pas et il ne saurait l’être, car le monde est par définition un, alors qu’il ne peut y avoir d’entité politique, qu’à la condition expresse qu’il en existe plusieurs. L’essence du politique réside en effet dans le couple ami-ennemi : elle implique la possibilité qu’une relation politique évolue dans le sens de l’amitié ou de l’inimitié. En ce sens, une « politique mondiale »,une véritable « cosmo-politique », est elle aussi une contradiction dans les termes. Il faut d’ailleurs rappeler que Kant, malgré son « cosmopolitisme », ne croyait pas à la possibilité d’un État mondial, et s’en tenait à l’idée d’une fédération d’États.
On peut bien entendu regarder la citoyenneté mondiale comme une chimère impossible à établir, mais qui n’en demeure pas moins sympathique dans son principe. Ce n’est pas mon avis, pour cette simple raison que, si par hypothèse une telle perspective se concrétisait, elle entraînerait obligatoirement l’anéantissement de la diversité, la suppression de toute altérité. C’est ce qu’avait très bien compris Hannah Arendt qui, dans ses Vies politiques (1986), écrivait : « La notion même d’une force souveraine dirigeant la Terre entière […] n’est pas seulement un sinistre cauchemar de tyrannie, ce serait la fin de toute vie politique telle que nous la connaissons. Les concepts politiques sont fondés sur la pluralité, la diversité et les limitations réciproques. » Consciente que « nul ne peut être citoyen du monde comme il est citoyen de son pays », elle ajoutait que « l’établissement d’un ordre mondial souverain, loin d’être la condition préalable d’une citoyenneté mondiale, serait la fin de toute citoyenneté ». Le nœud du problème réside en effet dans la question de savoir quel traitement la « cosmo-politique » réserverait à l’altérité. Soit elle la supprime, et elle s’avère totalitaire; soit elle la respecte, mais elle n’a alors plus rien de « cosmopolite ». Si l’on définit le cosmopolitisme comme un idéal visant l’unification mondiale des modes de vie, des institutions politiques, des modèles économiques et technologiques, on bute inévitablement sur cette aporie.
À date plus récente, la « cosmo-politique » a pu s’ordonner à l’idée que, face à toutes sortes de périls et de catastrophes possibles, le monde constitue notre espace commun. C’est à cette interdépendance planétaire que Jürgen Habermas fait allusion lorsqu’il écrit qu’« objectivement, la population mondiale forme depuis longtemps une communauté involontaire de risques partagés ». Mais cette observation ne va pas bien loin, dans la mesure où, face à ces risques, il n’est pas dit que les différents pays adopteront une conduite identique : comme l’a bien remarqué Ulrich Beck dans son livre La société du risque, une situation de risques partagés ne crée pas automatiquement une communauté politique.
« À celui qui n’a plus rien, la patrie est son seul bien », aurait dit Jaurès. L’enracinement, le sentiment d’appartenance à une nation, serait donc l’apanage du peuple. Le cosmopolitisme, parce qu’il est enfant des Lumières, est-il nécessairement une idéologie bourgeoise ?
Je partage le sentiment de Jaurès. Il ne signifie pas que l’enracinement ne peut être le fait que du peuple – même si l’expérience historique montre que les classes populaires ont toujours été plus « patriotes » que les élites –, mais que le sentiment d’appartenance est quelque chose que l’on ne peut enlever même à ceux qui ne possèdent rien. Il faudrait aussi rappeler qu’au XXe siècle, la critique du cosmopolitisme au nom du principe national n’a pas été le seul fait des milieux dits nationalistes. On a un peu oublié qu’en 1950, le communiste Georges Cogniot publiait aux éditions Sociales, contrôlées par le PCF, un livre intitulé Réalité de la nation. L’attrape-nigaud du cosmopolitisme. Il y affirmait que « le cosmopolite représente le dernier degré de l’inhumanité capitaliste », ce qui ne me paraît pas erroné. « Pour le cosmopolite, ajoutait-il, l’homme est un personnage schématique, “citoyen du monde” sans famille et sans peuple, sans traditions ni particularités nationales. Pour le marxiste, au contraire, l’homme est le produit d’un développement social déterminé, d’un certain nombre de conditions précises qui lui confèrent une formation psychique définie, un caractère national. » J’ajouterai, pour en finir sur ce point, qu’il ne faut pas non plus confondre l’universel et l’universalisme (pas plus qu’il ne faut confondre la liberté et le libéralisme). Ce n’est pas la singularité qui se déduit de l’universel, mais l’universel qui s’atteint par le truchement de la singularité. D’où la belle expression de l’écrivain portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs. »
Les citoyens du monde que furent Stefan Zweig et, dans une moindre mesure, Romain Rolland, exprimaient une solidarité sincère envers tous les hommes et une hostilité justifiée envers les nationalismes dont ils furent les contemporains. Comment dès lors comprendre la phrase de Rousseau dans son Émile : « Méfiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin de leur pays des devoirs qu’ils dédaignent accomplir chez eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d’aimer ses voisins » ?
Il n’est pas nécessaire d’être cosmopolite pour éprouver une sympathie de principe envers tous les peuples, ni même pour critiquer le nationalisme, qui n’est qu’un égoïsme collectif relevant de cette métaphysique de la subjectivité qu’a si bien dénoncée Heidegger. Quant à la phrase de Rousseau que vous citez, elle n’étonne nullement venant d’un philosophe résolument hostile au cosmopolitisme des Lumières. Montesquieu disait qu’il était « nécessairement homme », tandis qu’il n’était « Français que par hasard ». Turgot, Condorcet, Voltaire, Diderot se considéraient, eux aussi, comme avant tout chargés d’« éclairer le genre humain ». Rousseau est d’un avis tout différent. À partir du premier Discours, il s’éloigne de l’universalisme avec de plus en plus de netteté. Constatant que « plus le lien social s’étend, plus il se relâche », il n’hésite pas à mettre en accusation « ces prétendus cosmopolites qui, justifiant leur amour pour la patrie par leur amour pour le genre humain, se vantent d’aimer tout le monde pour avoir le droit de n’aimer personne ». On ne saurait mieux dire.
Dans le contexte actuel de la mondialisation et d’émergence de la pratique du « nomadisme d’élite », l’attachement à l’identité est spontanément conçu comme une forme de sédentarisme. Pourtant, il existe des sociétés nomades traditionnelles, donc une identité proprement nomade. Qu’est-ce qui la distingue du nomadisme attalien ?
L’opposition entre nomades et sédentaires est d’ailleurs toute relative. Durant tout le paléolithique, à l’époque des chasseurs-cueilleurs, l’humanité a vécu à l’état nomade. La sédentarité n’intervient qu’avec l’invention de l’agriculture et la révolution néolithique. L’une et l’autre n’empêcheront cependant pas les grandes migrations de peuples. Rien de commun avec le nomadisme moderne (ou postmoderne), qui est le fait d’une classe transnationale d’hommes hors-sol, d’hommes de partout et de nulle part, qui se déplacent en jets privés dans le monde entier pour organiser les délocalisations et rechercher les conditions fiscales, sociales et environnementales propres à garantir une augmentation de leurs profits. Le « nomadisme attalien » est de ce point de vue bien différent de celui des sympathiques Bédouins !Les sociétés nomades sont toutes des sociétés traditionnelles qui privilégient les rapports de lignage, les parentés familiales élargies, claniques et tribales. Ce serait également une grave erreur de s’imaginer qu’elles sont étrangères ou indifférentes aux lieux. Les Bédouins des déserts d’Arabie et les Touaregs, les nomades des steppes d’Asie centrale, les éleveurs kazakhs et kirghizes non encore sédentarisés, ne nomadisent pas n’importe où : ils sont liés à des territoires particuliers. Étymologiquement, un Bédouin (badwî ou badâwi) est un « habitant du désert ». Mode de vie fondé sur l’économie pastorale et le déplacement régulier dans un périmètre bien délimité, le nomadisme n’a rien à voir avec le « cosmopolitisme ».
Alain de Benoist (