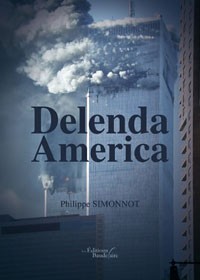Le dilemme français
Héritière d’une prestigieuse tradition remontant à l’Ancien Régime, la diplomatie française de la Ve République, sous l’impulsion initiale du général de Gaulle, sut faire entendre une voix originale et respectée. Une voix nonalignée. En dépit d’inflexions de plus en plus sensibles – surtout après la fin de la guerre froide (1991) et le traité de Maastricht (1992) –, les successeurs de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou à Jacques Chirac inclus, se sont attachés à inscrire leur action dans une certaine continuité, à préserver un certain esprit d’indépendance, quelques principes. Ayant fait campagne, en 2007, sur le thème de la « rupture », Nicolas Sarkozy n’avait pas dissimulé, alors, que celle-ci visait aussi cet héritage. Aujourd’hui, alors que son quinquennat arrive à son terme, quel bilan peut-on tirer de son action, quelle est l’image de la France dans le monde, quelles perspectives d’avenir peut-on esquisser ?
De Gaulle estimait que la France se devait d’avoir une « grande politique » sous peine de ne plus exister. Giscard préférait indexer notre influence sur son poids : « 1 % du monde ». La contradiction est d’autant moins résolue que, depuis trente ans, les traités européens auxquels nous souscrivons multiplient les ligotis juridiques censément « irréversibles »…
Ceux qui ont lu les Mémoires de guerre du général de Gaulle se souviennent du passage célèbre où, décrivant ses débuts à Londres, dans les premiers jours de l’été 1940, il fixe la stratégie à laquelle le contraint son isolement et même, alors, son anonymat : « Ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. C’est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrais trouver l’autorité… Les gens qui, tout au long du drame, s’offusquèrent de cette intransigeance ne voulurent pas voir que, pour moi, tendu à refouler d’innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eut entraîné l’effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l’étais, il me fallait gagner des sommets et n’en descendre jamais plus. »
Vision immédiate du rapport de force (en l’espèce, le plus défavorable qui se puisse imaginer, à la fois pour la France, dépecée par l’ennemi, et pour de Gaulle, prétendant la relever à partir de rien) et choix du meilleur levier pour le rééquilibrer (en l’occurrence, le plus inattendu : cet acte de volonté brute en forme de coup de poker qui prendrait de court les Britanniques, rompus, depuis les années 1930, à décider pour les Français), tout se tient. Le premier geste historique du futur fondateur de la Ve République est d’abord un geste de politique étrangère qui fondera, plus tard, sa légitimité dans l’ordre intérieur. Face aux Britanniques, de Gaulle comprend que s’il n’est pas reconnu comme un allié à part entière, il n’incarnera pas la France aux yeux du monde ; et que, sans cette base de départ, il est vain d’espérer que, même en cas de victoire alliée, la France, mise hors jeu par l’armistice, recouvre jamais son statut d’Etat souverain. Mais en réaliste, il comprend aussi que cette volonté d’incarner la France doit se traduire juridiquement : ayant été reconnu, faute d’autres candidats, seul chef des Français libres par Churchill, son souci primordial est de faire en sorte que ses premiers partisans n’incarnent pas une légion de combattants au service de la Grande-Bretagne, mais l’embryon d’une organisation appelée, le jour venu, à incarner la légitimité française.
Non sans humour, le grand juriste René Cassin, que de Gaulle avait chargé, le 29 juin 1940, de rédiger dans ce sens les ordonnances fondatrices de la France libre, décrira après la guerre l’image qui lui traversa l’esprit à ce moment précis : « Si Hitler regardait par le trou de la serrure, et entendait ce professeur de droit qui doctrinait : “Nous sommes l’armée française’’, et ce général à titre provisoire qui renchérissait : “Nous sommes la France’’, il s’écrierait certainement : “Voilà deux fous dignes du cabanon !”... »
Pourtant, cinq semaines plus tard, le « fou » obtiendra gain de cause en signant avec Churchill les accords du 7 août 1940 par lesquels le Royaume- Uni reconnaissait à la France libre un statut d’allié à part entière. Ceux-ci lui permettront de se doter d’une administration et de finances propres, qu’alimenteront les dons recueillis par les comités de Français libres du monde entier et surtout les avances remboursables consenties par la Grande- Bretagne. Ce dernier détail est essentiel, car s’ils n’avaient pas d’emblée été conçus comme tels, ces subsides auraient privé la France libre de toute marge de manoeuvre à l’égard de son hôte. De fait, la plupart de ces avances seront remboursées, dès avant la fin de la guerre, sous forme de fournitures militaires (les navires, par exemple, que les jeunes Forces navales françaises libres ne pouvaient armer en raison de la faiblesse de leurs effectifs) et de matières premières livrées à la Grande-Bretagne à partir des territoires ralliés à la France libre.
C’est que, pour de Gaulle, qui s’inscrit dans une tradition à la fois chrétienne et platonicienne, l’essence précède l’existence : « l’idée de la France » existant indépendamment de son incarnation, il suffisait de poser sa survie avec suffisamment de foi pour que les faits – appuyés sur une logique rigoureuse (« vaincus par une force mécanique supérieure, nous pourrons vaincre, demain, par une force supérieure encore », etc.) – lui donnent raison. Toute sa politique future en découlera, mélange d’empirisme parfois brutal et de vision spirituelle à long terme : la dissuasion du faible au fort comme antidote à la double hégémonie convenue des hyperpuissances et comme garantie contre la protection abusive d’alliés trop envahissants ; la sortie du commandement militaire intégré de l’Otan afin que les armes de la France ne concourent pas à des buts de guerre contraires à ses intérêts vitaux ; la promotion d’une « Europe de l’Atlantique à l’Oural » comme alternative au rideau de fer…
Pour spectaculaire qu’ait été ce retour en force de la France dans les affaires du monde aux yeux d’une opinion internationale déshabituée, depuis 1918, à voir la France jouer un rôle de premier plan, de Gaulle ne s’en inscrivait pas moins dans la droite ligne de la politique classique de la monarchie française : la priorité traditionnelle aux alliances de revers pour équilibrer le poids de l’Empire (avec le pape contre le Saint Empire, sous Saint Louis ; avec le Grand Turc contre Charles Quint, sous François Ier), se traduirait, dans les années 1960, par l’engagement de la France dans deux directions simultanées et complémentaires, destinées à équilibrer la thalassocratie anglo-saxonne : une politique résolument continentale (dégagement colonial, rapprochement franco-allemand, détente avec l’URSS) et une prise en compte des revendications du tiers-monde afin de pouvoir compter sur des alliés sûrs à l’ONU.
Mais, en 1974, changement de cap : avec l’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing, la France renoue avec la logique de « sécurité collective » qui avait prévalu entre les deux guerres, sous l’influence de Jean Monnet, l’un des pères de la Société des nations (SDN) avant de devenir celui de l’Europe supranationale actuelle. Dans cette conception, les Etats sont moins des entités historiques, dotés, d’intérêts vitaux dont les gouvernements sont comptables que des pions sur l’échiquier d’une démocratie mondiale où tout se décide par le vote.
Après l’essentialiste de Gaulle, voici l’existentialiste Giscard, pour qui toute politique étrangère se fonde sur le poids relatif des Etats. On connaît celui, démographique de la France, qu’il prend soin de rappeler à ses concitoyens, dès les premiers jours de son mandat : « 1 % du monde ». A de Gaulle, qui, d’un constat plus pessimiste encore (le nanisme politique de la France libre) tirait la conclusion que seule une « très grande politique » pouvait nous préserver de la disparition, succède une philosophie, progressivement acceptée par tous, selon laquelle la volonté s’efface devant la nécessité.
Ecoutons Valéry Giscard d’Estaing dresser les grandes lignes de sa politique étrangère, à l’occasion de sa première conférence de presse consacrée au sujet, le 20 décembre 1974 : «Nous passons d’une civilisation de groupe à une civilisation mondialiste. La politique étrangère, c’est essayer de trouver des solutions qui permettent réellement de traiter les problèmes de l’espèce, la paix, la pollution, le développement, ainsi de suite… Ce qui fait que, nécessairement, la politique étrangère de la France sera une politique mondialiste et de conciliation. A l’heure actuelle, la France n’a plus aucune revendication d’aucune sorte. [Sa vocation], c’est d’aider à l’apparition d’un certain mondialisme des problèmes… C’est pourquoi on peut dire : “Vous êtes l’ami de tout le monde, vous êtes l’ami des Soviétiques, vous êtes l’ami des Américains”… Effectivement, notre rôle, c’est d’être un facteur de conciliation chaque fois que c’est possible… »
Ainsi, si la France se doit d’être partout présente, ce n’est plus, comme naguère, pour défendre ses intérêts spécifiques, mais, au contraire, pour aider indistinctement l’URSS et les États-Unis, à désamorcer les tensions. Pour la première fois, le refus des rapports de force devient un axiome et l’angélisme un mode d’expression. De fait, Giscard ne croit pas que le condominium soviéto-américain, que de Gaulle n’avait de cesse de briser, soit un danger pour la paix du monde. Mieux : il estime nécessaire d’enrôler la France à son service.
Les conférences sur le désarmement, que de Gaulle autant que Pompidou refusaient de cautionner parce qu’ils les tenaient pour un moyen de neutraliser le pouvoir d’équilibre des non-alignés ? Giscard promet d’y participer tôt ou tard, et l’annonce même d’emblée à Leonid Brejnev ! D’où le choix – par contraste avec un Maurice Couve de Murville ou un Michel Jobert – de ministres en phase avec la modestie des buts assignés à la France, « puissance moyenne » selon Giscard. Au reste, que demander à un Jean Sauvagnargues, à un Louis de Guiringaud, ou même à un Jean François-Poncet, si ce n’est « gérer l’imprévisible », selon la formule mise à la mode par le nouveau président de la République ?
Gérer l’imprévisible : au nom de ce principe, quelle direction donner à la politique hors celle que semblent indiquer les événements ? Même le Monde, naguère si prompt à dénoncer la politique de la « France seule » qui fut, à l’en croire, celle des deux précédents présidents, s’inquiète alors de l’absence de lisibilité du dessein giscardien. Avec Giscard, résume André Fontaine le 26 octobre 1974, ce n’est plus “l’intendance suivra”, comme sous de Gaulle, mais l’“intendance précède”. Et d’appliquer au chef de l’Etat cette formule tirée des Faux-monnayeurs de Gide : « Il ne s’oublie jamais dans ce qu’il éprouve, de sorte qu’il n’éprouve jamais rien de grand. »
Mais de même que les gadgets de la « décrispation » giscardienne dissimulaient un vrai projet – rendre inutile l’alternance en vidant le programme commun de son contenu –, de même l’apparente résignation du nouveau pouvoir à laisser la France glisser du statut de sujet à celui d’objet de la vie internationale n’est pas le fruit du hasard. Elle doit tout à l’influence de Jean Monnet, qui, un mois à peine après l’élection de Giscard, décida de dissoudre son Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe, créé dix-huit ans plus tôt et devenu sans objet, puisqu’il avait propulsé l’un de ses membres à l’Elysée.
Dès 1974, le programme Monnet, conçu comme une fusion progressive des nations européennes en un Etat fédéral expérimental, prodrome d’un gouvernement mondial (lire à ce sujet ses Mémoires, parus chez Fayard, en 1976), sort des cartons et prend vie : création du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement, décision, en 1977, d’élire le Parlement européen au suffrage universel direct (dernier projet supervisé par Jean Monnet, alors âgé de quatrevingt- huit ans) ; création, surtout, du Système monétaire européen (1979), matrice d’où sortira, avec le traité de Maastricht (1992), l’instauration d’une monnaie unique européenne, le 1er janvier 1999.
Avec Maastricht est inauguré un type d’accord international jusqu’alors inédit : la matière négociée ne s’impose plus à la loi interne des Etats seulement sous réserve de réciprocité, comme dans les traités internationaux classiques, mais en toutes circonstances ; et surtout, celle-ci vaut acceptation d’un droit externe supérieur aux lois nationales forgées par les Parlements. La souveraineté qui, depuis Aristote, était un absolu (de même qu’une porte est ouverte ou fermée, on est libre ou on ne l’est pas), devient une valeur relative. Donc, n’existe plus dans sa définition classique. Le pli est pris qui, de jurisprudence en jurisprudence, va soumettre la loi votée, expression de la souveraineté populaire, à des textes édictés par des instances représentatives non élues, en l’occurrence les organes de l’Union européenne, la Commission de Bruxelles et la Cour de justice de Luxembourg, respectivement garante et interprète suprême des traités…
Le dessaisissement des Etats va donc se poursuivre suivant un scénario bien rôdé : avec Maastricht, pas moins de dix-neuf matières seront reconnues de compétence communautaire, depuis la politique commerciale et douanière jusqu’au tourisme, en passant par l’industrie, la concurrence, l’environnement, la recherche, la santé et la protection du consommateur ; en 1998, le traité d’Amsterdam ajoutera l’immigration et la sécurité commune ; en 2009, le traité de Lisbonne, ratifié par voie parlementaire et reprenant point par point le texte de la Constitution européenne, refusé en mai 2005 par le peuple français, parachèvera l’évolution en soumettant, non plus seulement les droits internes, mais les droits constitutionnels nationaux au droit communautaire…
Et voici que, sous la pression de la crise, exacerbée par les critères de convergence d’une monnaie unique imposant les mêmes obligations à des zones au développement divergent (pour faire court, la Bavière et le Péloponnèse), le futur traité – négocié sous la pression des marchés par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, le 5 décembre 2011 –, se propose de communautariser les questions budgétaires, donc fiscales !
Un Etat privé de sa liberté budgétaire, donc incapable de fixer sans l’accord de ses voisins les marges de manoeuvre nécessaires à la défense de ses intérêts au sens large, peut-il, de fait, se targuer d’avoir encore une politique étrangère indépendante ? Comme on le dit d’un disque dur d’ordinateur, celle-ci se trouve ipso facto « formatée » : le logiciel fixe non seulement les moyens disponibles, mais encore et surtout, le but à atteindre. La standardisation s’impose pour les Etats de la même manière qu’elle s’impose pour les armées, dans le cadre de l’organisation intégrée de l’Otan, rejointe par la France en 2009.
Ainsi est-on parvenu au résultat de « l’effet d’engrenage » (ou spill over effect) vanté par Jean Monnet au moment de l’entrée en vigueur de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca), en 1952 : un transfert en douceur des compétences traditionnellement régaliennes vers des organismes techniques échappant aux « aléas » – comprendre : à la volonté des peuples.
Ce spill over effect, selon le vocable emprunté à l’école néofonctionnaliste américaine, chère aux disciples de Jean Monnet, a été fort bien résumé par Jacques Delors, alors président de la Commission de Bruxelles, le 30 novembre 1989, à l’occasion d’un colloque du Center for European Studies de Boston : « Le secret de la construction européenne est celui d’une dialectique entre la force des engagements fondamentaux et le développement spontané de ses multiples effets d’engrenage… »
Contre de Gaulle, qui ne concevait l’économie que comme une discipline ancillaire du politique, Monnet aura bel et bien imposé l’ordre inverse : la soumission de la politique – qui implique la liberté de choix, donc l’existence de plusieurs possibles – à la technique économique, laquelle ne souffre aucune alternative, puisqu’elle se conçoit elle-même comme détentrice d’une rationalité suprême !
En 2011, la boucle était bouclée, qui permettait à Jacques Attali d’expliquer comment la monnaie unique avait été conçue, à l’insu même des peuples, auxquels on l’avait « vendue » sous les espèces d’un produit miracle destiné à empêcher les crises, comme un engrenage destiné, au contraire, à imposer la création d’une super-administration pas nécessairement confinée aux frontières politiques de l’Europe : « Lorsque nous avons créé le marché unique, en 1984, confiait-il, le 11 août 2011 à la revue sur Internet du Council on Foreign Relations (CFR), nous savions que le marché unique ne pourrait pas fonctionner sans une monnaie unique, et nous avons créé une monnaie unique. Et lorsque nous avons créé cette monnaie unique, nous savions que la monnaie unique ne pourrait pas survivre sans un budget fédéral. » Il concluait : « Nous sommes en train de voir apparaître un marché mondial sans un Etat de droit mondial. Nous avons donc besoin d’une primauté globale du droit […] et d’un nouveau système international où la charge de la réserve de monnaie mondiale serait répartie entre les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Europe. »
De l’Europe à la crise et de la crise, conçue comme un levier, vers un gouvernement mondial : on voit à quoi ont abouti, depuis Maastricht, les ligotis acceptés par les Etats, de traité en traité, au prétexte d’assurer à l’Europe une prospérité qui, c’est le moins qu’on puisse dire, ne s’est pas imposée comme la contrepartie spontanée de l’extinction de leurs souverainetés.
« On lie les boeufs par les cornes, et les peuples par les traités », résumait Antoine Loysel, l’un des plus grands légistes français, qu’admirait Richelieu. Quatre siècles plus tard, le dilemme de la politique étrangère française reste entier : garder les mains libres ou se soumettre aux engrenages, au risque de s’y faire broyer.
Eric Branca (Le spectacle du monde, janvier 2012)