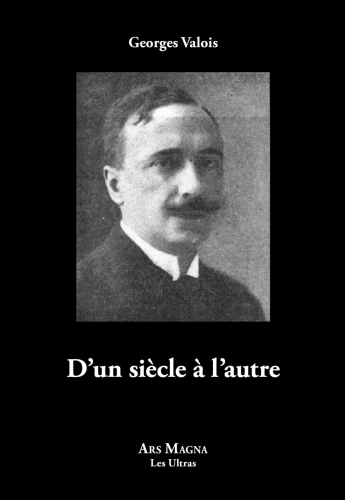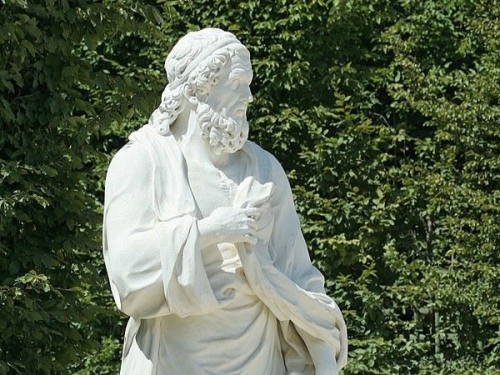Sur la démocratie et la figure du Démocrate
Les mots, comme tout autre instrument, subissent l’usure du temps. À l’instar des outils, c’est précisément le passage de main en main qui accélère ce processus, en émoussant les arêtes et en affaiblissant la charge de la signification originelle, jusqu’à les rendre presque méconnaissables. Aucun mot n’a peut-être subi une usure plus radicale que « démocratie ».
Aujourd’hui, ce terme est un récipient universel pour toute aspiration au bien ou – plus fréquemment – un synonyme paresseux de liberté, de tolérance et de droit. Évidemment, dans cette œuvre de sacralisation laïcisée, les Lumières ont joué un rôle de premier plan. Les régimes bourgeois qui s’opposaient à l’Ancien Régime, dans leur tentative de se doter d’une légitimation, ont cherché leurs racines vertueuses dans un passé idéalisé, construisant une généalogie qui, de l’Athènes classique, mènerait linéairement jusqu’aux palais de Bruxelles, Washington, Montecitorio ou de l’Élysée. Naturellement, l’opération est idéologique, comme le sont toutes les grandes entreprises de construction du mythe, mais ce n’est pas une raison pour accorder foi aux illusions auxquelles elle conduit en revendiquant une « identité démocratique ».
La démocratie n’est pas un terme thaumaturgique capable de dissoudre les conflits. Une nécessaire opération philologique révèle que l’élément décisif de ce construit lexical, kratos, signifie puissance au sens de force efficace, parfois contrainte dans sa dimension la plus physique. Demos, sans kratos, reste une somme indistincte ; kratos, sans demos, devient pure domination. Les Grecs n’ignoraient pas la friction, car la démocratie athénienne fut un équilibre instable entre l’assemblée, les tribunaux, le tirage au sort et le commandement militaire.
L’époque de Périclès démontre que l’hégémonie culturelle d’un leader n’abolissait pas les contrôles, mais la cité se reconnaissait, lors des moments décisifs, dans un guide capable d’imprimer une direction. Ce n’est pas un hasard si les détracteurs du gouvernement populaire appelaient le parti au pouvoir « démocratie » précisément pour signaler l’aspect coercitif du kratos, tandis que ce dernier préférait se désigner simplement comme « le demos ».
D’où la première constatation essentielle: là où aujourd’hui on lit « gouvernance », les classiques écrivaient kratos. Vider le terme de sa substance « violente » revient à occulter que la décision comporte un risque, une forte responsabilité personnelle et – si besoin – le conflit. Dans les moments de bifurcation, la polis ne se sauve pas par la simple procédure, mais parce que quelqu’un concentre et dirige l’énergie commune. C’est précisément cela que la rhétorique contemporaine tend à éluder.
Il est également intéressant de noter un terme d’usage classique qui a connu peu de fortune historique, demokrator. Dans la Grèce de l’époque romaine, «demokratía» peut signifier la domination sur la communauté: chez Appien, César et Pompée « luttent pour la demokratía » (ils ne briguent sûrement pas une élection) ; et un témoin tardif rapporte que Dion Cassius définissait Sylla comme demokrator. Il ne s’agit pas de la fonction technique du dictateur romain, mais d’un pouvoir personnel plein, accepté parce qu’efficace.
Ainsi, l’opposition scolaire commode entre « démocratie » et « dictature » apparaît floue. La différence, pourtant, existe et reste cruciale: le dictateur romain est une magistrature extraordinaire et temporaire, déléguée par la loi pour résoudre une urgence. Le demokrator pourrait être défini comme un aboutissement, c’est la force collective qui se reconnaît dans un guide qui intègre – au lieu de suspendre – le tissu institutionnel, orchestrant le pluralisme sans le dissoudre. À l’époque moderne, ce dispositif réapparaît comme césarisme et, à une certaine époque, sous le nom de bonapartisme: gouvernement personnel qui naît d’une relation directe avec le corps civique et mesure sa légitimité à son efficacité.
Mais pour revenir à Athènes, il est remarquable de rappeler que Thucydide anticipe en Périclès la figure du princeps: pour éviter l’accusation d’être un régime démocratique (horribile dictu), il rapporte qu’Athènes était « en paroles une démocratie, en fait un gouvernement du pròtos anèr (premier homme) ». Il s’agit donc d’une primauté personnelle acceptée, capable de rendre la légalité opérante et d’hégémoniser la majorité.
L’image renverse le lieu commun de la démocratie athénienne comme principe des systèmes d’assemblée « redécouverts » à l’époque moderne, et montre au contraire un lien inconfortable avec l’institution romaine dont, dans l’histoire, le parcours de Bonaparte se serait voulu le continuateur: un compromis entre élites, corps et peuple, avec une direction qui sait aussi être impopulaire.
Démocratie donc, n’équivaut pas à demo-archie: c’est l’opération de camouflage de la « force des nombreux » en « principe des nombreux ». Que la démocratie soit aussi une question d’indépendance matérielle est démontré par un épisode historique précis: en 89-87 av. J.-C., lorsque Athènes recouvre momentanément sa souveraineté, elle réactive des formes démocratiques. Indépendance et démocratie vont de pair parce que la citoyenneté est, avant tout, puissance en armes: sans autonomie, aucun kratos commun n’est possible.
Ce n’est pas seulement un rappel gênant pour ceux qui identifient la démocratie à un sondage éternel, mais si dans l’esprit de certains cela ouvre la perspective d’un régime militaire traditionnellement opposé à Athènes comme celui de Sparte, cela n’est pas un hasard. Ce fut en effet l’Athénien Isocrate (statue, ci-dessus) qui définissait Sparte comme une « démocratie parfaite », pour avoir fait coïncider citoyenneté et puissance armée dans la figure des Spartiates: citoyens par droit du sang, armés et appelés à exercer une participation exclusive vis-à-vis de l’étranger.
Pour donner consistance à la figure du demokrator, il s’agit de le définir comme celui qui reçoit un mandat à haute énergie et le restitue en œuvres, en définissant priorités et délais. En d’autres termes, un régime est démocratique non s’il exclut l’existence d’élites, mais s’il les requalifie, en passant d’élites de naissance à élites de fonction, dont le rang dépend de la capacité à rendre productive la force du peuple.
Napoléon est un cas exemplaire, il n’a pas exercé un rôle dictatorial au sens romain, mais plutôt celui de directeur plébiscitaire: son administration, fondée sur un rapport immédiat avec la nation, sans abattre les corps intermédiaires mais en les réorganisant, atteste d’une trajectoire qui – avec les éventuelles ombres du cas – confirme le kratos comme un outil. La question, avant d’être institutionnelle, est aussi symbolique. L’histoire est un réservoir d’images et de rites civiques qui concentrent l’attention collective. Sans ce registre, la politique se réduit à une administration compliquée.
Dans les moments décisifs, les communautés se rassemblent autour de figures qui séparent le tissu vivant des formes parasitaires: des interprètes capables de libérer des ressources contre les rentes et les appareils qui les drainent. C’est la manière dont le « sacré » civil canalise, sans mysticisme, l’énergie commune.
Que l’acception réelle de la démocratie soit aujourd’hui aussi étrangère, sinon contradictoire, n’est pas sans raison: « démocratie » est un terme qui a eu trois siècles marginaux dans l’Antiquité, puis a disparu longtemps avant de ressurgir tardivement, jusqu’à la consécration post-1789; au vingtième siècle, souvent employé comme mot d’ordre contre les régimes illibéraux plutôt que comme définition institutionnelle.
Revenir aux textes est un exercice nécessaire pour reconnaître les pulsions vitales de la politique, communément diabolisées dans la figure maléfique du « démagogue populiste » qui – observait Spengler – correspond à une phase de déclin des bureaucraties amorphes, destinées à s’effondrer dans le césarisme, qui ne vient pas éteindre la démocratie mais la revitaliser. Il ne s’agit pas d’invoquer l’homme providentiel, mais une grammaire qui lie décision et responsabilité, permettant au peuple de se reconnaître dans celui qui gouverne, afin que « démocratie » retrouve le sens de capacité à destiner et non seulement à administrer avec de vrais résultats.
Andrea Falco Profili (Euro-Synergies, 10 octobre 2025)